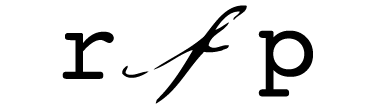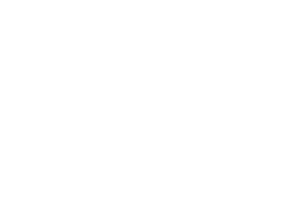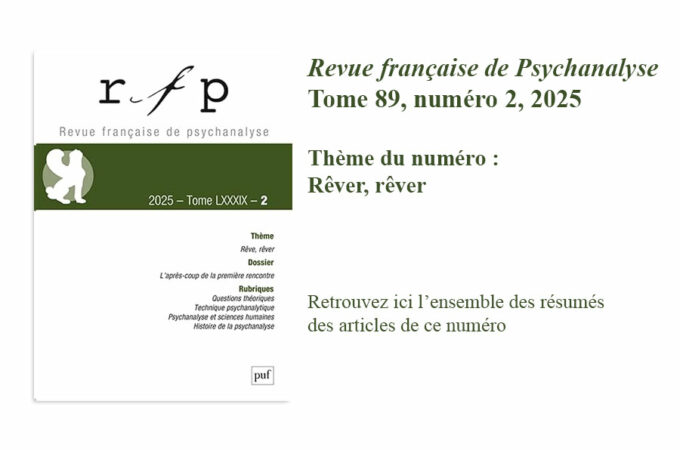
89-2 Résumés des articles
THÈME : RÊVER, rêver
François Duparc – L’interprétation des rêves aujourd’hui
RÉSUMÉ – La découverte de Freud est que le rêve est l’expression d’un désir inconscient. Mais hormis les rêves qui utilisent des symboles, des rêves fleuves ou peu élaborés, les mécanismes de la censure s’emploient à dissimuler ce désir par déplacement, condensation, retournement en son contraire, répétition ou coupures. Ce qui fait penser aux mécanismes de défense des névroses et aux fantasmes originaires de l’Œdipe. Mais si les rêves ne contiennent pas les émotions ou l’excitation, on a des cauchemars ou des rêves proches du somnambulisme. Dans les névroses actuelles et les affections psychosomatiques, ces troubles de la fonction onirique amèneront à des aménagements techniques comme le face-à-face ou la relaxation, pour reconstruire des rêves contenant le désir, au-lieu d’une décharge répétitive.
MOTS-CLÉS – mécanismes du rêve, censure, cauchemars, fantasmes originaires.
Charlotte Collet – Le récit du rêve : un métalangage onirique
RÉSUMÉ – Le récit du rêve provient d’un double travail de transposition : d’une image en pensée, puis de la pensée au langagier, concédant une reconstruction scénique permettant d’appréhender les ressorts de la dynamique psychique du sujet. Ces transpositions succinctes s’accordent à la traçabilité de l’empreinte visuelle des images qui s’effectue au fil des associations du patient, dont l’auteur compare le déploiement et l’analyse à une activité métalinguistique. De là adviendrait le récit du rêve comme métalangage onirique qui conjuguerait en son sein de multiples éléments langagiers transformés par les mécanismes de la censure, voilés par le fantasme, mais pouvant être parcimonieusement dévoilés par l’analyse, octroyant l’accès aux contenus latents. C’est à partir d’une vignette clinique que les enjeux du travail du rêve et ses processus seront développés, conduisant la patiente, à l’aune d’une brève séquence de rêve, à dérouler un fil associatif l’amenant à se questionner sur son rapport à l’autre et son désir.
MOTS-CLÉS – rêve, récit, métalangage, reconstruction, désir.
Johanna Velt – Rêve et rêverie : New York Palace, Budapest
RÉSUMÉ – Dans cet article, l’auteure discute des liens entre rêve et rêverie. La rêverie s’origine selon Bion dans le travail de rêve. Quelques données contemporaines sur la rêverie par les post-bioniens sont évoquées. Puis l’auteure reprend les travaux des Botella sur la figurabilité et la régrédience : la figurabilité de l’analyste s’enracine dans le travail de rêve selon le modèle freudien et se distingue de la rêverie qui, selon eux, se cantonne au préconscient et à l’intersubjectif, et n’a pas les qualités de la régrédience – laquelle recèle le potentiel d’accéder à l’irreprésentable et/ou au traumatique. À travers un exemple clinique, l’auteure discute ces arguments et soutient qu’au contraire la rêverie peut être un travail de figurabilité, tout en admettant les risques de dérives, notamment par certaines attitudes techniques et prises de position théoriques (communication directe des rêveries de l’analyste à l’analysant, considérer les rêveries comme un aboutissement en soi).
MOTS-CLÉS – rêve, rêverie, figurabilité, régrédience, traumatique.
Armelle Nithart – Le rêve : cet obscur objet du sujet
RÉSUMÉ – Cet article montre à travers trois exemples : la Bible, le cas d’un patient, et celui de Fellini, la façon dont l’expérience du rêve peut être vécue différemment selon les sujets. Dans la Bible, le rêve reste un objet totalement extérieur au sujet qui le ramène à un état de passivité. En analyse, il peut avec certains patients faire l’objet d’un investissement fétichique, garant de l’intégrité du sujet, entravant toute possibilité d’analyse. En cela il ramène à la position phobique centrale, notion développée par André Green. Le travail consistera alors à permettre au sujet de se familiariser avec cet objet étrange, de se l’approprier et ainsi de pouvoir associer, réfléchir dessus. Parfois, comme dans le cas de Fellini, le rêve est très fortement investi et participe à une production artistique foisonnante, mais il semble alors que le sujet ait du mal à s’en séparer. Le rêve est en effet au cœur de la relation avec l’objet primaire et de tous ces aléas. Si le rêve enrichit l’imaginaire, la créativité, le sujet doit pouvoir s’en séparer à un moment pour repartir dans la vie. Il implique donc un travail de deuil. La place du tiers, le Surmoi sont essentiels dans ce processus.
MOTS-CLÉS – expérience du rêve, séparation, imago, appropriation, manque, fétiche.
Emmanuelle Joly – Impossible régressivité topique et voie d’accès au rêve dans les états maniaques
RÉSUMÉ – Dans l’état maniaque, le sujet ne peut accéder au rêve, il ne peut plus rêver endormi, il rêve éveillé, grâce aux capacités hallucinatoires de l’appareil psychique. En référence aux théorisations freudiennes sur la formation du rêve, l’opération indispensable pour parvenir au rêve est la régression topique jusqu’au refoulé inconscient. Ce matériel inconscient semble contourné dans l’état maniaque, son contenu apparaissant dangereux, révélateur d’un lien à l’objet fragile et mortifère. Durant la crise maniaque, ce lien restauré illusoirement est mis en scène dans des scénarii grandioses, où le maniaque se sent exister, sous le regard de l’objet, transféré sur le monde. La régression topique est impossible, la possibilité de dormir est barrée, et le maniaque jouit d’une vie hallucinée alimentée par une régression totale jusqu’au narcissisme primaire.
MOTS-CLÉS – rêve, régression, manie, hallucinatoire, sommeil, insomnie.
Bernard Chervet – Ttravail de rêve et surdétermination
RÉSUMÉ – Le travail de rêve constitue l’entre-deux temps de l’organisation en deux temps du fonctionnement mental selon le procès de l’après-coup. Sont explorées les implications et visées du système sommeil-rêve : la tentative d’accomplir hallucinatoirement un souhait ; le gardien du sommeil ; le déni temporaire des perceptions des manques ; la fonction anti-traumatique de retenue grâce à la saturation ; la culture de la voie régrédiente et l’inscription de la mémoire (la machine à remonter le temps) ; la régénération libidinale des investissements (le bain de jouvence) ; la protection du soma par la limitation de la régression sensuelle ; l’orientation des investissements sexuels vers le psychisme, le corps et les objets (la lumière du rêve) ; le réveil et l’articulation des vies onirique et érotique. Sous l’égide de l’impératif d’inscription, le système sommeil-rêve utilise la régressivité extinctive des pulsions au service des investissements sexuels, narcissiques et objectaux, des primes de désir.
MOTS-CLÉS – théorie des pulsions, travail de rêve, après-coup, saturation anti-traumatique, régénération libidinale.
Dossier : L’après-coup de la première rencontre
Clarisse Baruch – Les après-coups de la rencontre
RÉSUMÉ – La première rencontre entre le patient et analyste est un moment déterminant, mais tous ne le considèrent pas comme un travail analytique. En institution, il est d’usage que l’analyste futur soit différent du consultant. On y trouve des pratiques diverses, selon qu’on se limite à un entretien, ou qu’on choisisse de les renouveler. Les effets d’après-coup, déterminants dans le travail à venir, impliquent que l’entretien préliminaire a déjà produit un ébranlement positif, sur lequel va se construire le travail.
MOTS-CLÉS – rencontre, entretien, après-coup.
Sarah Bydlowski – Quant au traitement, ce sera pour plus tard. Objet des consultations avec l’enfant et sa famille
RÉSUMÉ – Lors des premières consultations, l’analyste est aux prises avec le fonctionnement familial, dans sa dimension relationnelle et la dynamique des systèmes défensifs de chacun des protagonistes. Le destin des indications se joue sur la possibilité d’instauration d’une temporalité, dans une économie d’investissements qui permette des déplacements des projections et des clivages, et des mouvements d’identification. Dans les bons cas, notre travail d’accueil, voire de transformation des mouvements défensifs, offre les conditions pour que puisse advenir de l’après-coup, grâce au transfert sur l’analyste et l’actualisation de l’infantile parental qui en découle.
MOTS-CLÉS – consultation thérapeutique, après-coup, traumatique, infantile.
Françoise Chaine – L’après-coup en psychosomatique : comment se débrouiller avec ?
RÉSUMÉ – L’investigation psychosomatique est centrée sur l’exploration par l’analyste des capacités fonctionnelles des investissements mentaux des patients, afin de favoriser chez eux l’émergence de nœuds psychosomatiques au cours de la rencontre. Une carence d’expérience vécue de régression sensuelle précoce est à l’origine d’une certaine précarité de leur fonctionnement mental avec rigidification de leurs capacités défensives. L’analyste doit alors rester prudent pour éviter la survenue d’une désorganisation somatique en lieu et place d’un après-coup psychique des échanges.
MOTS-CLÉS – investigation, capacités fonctionnelles, nœuds psychosomatiques, désorganisation somatique.
Christine Bouchard – En après-coup de la rencontre, l’échange inter-analytique
RÉSUMÉ – Ce sont les échanges inter-analytiques – effectifs, imaginés ou anticipés – qui permettent à l’analyste, après le temps consultatif, d’introduire dans sa pensée un débat intérieur nécessaire à l’élaboration des mouvements qui l’ont habité pendant les consultations et de dépasser fixations, postures, mouvements de rétorsion et autres impasses contre-transférentielles.
MOTS-CLÉS – échange inter-analytique, après-coup, temps, écart théorico-pratique, écoute de l’écoute.
Annabelle Tuset – Un après coup qui dure
RÉSUMÉ – Dans cette présentation clinique d’un long processus consultatif au CCTP, nous tenterons de comprendre ce qui s’est joué entre la patiente et son consultant pour que ce travail s’étende sur une année, durée inhabituelle au CCTP. En reprenant précisément la première consultation, nous montrerons comment l’après-coup de celle-ci a engagé un lien transfero-contretransferenciel passionnel rejouant la relation entre la patiente et sa mère. Nous montrerons l’intérêt de l’institution dans ces consultations difficiles. Enfin nous interrogerons les effets de ce long travail consultatif
MOTS-CLÉS – consultation, CCTP, transfert par retournement, tiers.
Panos Aloupis – Le coup des consultations en attendant l’après-coup de la thérapie
RÉSUMÉ – L’auteur discute le texte d’Annabelle Tuset, « Un après-coup qui dure », et fait l’hypothèse, à partir du récit des consultations et à travers le fil de la séduction et de la frustration, que l’identification hystérique au sein de la relation transféro-contre-transférentielle a été un matériau présent et précieux.
MOTS-CLÉS – identification hystérique, séduction, transfert, contre-transfert, après-coup.
RUBRIQUES
Questions théoriques
Pauline Chavanne, Laetitia Petit – L’humour comme processus sublimatoire à l’œuvre dans la musique savante instrumentale
RÉSUMÉ – Nous travaillons sur la question de l’humour dans la musique savante instrumentale et défendons ici la thèse selon laquelle l’humour peut être défini comme forme possible de sublimation. Dans ce corpus musical, l’articulation avec l’humour convoque majoritairement le versant consolateur du surmoi. Nous interrogerons le processus de sublimation dans son articulation avec différents types de négation face à l’épreuve de castration, voire aussi dans sa proximité avec le réel de la mort. En touchant les limites de la sublimation, nous touchons du même coup sa vérité qui ouvre à cette dimension de réel comme impossible de la mort et roc de la castration, le voilement et le dévoilement devenant analyseurs d’un traitement particulier de la mort. En effet, selon que la sublimation cherche à recouvrir ou plutôt à prioriser la dimension de réel, l’humour, dans sa qualité sublimatoire, s’oriente sur le versant du voilement ou du dévoilement de la dimension de réel comme impossible de la mort.
MOTS-CLÉS – sublimation, humour, musique, angoisse, mort.
Gérard Pirlot – La question de l’altérité de l’« Autre » chez Jacques Lacan
RÉSUMÉ – Dans une première partie, l’auteur cerne quelques spécificités de ce que Lacan dénomme l’« autre/Autre », concepts qui pourraient a priori introduire à une réflexion analytique sur l’altérité. Or on peut en douter tant leurs polysémies désignent des réalités bien différentes, voire contradictoires, l’Autre – avec un « A » majuscule – étant en premier lieu conçu comme le lieu du « discours de l’inconscient », jusqu’à être synonyme de ce dernier. Dans un second temps, l’auteur fera l’hypothèse de liens possibles entre l’ombre qu’a pu recéler cet autre au regard de ce que l’on sait de l’histoire infantile de Lacan, et également avec certains de ses concepts – de la paranoïa d’autopunition au stade du miroir, du « discours de l’inconscient » aux ficelles des nœuds borroméens – qui tous évoquent, directement ou indirectement, cet « autre/Autre ».
MOTS-CLÉS – Lacan, Autre, altérité, stade du miroir, biographie.
Technique psychanalytique
Solange Carton – Se perdre à sa manière
RÉSUMÉ – À partir du texte d’Anna Freud, « Perdre et être perdu », Adam Phillips considère l’« être perdu » comme une « capacité négative » (Keats, 1818). À la confluence du texte d’Anna Freud et du « mourir à sa manière » de l’Au-delà du principe de plaisir, l’auteure de cet article envisage, en cheminant à travers différents essais d’Adam Phillips, une capacité à se perdre à sa manière : à la fois comme fantasme et capacité qui, pour un temps, de vie ou de cure, suspend l’attraction par l’objet. Il est proposé qu’Anna Freud invente/retrouve l’expérience infantile de se perdre, sans son père et en perdant de vue qu’elle est objet de désir de son père, avec « le désœuvrement des forces libidinales » qu’elle évoque dans le travail de deuil. Ce qui est mis en tension avec le mouvement qui coupe court vers l’objet dans ses rêves. Un fragment clinique est proposé en analogie. Déviation de la route éperdue vers l’objet, déroute qui goûte pour un temps la vacance d’objet et qui résiste, un moment, au travail à venir, la capacité à se perdre à sa manière pourrait se tenir dans la cure dans ce lieu de friction entre la parole associative et la parole compulsive.
MOTS-CLÉS – capacité négative, être perdu, se perdre, Adam Phillips, Anna Freud.
Marjorie Roques – L’anti-nostalgie et la relation idéale à l’objet dans les problématiques addictives
RÉSUMÉ – Nous interrogeons ici la place de l’objet et le traitement de la perte d’objet dans les problématiques addictives à partir d’une clinique d’anciens toxicomanes à l’héroïne. C’est plus précisément grâce à la notion de dépressivité que nous avancerons une proposition métapsychologique, l’« anti-nostalgie », comme processus de compensation des carences identificatoires et de substitution par l’idéalisation. Nous développerons l’idée selon laquelle la relation d’objet à l’œuvre dans les problématiques addictives serait paroxystique d’un certain type de relation d’objet (relation d’objet idéale versus relation idéale à l’objet). Celle-ci se caractériserait par le non-traitement de la perte, œuvrant au maintien de l’objet et de l’excitation qui en découle, à défaut d’apporter une satisfaction narcissique suffisante.
MOTS-CLÉS – addiction, anti-nostalgie, relation d’objet, idéalisation, identification, dépressivité.
Psychanalyse et sciences humaines
Éric Smadja – Sur le symbolisme et de la symbolisation. Les conceptions de Freud, Durkheim et Mauss
RÉSUMÉ – Nous présentons ici un fragment de l’histoire des idées : celui de l’émergence de la thématique du symbolisme et de la symbolisation, survenue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, qui va révolutionner l’ensemble des sciences humaines et sociales, tout au long du XXe siècle. Nous avons repéré deux chemins épistémologiques bien distincts qui ont conduit trois « Pères fondateurs » à cette découverte commune et à leurs élaborations conceptuelles spécifiques : il s’agit, d’une part, de la psychanalyse avec Freud, d’autre part, de la sociologie et de l’anthropologie avec Durkheim et Mauss. Nous y exposons ainsi leurs conceptions singulières du symbole, du symbolisme et de la symbolisation. Puis nous élaborons un dialogue imaginaire entre eux qui permettra d’identifier quelques inévitables divergences, mais aussi quelques convergences.
MOTS-CLÉS – symbole, symbolisme, symbolisation, psychanalyse, sociologie, anthropologie.
Histoire de la psychanalyse
Baptiste Pouget – Comment hériter ? À propos des Controverses Anna Freud-Melanie Klein
RÉSUMÉ – Les Controverses Anna Freud-Melanie Klein peuvent se lire comme une querelle d’héritage autour de l’œuvre de Freud. La diversité des propositions théoriques contenues dans l’œuvre crée un conflit parmi les héritiers sur les manières de lire, d’interpréter et de faire usage des textes fondateurs, conflit dont chaque psychanalyste hérite à son tour depuis sa place singulière. Melanie Klein se revendique la descendante légitime dans le vis-à-vis qui l’oppose à Anna Freud et soutient que les oppositions qu’elle rencontre sont dues aux résistances des analystes eux-mêmes. Donald W. Winnicott envisage la transmission de la méthode psychanalytique comme l’élément central et potentiellement consensuel de l’héritage. Quant à Anna Freud, elle suit une ligne de pensée sociale de son père en créant de nombreuses institutions tout au long de sa vie. Compte tenu de l’histoire du développement du corpus freudien, l’hypothèse d’un Freud hérétique de lui-même est avancée.
MOTS-CLÉS – héritage, transmission, Controverses, Melanie Klein, Anna Freud, Donald W. Winnicott.