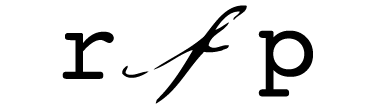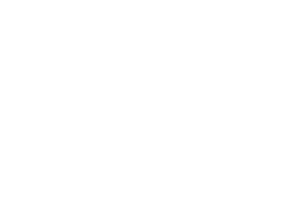Télécharger la programmation 2026 et 2027
Revue française de Psychanalyse
Arguments des thèmes des numéros à venir
Programmation
2026
numéro 3/2026 : Détresse(s)
argument ci-dessous, publié en septembre 2023, date limite d’envoi des manuscrits : 15/11/2025
Télécharger l’argument du 3/2026
numéro 4/2026 : Retrouver la réalité, un but pour la cure ?
argument ci-dessous, publié en février 2025, date limite d’envoi des manuscrits : 15/01/2026
Télécharger l’argument du 4/2026
2027
numéro 1/2027 : De L’avenir d’une illusion
argument ci-dessous, publié en février 2025, date limite d’envoi des manuscrits : 01/07/2026
Télécharger l’argument du 1/2027
numéro 2/2027 : Transferts
argument ci-dessous, publié en août 2025, date limite d’envoi des manuscrits : 01/09/2026
Télécharger l’argument du 2/2027
numéro 3/2027 : Temps mêlés, temps démêlés
argument ci-dessous, publié en octobre 2025, date limite d’envoi des manuscrits : 15/11/2026
Télécharger l’argument du 3/2027