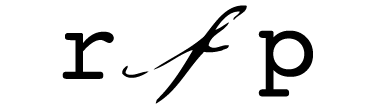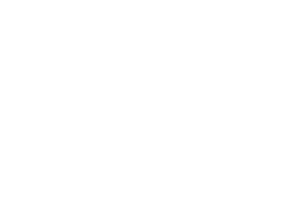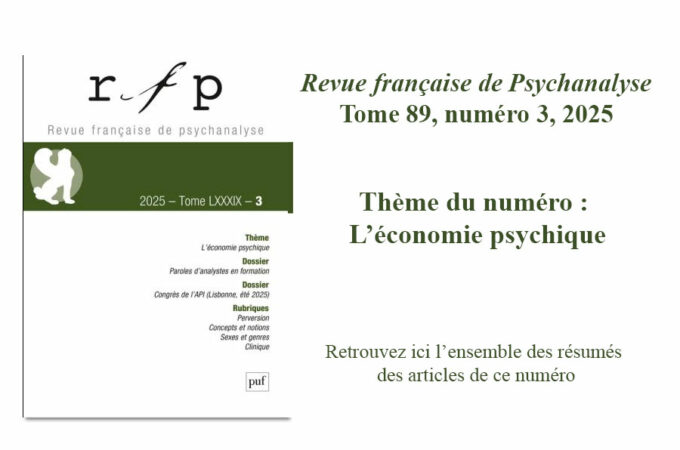
89-3 Résumés des articles
THÈME : L’ÉCONOMIE PSYCHIQUE
Articles originaux
Pascale Devillard – De Lolita à Mme Robbe-Grillet, un certain destin des pulsions
RÉSUMÉ – Vignette clinique illustrant une transformation de l’économie psychique chez une jeune femme dont la ligne de conduite était gouvernée par la destructivité avec en guise de moteur la compulsion de répétition. Disposant de peu d’éléments sur l’enfance de la patiente, sur l’atmosphère familiale, l’analyste peine au travail de rêverie analytique. C’est par le surgissement d’une pensée incidente, l’association avec le roman Mars, de Fritz Zorn, que l’analyste accède à une représentation de toute une partie à laquelle ni elle ni sa patiente n’avaient accès. Au fur et à mesure du travail, la patiente passe d’un masochisme moral à un masochisme érogène.
MOTS-CLÉS – masochisme, destructivité, compulsion de répétition, intrication pulsionnelle, figurabilité, champ analytique.
Johanna Velt – Anna K. : une épopée masochique
RÉSUMÉ – L’auteure reprend ici la question économique du masochisme. En 1924, reprenant la formulation du principe de plaisir et ses rapports à la pulsion de mort, Freud distingue plusieurs formes de masochismes : féminin, érogène et moral. Rosenberg (1999) signale que le principe de plaisir englobe le plaisir masochique et que le noyau masochique érogène permet au bébé de supporter la détresse primaire. Cet ajournement qui permet la satisfaction hallucinatoire du désir et la constitution de la vie fantasmatique de l’individu dépend également de la réponse de l’objet, garant de l’intrication pulsionnelle (Green, 1993). À travers le cas d’une jeune femme présentant des troubles des conduites alimentaires et des somatisations, l’auteure tente d’articuler des liens entre les diverses formes de masochisme à l’œuvre et son fonctionnement économique, entre hystérie et état-limite. Elle retrouve la prééminence du rôle de l’objet dans le transfert, promoteur d’une fonction objectalisante.
MOTS-CLÉS – masochisme, économie psychique, cas limites, hystérie, hypocondrie.
Guy Lavallée – Dynamique du site analytique : sortir des impasses
RÉSUMÉ – Un travail analytique provoque une crise qui doit devenir mutative. Cette crise transformationnelle engage des forces considérables que l’analyste se doit de maintenir supportables pour le patient. Ces forces sont alors mises au service du changement. L’auteur donne des pistes théorico-clinique pour permettre de penser et de mettre en œuvre une réintrication pulsionnelle, clé d’une économie psychique viable. Transformer les stratégies inconscientes autodestructrices suppose que le patient puisse se déplacer dans le transfert et si ça n’est pas possible, c’est à l’analyste de le faire. Il s’agit de tracer un espace transférentiel tridimensionnel ouvert sur l’inconnu, un espace psychique variable qui permet au patient d’être contenu dynamiquement dans ces déplacements jusqu’à une fin d’analyse heureuse, ouverte sur le monde.
MOTS-CLÉS – impasse, transfert latéral, déplacement, espace du site analytique, amour de transfert.
Jessica Tran The – Vers un point de vue économique désexualisé : nouvelles figures de résistance à la psychanalyse
RÉSUMÉ – Aujourd’hui, le point de vue économique de la métapsychologie n’a guère perdu en popularité : qu’il s’agisse de l’approche psychanalytique du traumatisme, ou du dialogue avec les neurosciences, la conception énergétique des processus psychiques reste une référence dans le champ de la psychopathologie contemporaine. Néanmoins, cet engouement pour les perspectives économiques tend à élider toute référence à la nature sexuelle de l’énergie psychique étudiée. Et ce alors que, dès 1905, l’introduction du concept de « libido » par Freud avait exclu du champ de la métapsychologie toute conception désexualisée de l’énergie psychique de la pulsion. Nous pourrons observer que les délibidinalisations contemporaines du point de vue économique viennent insidieusement gommer ce geste freudien fondamentalement subversif, et peuvent relever, en un sens, d’une forme de résistance à la psychanalyse.
MOTS-CLÉS – économique, résistance, traumatisme, libido, neurosciences.
Mario De Vincenzo – Le problème économique du « TDAH »
RÉSUMÉ – À partir des apories théoriques liées à la question de la prévalence du facteur économique et de son articulation ou désarticulation avec le registre de la représentation, l’auteur tente de rendre compte des aléas des processus transformationnels de l’appareil psychique. L’analyse du cas d’un enfant souffrant d’hyperactivité avec troubles de l’attention permet d’analyser la portée défensive de ces symptômes et leurs effets d’évitement du monde interne et des angoisses dépressives. Grâce à l’étude des phénomènes de décharge par l’action et les troubles de l’attention, cette clinique nous aide à mettre en évidence comment la prévalence du registre de l’économique peut être comprise comme un dysfonctionnement de l’appareil à penser. Cette hypothèse sera explorée à la lumière des théories psychanalytiques qui rendent compte des processus de transformation des éléments énergétiques et primaires en représentations secondarisées susceptibles de nourrir l’activité de rêverie et la construction des contenants pour la pensée.
MOTS-CLÉS – TDAH, économie psychique, décharge, troubles de la pensée, transformation.
Textes classiques
Francis Pasche, Michel Renard – Réalité de l’objet et point de vue économique
RÉSUMÉ – [le présent résumé a été rédigé par la rédaction de la revue] – Francis Pasche et Michel Renard explorent la notion de réalité de l’objet et son lien avec le point de vue économique en psychanalyse. Ils discutent la coexistence de concepts apparemment divergents dans l’œuvre de Freud, d’un côté la mémoire atavique (phylogénétique), de l’autre l’hypothèse d’une énergie instinctuelle (pulsionnelle). Ils considèrent que l’approche kleinienne minimise l’importance de l’objet réel (l’objet de la perception) en privilégiant l’objet construit par les seules projections du sujet. En insistant sur l’héritage des schèmes perceptifs, les auteurs soutiennent que l’objet extérieur joue un rôle clé dans la dynamique énergétique et les transformations psychiques. Une « déréalisation » de l’objet au profit des seules projections du sujet, entraînant sa désexualisation, s’écarte de la compréhension freudienne de la vie psychique.
MOTS-CLÉS – objet, perception, schème perceptif, réalité.
André Green – La sexualisation et son économie
RÉSUMÉ – [le présent résumé a été rédigé par la rédaction de la revue] – En partant de la bisexualité psychique, André Green considère que la pensée de Freud concernant la sexualité repose d’une part, sur des considérations relatives à l’espèce (phylogenèse), d’autre part sur le refoulement (lié au processus de civilisation). Ces deux idées du 19e siècle débouchent sur un certain phallocentrisme (complexe paternel) qui se trouve en conflit avec les idéologies contemporaines. Pour sortir de la dualité espèce-culture, Green souligne deux éléments : la quête de jouissance (avec son corrélat, la castration) et la communication (au sens de la quête d’un Autre). La connaissance de l’Autre est intimement liée à la bisexualité psychique (permettant une double identification), et donc à l’Œdipe, mais Green considère que, dès les étapes prégénitales, les vécus psychosexuels diffèrent selon les garçons et selon les filles. De même, l’évolution corporelle à partir de la puberté apparaît plus bouleversante pour la fille que pour le garçon, et la bisexualité psychique reflète moins des réalités biologiques et davantage l’idée que chaque sexe se fait de l’autre. Enfin, le refus de la féminité dans les deux sexes dépasse le seul niveau du sexuel et se réfère au refus d’une relation de dépendance complète et passive à un objet unique : l’objet maternel du début de la vie, lui-même porteur d’une « folie », celle de passion d’amour qui accompagne la grossesse et la maternité.
MOTS-CLÉS – sexualisation, prégénital, bisexualité, objet primaire, folie maternelle.
Denise Braunschweig – Investigation ou consultation le point de vue économique
RÉSUMÉ – Essai de confrontation à partir d’une observation, publiée par P. Marty dans L’ordre psychosomatique, de deux perspectives d’évaluation économique, l’une psychosomatique, l’autre psychanalytique. L’indication thérapeutique qui en résulte semble assez concordante. La méthode psychothérapique à utiliser éventuellement peut exiger une formation spécifique.
MOTS-CLÉS – investigation, psychosomatique, psychanalyse, traumatisme, économie, narcissisme-érotisme, passivité-activité, régression, pensée, désir.
DOSSIER 1 : PAROLES D’ANALYSTES EN FORMATION
Marie-Ange Garcia – Du canapé au divan psychanalytique
RÉSUMÉ – Ce témoignage de l’achat du divan, rédigé initialement à l’occasion d’une journée d’analystes en formation, décrit une « quête ». Celle-ci révèle les mouvements psychiques que suppose l’investissement du divan. En tant qu’objet manifeste du cadre, le cadre sous-tend le contre-transfert de l’analyste sur l’analyse. Ce texte se situe notamment à la croisée d’un début de recherche historique et d’un éclairage plus intime des prémices de la transformation identitaire de l’analyste en formation.
MOTS-CLÉS – divan, histoire, contre-transfert de l’analyste, idéal, formation.
Kathy Parera – Quelle place pour mon divan ?
RÉSUMÉ – Choisir son divan d’analyste s’impose dès lors qu’intégrer le cursus de formation à la psychanalyse devient concret. Jeune analyste, analyste confirmé, analyste en devenir, à chacun son premier divan, et se souvenir du divan des origines ne manque pas de plonger les uns et les autres dans une rêverie sur ce moment inaugural du devenir analyste. Comment choisit-on son divan ? Ce témoignage propose de suivre les pérégrinations d’une analyste en formation dans le choix de son tout premier divan.
MOTS-CLÉS – divan, devenir analyste, espace transitionnel.
Laurent Branchard – Une première analyse pour un cursus, réverbération de transferts ?
RÉSUMÉ – Les dynamiques transféro-contre-transférentielles sont questionnées au regard d’une première analyse participant du cursus de formation. À partir de la situation singulière d’une analyse suspendue à quelques mois sont envisagées les implications des transferts latéraux des deux protagonistes, de changement de cadre de l’analyse, du métacadre de l’analyste en cursus, des éléments de réalité. Plusieurs après-coups permettent des lectures différentes non exclusives entre elles.
MOTS-CLÉS – première analyse, cursus de formation, transferts latéraux, réalité.
Sophie Parrot-Fabre – Entrouvrir la porte : le contre-transfert au travail
RÉSUMÉ – Lucie consulte pour des angoisses invalidantes et de nombreux empêchements dans son quotidien. Une psychothérapie hebdomadaire en face-à-face s’engage, qui évoluera vers un apaisement des symptômes. Cependant, le travail thérapeutique, dont le cadre formel est très investi par la patiente, connaît des moments où patiente et thérapeute sont aux prises avec des formes de répétition, des blocages de la pensée, des mouvements inconscients négatifs, qui paralysent transitoirement le processus. C’est au décours d’un incident de cadre et en appui sur les éprouvés contre-transférentiels de la thérapeute que la thérapie va prendre un nouveau tournant. Une nouvelle dynamique transférentielle se déploie, qui favorise la relance de la pensée. Rêves, souvenirs et affects prennent une autre coloration, qui soutiendra l’élaboration de la souffrance de Lucie.
MOTS-CLÉS – cadre, contre-transfert, répétition, rêves, incident.
Christine Berteau – L’ogresse et le chat, vicissitudes d’un transfert latéral
RÉSUMÉ – Cure en face à face d’une patiente avec une problématique narcissique, consultant pour dépression suite au deuil inélaboré de son précédent analyste. Éléments traumatiques, analité primaire et mode relationnel en collage aux objets marquent la présentation clinique initiale. Après une séparation lors de vacances de l’analyste, un transfert latéral va envahir les séances, mouvement défensif contre l’irruption de motions pulsionnelles d’amour et de haine trop intenses. La tolérance de ce transfert latéral va progressivement conduire à des remaniements processuels inattendus.
MOTS-CLÉS – narcissisme, deuil, addiction, transfert latéral.
DOSSIER 2 : LE PROCHAIN CONGRÈS DE L’API
Elisardo César Merea – Extensions du narcissisme : psychanalyse, guerre, climat.
RÉSUMÉ – [le présent résumé a été rédigé par la rédaction de la revue] – Dans sa conférence, Elisardo César Merea décrit le narcissisme comme une force intégrative initiale de la matière organique (protonarcissisme) qui se prolonge dans la vie psychique des individus et des groupes humains (narcissisme), bien qu’ayant accompli sa fonction. Les guerres peuvent être considérées comme un conflit entre les narcissismes de différents groupes humains, menés par des leaders équivalents au père de la horde primitive et par la violence inhérente aux idéologies (incluant les religions). Des idéologies particulièrement fermées s’apparentent à la folie et à la psychose. Des forces économiques et des pouvoirs étatiques participent également à la répétition des guerres. Dans une conception de « psyché étendue », l’auteur suggère une troisième topique, issue d’une séparation entre le moi et le narcissisme, et une quatrième, incluant la dimension relationnelle de l’être humain comme membre de la cité (polis), par la voie de l’identification. La sauvegarde du climat et de la planète dépend de la capacité de l’être humain à se déprendre d’une position narcissique anthropocentrique arrogante.
MOTS-CLÉS – narcissisme, psychanalyse, cité (polis), guerre, planète.
Stephen Seligman – Tradition et changement dans la théorie psychanalytique : questionnement sur l’infantile
RÉSUMÉ – [le présent résumé a été rédigé par la rédaction de la revue] – Dans sa conférence, l’auteur passe en revue les différentes théories psychanalytiques de l’infantile, à partir des premiers travaux de Freud. Il se pose la question de la centralité de la sexualité et de l’agressivité telles que Freud les a conçues comme pulsions, donc comme des dispositions innées. Il souligne l’importance des influences environnementales et des traumatismes dans le développement psychique. À travers les perspectives de Freud, Klein et Laplanche, il examine les différentes visions de la sexualité infantile et des pulsions, tout en indiquant les limites des généralisations produites rétrospectivement à partir de patients adultes. Il plaide en faveur d’une approche plus souple, intégrant différentes perspectives, ouverte à l’apport des sciences contemporaines et des disciplines adjacentes. Il considère que les ressources réflexives de la psychanalyse lui permettent de renouveler sa pratique en prenant mieux en compte la complexité de l’esprit humain.
MOTS-CLÉS – pulsion, sexualité, infantile, Klein, Laplanche, approche intégrative.
RUBRIQUES
Perversions
Jade Muller, Dolorès Albarracin – Perversion et contre-transfert : malaise dans le regard
RÉSUMÉ – Le regard occupe une place centrale dans les entretiens en face-à-face. Principal support perceptif de la relation thérapeute-patient, il l’investit d’une charge libidinale dont les sources sont autant génitales qu’infantiles. Or il arrive que le regard du patient trouble l’analyste, lorsque sa composante sexuelle est mal refoulée, par exemple dans le cas du transfert pervers. Cet éprouvé corporel dans le contre-transfert peut s’avérer positif dans certains cas, lorsqu’il remet en mouvement une pensée empêchée ; il peut même aider au diagnostic, et relancer une dynamique thérapeutique entravée : tel est l’enjeu de ce travail, basé dans l’analyse de deux rencontres cliniques.
MOTS-CLÉS – contre-transfert, dispositif thérapeutique, regard, perversion, pulsion scopique.
Concepts et notions
Souad Ben Hamed – La régression thérapeutique : de la « panne » de Ferenczi aux solutions de Balint
RÉSUMÉ – Parmi les différents développements théorico-cliniques avancés par Balint, qui sont parfois des prolongements et des approfondissements des théorisations de Ferenczi, mais d’autres fois des innovations mises en place par le grand chercheur et le solide clinicien qu’il était, j’ai choisi la question de la régression et son maniement dans la cure, question qui condense plusieurs autres dont deux essentielles : les trois espaces psychiques et le défaut fondamental. Si nous pouvons déclarer à l’évidence que Balint a beaucoup appris de Ferenczi, aussi bien de ses trouvailles et de ses succès que de ses erreurs et ses échecs, c’est autour de la régression que cette question se montrera à son apogée. Nous verrons qu’ici, essentiellement, on ne peut pas considérer Balint comme celui qui est venu simplement poursuivre le cheminement initié par son maître. La question de la régression et de son maniement reprise par l’élève est un véritable coup de maître !
MOTS-CLÉS – régression, défaut fondamental, ocnophile, philobate, vision binoculaire, amour primaire.
Sexes et genres
Charlotte Collet – La quête du « devenir femme » à l’adolescence. Symptomatologie du refus et de l’éloge du féminin
RÉSUMÉ – À l’adolescence, la quête du « devenir femme » permettrait à la jeune fille de traiter les questions autour de son corps sexué et sexuel – fantasmatique et génital. Toutefois, un panel de symptômes peut y faire opposition, comme chez Inès, jeune patiente de 15 ans, avec son anorexie que j’aborde comme un refus du féminin. Si la lecture de son symptôme prend sens à partir d’un conflit œdipien réactualisé par la puberté, ce refus semble trouver une voie d’élaboration avec le port du voile islamique. J’invite à saisir ce choix comme symptomal, se faisant le revers de ce refus ; un éloge du féminin par sa disposition à voiler le corps-symptôme tout en élevant son être femme pour sa religion musulmane. Ce basculement dans cette quête divine conduit Inès à élever Dieu au rang d’instance titulaire de son devenir femme, dans l’espoir d’un jour, pouvoir « devenir la femme de… ».
MOTS-CLÉS – adolescence, corps, féminin, génitalité, anorexie, voile.
Cliniques
Florianne Gani – Une voix-luciole
RÉSUMÉ – La voix porte des accents de l’archaïque et peut témoigner des temps où l’infans n’a pas encore accédé à la parole. Elle transporte en deçà de la parole des traces de pulsions et d’affects. Irréductible au logos, elle convoque une certaine écoute qui requiert un corps pensant pour entendre et faire résonner la voix. Cette écoute permet d’ouvrir la parole et de faire résonner une voix étouffée. La voix-luciole qualifie une voix qui survit au travail du négatif. Ses intermittences témoignent de la lutte contre la disparition subjective et ses lueurs apparaissent comme des survivances à la négativité. La voix syncopée exprime alors une pulsation et une animation psychique qui révèlent ses tentatives pour se lier tant au monde qu’aux autres et pour habiter son corps. Penser la voix dans son « degré zéro du penser », c’est apprendre à écouter sa charge pulsionnelle et ses oscillations entre déliaison et liaison. La voix-luciole avec ses lueurs et absences témoigne d’une subjectivité écorchée qu’une écoute ajustée enveloppe pour la faire résonner afin qu’elle puisse s’entendre.
MOTS-CLÉS – héritage, transmission, Controverses, Melanie Klein, Anna Freud, Donald W. Winnicott.
Mathieu Julian – Fonctions de la haine et de l’amour dans les souffrances extrêmes à l’adolescence
RÉSUMÉ – Cet article, à partir du récit d’une expérience clinique, est un double témoignage. Premièrement, l’auteur évoque l’articulation étroite, complexe et parfois paradoxale qu’il peut y avoir entre la haine et l’amour. Le propos illustre les différentes expressions possibles de la haine : entre la haine manifeste, à visage découvert, et la haine voilée, entre la haine de l’autre et la haine de soi, entre la haine nécessaire, voire fondamentale, et celle présente dans certaines situations psychopathologiques extrêmes. Deuxièmement, en parlant de sa pratique et de son propre vécu dans le moment clinique, l’auteur montre la double force d’une haine tantôt séparatrice tantôt convocatrice. Être témoin du rapport de l’autre à la haine, c’est être traversé par des affects et des représentations spécifiques comme par la nécessité – parfois – de se positionner dans la cure que ce soit en mots et/ou en actes. Les développements aboutissent à présenter les liens entre la haine, la construction identitaire et le sentiment d’exister.
MOTS-CLÉS – adolescence, subjectivation, extrême, haine, amour.