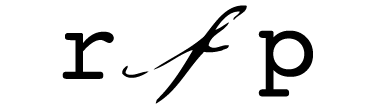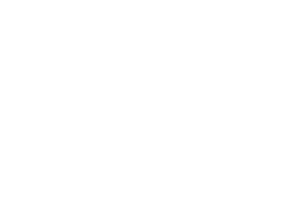Entretien avec Anne Brun
Anne Brun est psychanalyste, membre de la SPP, Professeure émérite de Psychopathologie et Psychologie clinique, université Lumière Lyon 2. Elle a publié de nombreux livres et articles, parmi lesquels :
(2007). Médiations thérapeutiques et psychose infantile, Dunod, 3e édition revue et augmentée (2019). Traduit en espagnol (Herder) ; traduction en cours en portugais (Blücher).
(2018). Aux origines du processus créateur, Érès, « Thema-psy ».
(2016). Brun A., Roussillon R. & Attigui P. (dir.). Évaluation clinique des psychothérapies psychanalytiques, Dunod (Prix Évolution Psychiatrique 2017).
Elle a dirigé également le volume Cliniques de la destructivité chez In Press (2025), ouvrage remarquable par la qualité de ses contributions, et il nous a paru intéressant de l’interroger, à l’occasion de la sortie du nouveau numéro de la Rfp, « L’économie psychique », sur la place du point de vue économique dans ces conjonctures cliniques.
Rfp : Dans le volume, « Cliniques de la destructivité » (In Press, 2025), que vous dirigez, les auteurs abordent les aspects métapsychologiques, cliniques et thérapeutiques de la destructivité dans la clinique contemporaine, avec toute la créativité que ces situations exigent. En quoi, selon vous, le point de vue économique est-il particulièrement pertinent dans ces cliniques ?
Anne Brun : La perspective économique n’est pas évoquée directement par les différents contributeurs du livre, mais elle est toutefois impliquée dans plusieurs contributions, d’abord à l’appui de la théorie freudienne. Dans des textes préalables à sa conception du couple pulsion de vie/pulsion de mort en 1920, Freud évoque la force irrépressible des pulsions primitives et sauvages de l’individu, en soulignant par exemple dans « Considérations actuelles sur la guerre et la mort » (1915), que l’essence la plus profonde de l’homme consiste à tenter de satisfaire les besoins primitifs des motions pulsionnelles, qui ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Plus tard, il définit les expériences au-delà du principe de plaisir (1920) comme l’échec, qui peut être partiel, de l’intrication pulsionnelle entre pulsion de vie et pulsion de mort. Selon cette perspective qui implique le quantitatif, François Ansermet souligne que la destructivité est de l’ordre de la pulsion de mort quand elle dépasse la pulsion de vie.
En 1929, dans Malaise dans la culture, Freud avance l’idée que la civilisation est un domaine privilégié de l’action de la pulsion de mort, suite à la contrainte du sacrifice de la satisfaction des pulsions. « Homo homini lupus », c’est ce que l’actualité mondiale ne cesse de nous montrer, avec la prolifération des conflits armés, des massacres de masse, des génocides : « La pyramide des martyrs obsède la terre » (René Char)…
Laplanche rappelle que, du point de vue énergétique, Freud n’a jamais postulé une « destrudo », soit une énergie propre aux pulsions de mort, mais un monisme énergétique. La pulsion de mort se définit essentiellement par la déliaison qui va prendre différentes formes : elle peut d’abord viser à une décharge totale de l’excitation. Ainsi, pour André Ciavaldini, les auteurs de violence sexuelle peuvent souvent construire a minima une vie sociale et affective, mais ils restent très sensibles aux changements d’environnement provoquant « une surcharge excitative intransformable » : d’où la recherche d’un objet maîtrisable, la victime, et une déliaison de la destructivité, avec passage du sexuel au second plan. Il différencie à la suite de Balier deux voies de la destructivité, les processus de passage à l’acte et de recours à l’acte, justement par le fait que le passage à l’acte emprunte la voie de la décharge d’excitation. André Ciavaldini souligne avec force que ce n’est pas le plaisir qui est recherché dans l’acte d’agression sexuelle, c’est l’arrêt de la montée d’excitation, dans un contexte où la destructivité des auteurs de violences sexuelles est mise au service de leur survie. On pourrait dire que cette excitation incontrôlable, impossible à lier et à maîtriser, rappelle la déliaison du démoniaque décrite dans Au-delà du principe de plaisir.
Ensuite, la pulsion de mort peut être mobilisée pour réduire des tensions et parvenir à un degré zéro de l’excitation. Catherine Chabert s’interroge par exemple sur la place du fantasme de l’enfant mort comme figuration d’une « extinction pulsionnelle radicale », une représentation limite de la perte mélancolique. La douleur du transfert, dans l’expérience analytique, ouvre l’accès à la capacité de souffrir en présence de l’objet. En contraste, elle analyse un autre mouvement d’allure paranoïaque, la projection permettant de défaire les excès de l’autodestruction et de différencier le moi et l’objet via la construction d’une scène masochiste.
Par ailleurs, certains travaux en neurosciences et en physique portant sur l’entropie et l’énergie libre sont convoqués par Thomas Rabeyron qui propose d’éclairer selon cette perspective les notions de pulsion de mort et de destructivité. Ce lien entre physique, psychanalyse et neurosciences décrit la pulsion de mort comme fondamentalement liée au vivant, à la base de ce principe anti-vie dans la vie même. Thanatos apparaît indissociable d’Éros et, comme la pulsion de mort est « apparue du fait que la substance anorganique a pris vie » (Freud, 1920), elle tend aussi à un retour à l’inanimé, à un état originaire anorganique. François Ansermet rappelle que Lacan a pu même soutenir que toute pulsion serait fondamentalement une pulsion de mort. Jean-François Simoneau reprend cette problématique du retour à l’inanimé dans la cure d’une patiente, souffrant de troubles alimentaires graves et lui disant : « La vie me tue à petit feu. » Il décrit « les allers-retours » de l’inanimé et différentes formes de dévitalisation à l’œuvre dans cette cure qui met très fortement à l’épreuve le contre-transfert de l’analyste. On peut à cet égard citer les travaux d’André Green (1983) qui a évoqué le désinvestissement comme la manifestation propre à la destructivité de la pulsion de mort et a soutenu l’hypothèse d’un narcissisme négatif comme aspiration au niveau zéro, expression d’une fonction désobjectalisante qui ne porterait pas seulement sur les objets, mais sur le processus objectalisant lui-même. De même, Christine Desmarez évoque, au-delà de la diversité de la symptomatologie adolescente, les problématiques du suicide ou du désinvestissement, avec la tendance au refuge dans différentes formes de retrait, de manière autodestructrice.
La destructivité apparaît aussi liée à un possible débordement du sujet, envisagé par exemple par Bérangère de Senarclens qui souligne l’importance du facteur économique dans les somatisations et pose la question de savoir si une affection psychosomatique pourrait avoir une fonction défensive face à un moi en risque de débordement psychique. Mais elle envisage aussi la fonction symbolisante du symptôme somatique qui peut porter un éprouvé de mort et pousser l’analysant à s’autodétruire.
De même, chez les auteurs de l’ouvrage précédemment évoqués, aucun ne se limite au point de vue économique : celui-ci ne saurait suffire, il reste toujours partiel, et la plupart des contributeurs abordent d’autres perspectives que le strict point de vue économique qui n’est souvent même pas envisagé.
Rfp : Alors dans quelle mesure, ce point de vue économique est-il insuffisant, et comment doit-il être complété ?
Anne Brun : René Roussillon traite cette question fondamentale et décale la problématique de la destructivité d’une quelconque expression directe de la pulsion de mort sur un versant quantitatif. Il montre que le principal obstacle à l’élaboration des formes de la destructivité consiste en effet à faire de la destructivité une manifestation pure et simple de la pulsion de mort. Cette forme d’expression « directe » de la pulsion implique qu’aucun enjeu inconscient ne vient se mêler à l’expression pulsionnelle, comme s’il n’y avait plus d’écart entre une motion pulsionnelle et sa manifestation. Il souligne que la destructivité ne doit pas être considérée comme la simple expression d’une pulsion destructrice, voire d’une pulsion de mort, car elle n’a plus de dimension latente avec des enjeux inconscients à interpréter. Une approche solipsiste de la destructivité l’enferme donc dans un narcissisme qui efface la place de l’objet ; c’est en réintroduisant la question de la réponse de l’objet à qui la destructivité s’adresse qu’elle devient potentiellement élaborable dans la clinique psychanalytique. Dans le sillage de cette perspective, plusieurs des contributeurs de l’ouvrage ont souligné lors d’un colloque récent qu’ils n’avaient pas ressenti la nécessité de passer par le concept de pulsion de mort pour évoquer leurs cliniques de la destructivité.
Dans la pulsion de mort, il ne s’agit donc plus ici du « retour à l’état antérieur », comme l’écrit Freud, mais, comme le propose René Roussillon (1999), « du retour de l’état antérieur » clivé, retour des agonies primitives (Winnicott). La pulsion de mort correspondrait ainsi à la répétition d’expériences primitives de mort psychique, expériences de retrait de la subjectivité pour pouvoir survivre à ces expériences destructrices. Le but de la pulsion de mort ainsi redéfini serait alors moins la destructivité en soi que la tentative d’intégrer ce qui ne l’est pas, autrement dit de symboliser ces expériences. Une autre façon d’envisager la pulsion de mort serait alors de la définir comme une « compulsion à l’intégration du clivé ».
Mais les pulsions de mort ne sont pas seulement tournées vers l’intérieur et une partie de l’ouvrage aborde les pulsions d’agression qui vont se manifester par des comportements violents. Ainsi Maurice Berger aborde-t-il des formes de destructivité qui conduisent à des actes d’une violence extrême et même au meurtre chez des enfants et des adolescents. S’il évoque dans les modalités de prise en charge la mise en place de dispositifs contenants, ce qui pourrait renvoyer à une perspective économique dans cette contenance des pulsions de violence, il décrit fondamentalement la nécessité d’une psychothérapie intensive centrée sur une « mise en représentation de vécus archaïques impensables », face à des enfants et adolescents qui ont tous subi des traumatismes graves durant leur petite enfance. Cette perspective s’accorde avec celle défendue par René Roussillon.
Toujours dans le registre des comportements violents, Olivier Douville a assuré des suivis psychologiques d’enfants et d’adolescents confrontés à la guerre, alternativement soldats et victimes, qui évoquent leurs meurtres de frères, de pères ou de voisins… Il s’agit dans un tel contexte bien moins de supprimer la vie d’autrui que de renverser tous les tabous anthropologiques d’une société, avec des destructions massives des systèmes de filiation et de leur rapport à l’ancêtre : si l’enfant résiste, il est sacrifié. Toute l’humanisation est détruite. L’enfant soldat devient un tueur enserré dans le ravage mécanique de la pulsion de mort, au sein d’un champ imaginaire pétrifié, animé par un affect de pure vengeance associé au sentiment d’indestructibilité : l’autre est réduit à une image et le sujet à une sensation ou à un affect.
Sur cette thématique de la guerre, François Ansermet décrit l’un des paradoxes de la destructivité à partir d’un constat de Freud (1932) répondant à Einstein sur la question de savoir « Pourquoi la guerre ? » : « L’être vivant préserve pour ainsi dire sa propre vie en détruisant celle d’autrui. » Ainsi, paradoxalement, cette tendance à la destructivité pourrait être comprise comme une déviation mortifère d’une tendance à l’autoconservation.
Rfp : Au-delà de tous ces aspects destructeurs, l’ouvrage Cliniques de la destructivité aborde-t-il des aspects créatifs liés à la destructivité ?
Anne Brun : Oui, comme l’indique le titre d’un ouvrage de Didier Anzieu : Créer/détruire ! Catherine Chabert met ainsi en évidence le caractère paradoxal de la pulsion de mort qui, « au-delà de ses potentialités de destruction, peut assurer une fonction d’urgence pour la sauvegarde narcissique de l’individu ». Dans cette perspective, elle évoque une cure à la suite d’un acting suicidaire où il s’agit de mourir pour survivre. Par ailleurs, François Ansermet a aussi défini un aspect de la pulsion de mort par l’idée de « tout détruire pour tout reconstruire ».
Une partie de l’ouvrage met en lumière cette intrication essentielle entre destructivité et création. Alain Ferrant traite cette question à partir de la problématique de l’emprise qui oscille entre destructivité avec asservissement de l’autre semblable, et travail de création, tant travail de création de soi que travail de création en général. Il donne un rôle essentiel aux autoérotismes dont la défaillance active la destructivité. Il décrit notamment à partir d’œuvres cinématographiques et littéraires, et aussi des récentes histoires publiées de viols de mineurs par des séducteurs célèbres, tant les processus mortifères de la relation d’emprise que les origines possibles de ces comportements d’emprise très destructrice.
Une autre perspective originale revient à Adrien Pichon qui présente le lien indissociable entre création/destruction dans la syllogomanie (ou syndrome de Diogène). Il dégage le potentiel créatif de ces cliniques dans les solutions trouvées par ces patients pour survivre à ce qui n’a pas eu lieu avec l’objet, à ce qui les a voués à la décomposition, à l’ordure, au pourrissement. Le pôle « créatif » de la syllogomanie renvoie à une tentative de conservation et de régénération et le pôle « destructif » au pourrissement et à l’inertie. Ce qu’Adrien Pichon nomme la mélancolisation environnementale permet de représenter la pétrification du lien premier dans cette tentative de minéralisation de l’environnement : la syllogomanie correspondrait à la tentative de composer et recomposer sans cesse un monde psychique en décomposition.
Dans un tout autre contexte, la problématique du genre en clinique adolescente, André Ciavaldini pose la question de savoir si générer son propre genre peut être considéré comme une tentative de création, voire d’autocréation de soi, ou au contraire comme une attaque destructrice de l’être adolescent. Il montre à quel point le refus adolescent de l’assignation sexuée est une forme actuelle de revendication libertaire et comment l’auto-assignation de genre peut aussi constituer une tentative de création d’un soi idéalisé, dans une tentative de réparation des failles de l’objet premier.
Pour finir, je pourrais dire que ce livre Cliniques de la destructivité traite d’une évolution des paradigmes de la pulsion de mort et de la destructivité, renouvelés dans la clinique et la théorie des psychanalystes contemporains et généralement abordés selon d’autres perspectives que le strict point de vue économique.