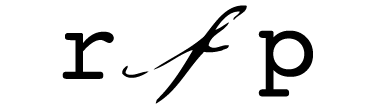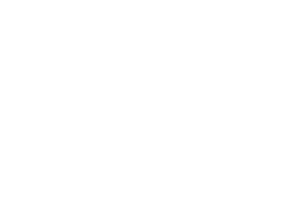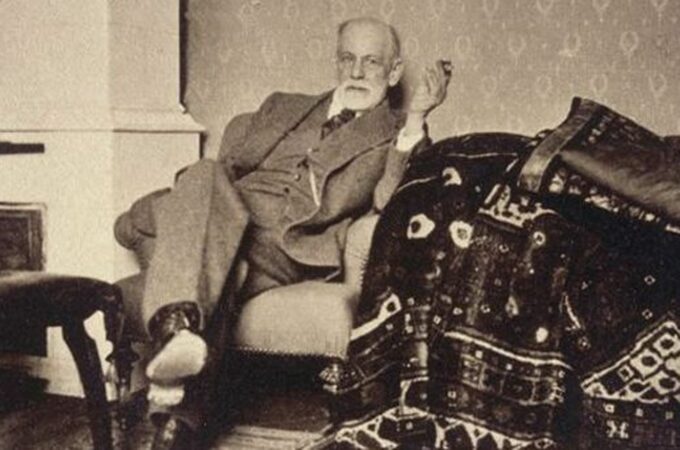
Freud dans le texte
FREUD DANS LES TEXTES | Numéro 2025-2
Sigmund Freud, Remarques sur la théorie et la pratique de l’interprétation du rêve
(1923c [1922]/1991) OCF-P, XVI, Paris. EXTRAIT
VIII
Il se pourrait bien que les rêves dans une psychanalyse réussissent à amener au jour le refoulé dans une plus large mesure que les rêves en dehors de cette situation. Mais cela ne peut être démontré car les deux situations ne sont pas comparables ; l’exploitation dans l’analyse est une visée qui à l’origine se situe tout à fait loin du rêve. Par contre il ne peut faire aucun doute que, à l’intérieur d’une analyse, beaucoup plus du refoulé est promu au jour en rattachement à des rêves qu’avec l’aide des autres méthodes ; pour ce rendement supérieur, il doit forcément y avoir un moteur, une puissance inconsciente qui, pendant l’état de sommeil, est mieux à même qu’habituellement d’apporter un soutien aux visées de l’analyse. Or on ne peut guère pour cela avoir recours à un autre facteur que la docilité issue du complexe parental de l’analysé envers l’analyste, donc la part positive de ce que nous appelons le transfert, et en fait, dans de nombreux rêves qui ramènent de l’oublié et du refoulé, il ne se laisse découvrir aucun autre souhait inconscient auquel on pourrait imputer la force de pulsion pour la formation du rêve. Si donc quelqu’un veut affirmer que la plupart des rêves exploitables dans l’analyse sont des rêves de complaisance et doivent leur apparition à la suggestion, il n’y a là, du point de vue de la théorie analytique, rien à objecter. Il ne me reste alors plus qu’à renvoyer aux discussions de mes « Leçons d’introduction[1] », où est traité le rapport du transfert à la suggestion et où est exposé combien la reconnaissance de l’action de la suggestion, au sens où nous l’entendons, porte peu préjudice à la fiabilité de nos résultats.
Je me suis occupé dans l’écrit « Au-delà du principe de plaisir[2] » du problème économique de savoir comment les expériences vécues, pénibles à tout point de vue, de la période sexuelle infantile-précoce peuvent réussir à se forcer une voie vers n’importe quelle sorte de reproduction. Il me fallut leur concéder, dans la contrainte de répétition, une pulsion vers le haut extraordinairement forte qui maîtrise le refoulement, lequel, au service du principe de plaisir, pèse sur elles, mais cependant pas avant que le « travail de la cure allant à sa rencontre n’ait relâché le refoulement[3] ». Il faudrait intercaler ici que c’est le transfert positif qui fournit cette aide à la contrainte de répétition. Il s’est ainsi constitué une alliance de la cure avec la contrainte de répétition, alliance qui se dirige d’abord contre le principe de plaisir, mais veut dans sa visée dernière ériger le règne du principe de réalité. Comme je m’en suis expliqué en cet endroit, il n’arrive que trop fréquemment que la contrainte de répétition se libère des obligations de cette alliance et ne se contente pas du retour du refoulé sous la forme d’images de rêve.
IX
Pour autant que je sache à ce jour, les rêves dans la névrose traumatique fournissent l’unique exception effective, les rêves de punition l’unique exception apparente à la tendance du rêve à accomplir le souhait. Dans ces derniers s’établit l’état de fait remarquable qu’à proprement parler rien des pensées de rêve latentes n’est accueilli dans le contenu de rêve manifeste, mais qu’à leur place vient quelque chose de tout à fait autre, qui doit être décrit comme une formation réactionnelle contre les pensées de rêve, comme récusation et pleine opposition envers elles. Une telle intervention contre le rêve, on ne peut l’attribuer qu’à l’instance·du·moi critique et il faut de ce fait admettre que celle-ci, stimulée par l’accomplissement·de·souhait inconscient, s’est temporairement réinstaurée, même pendant l’état de sommeil. Elle aurait pu aussi réagir par le réveil à ce contenu de rêve non souhaité, mais elle trouva dans la formation du rêve de punition une voie pour éviter la perturbation du sommeil.
Ainsi par ex. pour les rêves bien connus du poète Rosegger, que je mentionne dans « L’interprétation du rêve[4], il faut supposer un texte réprimé au contenu orgueilleux, vantard, mais le rêve effectif lui reprochait : « Tu es un compagnon tailleur incapable. » Il serait naturellement absurde de rechercher une motion de souhait refoulée comme force de pulsion de ce rêve manifeste ; on doit se contenter de l’accomplissement de·souhait de l’autocritique.
Le déconcertement devant un tel mode de construction du rêve s’atténue si on considère combien il est courant, pour la déformation de rêve au service de la censure, de mettre à la place d’un élément pris isolément quelque chose qui, en un sens quelconque, est son contraire ou son opposé. À partir de là, il n’y a qu’un court chemin jusqu’au remplacement d’un fragment caractéristique du contenu de rêve par une contradiction exerçant une défense, et un pas de plus conduit au remplacement de tout le contenu de rêve choquant par le rêve de punition. De cette phase intermédiaire de la falsification du contenu manifeste, j’aimerais communiquer un ou deux exemples caractéristiques.
Tiré du rêve d’une jeune fille qui a une forte fixation au père et qui s’exprime difficilement dans l’analyse : elle est assise dans la chambre avec une amie, habillée seulement d’un kimono. Un monsieur entre, devant lequel elle se sent gênée. Mais le monsieur dit : « Tiens, c’est la jeune fille que nous avons une fois déjà vue si joliment habillée. » – Le monsieur, c’est moi et, en remontant plus loin, le père. De ce rêve, il n’y a cependant rien à tirer, tant que nous ne nous décidons pas à remplacer dans le discours du monsieur l’élément le plus important par son opposé :« C’est la jeune fille qu’une fois j’ai déjà vue déshabillée et alors si jolie. » Enfant, entre trois et quatre ans, elle a dormi pendant un certain temps dans la même chambre que son père, et tous les indices montrent qu’elle avait coutume alors de se découvrir dans son sommeil pour plaire au père. Le refoulement, depuis lors, de son plaisir-désir d’exhibition motive aujourd’hui son attitude renfermée dans la cure, son déplaisir à se montrer dévoilée.
Tiré d’une autre scène du même rêve : elle lit sa propre histoire de malade, sous forme imprimée. Il s’y trouve qu’un jeune homme assassine sa bien-aimée – cacao –, cela appartient à l’érotisme anal. Le dernier point est une pensée qu’elle a dans le rêve à la mention du cacao. – L’interprétation de ce fragment de rêve est encore plus difficile que celle du précédent. On apprend finalement qu’elle a lu avant de s’endormir l’« Histoire d’une névrose infantile[5] » (cinquième suite de la Sammlung kleiner Schriften), dont une observation de coït des parents, réelle ou fantasiée, constitue le centre. Cette histoire de malade, elle l’a une fois déjà auparavant mise en relation avec sa propre personne, indice non isolé que chez elle aussi une telle observation entre en ligne de compte. Le jeune homme qui assassine sa bien-aimée est de fait une nette allusion à la conception sadique de la scène de coït, mais l’élément suivant, le cacao, s’en éloigne beaucoup. Au cacao, tout ce qu’elle sait associer c’est que sa mère a l’habitude de dire que le cacao donne mal à la tête, par d’autres femmes aussi elle prétend avoir entendu dire la même chose. Du reste, elle s’est pendant un certain temps identifiée avec la mère précisément par de tels maux de tête. Je ne peux trouver à vrai dire aucune autre connexion entre les deux éléments du rêve que par l’hypothèse qu’elle veut faire diversion aux déductions tirées de l’observation de coït. Non, cela n’a rien à voir avec la procréation. Les enfants viennent de quelque chose que l’on mange (comme dans le conte), et la mention de l’érotisme anal qui, dans le rêve, a l’aspect d’une tentative d’interprétation, complète par l’adjonction de la naissance anale la théorie infantile appelée à l’aide.
X
Il arrive parfois que l’on s’étonne de voir apparaître le moi du rêveur deux ou plusieurs fois dans le rêve manifeste, une fois en propre personne et les autres fois caché derrière d’autres personnes. L’élaboration secondaire a de toute évidence déployé ses efforts pendant la formation du rêve pour en finir avec cette multiplicité du moi qui ne rentre dans aucune situation scénique, mais par le travail d’interprétation elle est réinstaurée. Elle n’est pas, en soi, plus remarquable que l’occurrence du moi sous plusieurs formes dans une pensée vigile, notamment lorsque le moi s’y décompose en sujet et objet, s’oppose comme instance observante et critique à l’autre part, ou compare son être présent à un être remémoré, passé, qui fut aussi un jour moi. Ainsi par ex. dans les phrases : « Quand je pense à ce que j’ai fait à cet homme » et « quand je pense que je fus aussi un jour un enfant. » Mais que toutes les personnes qui surviennent dans le rêve doivent avoir valeur de parties clivées et de représentances du moi propre, c’est ce que je voudrais repousser comme une spéculation sans contenu et sans justification. Il nous suffit de maintenir que la séparation entre le moi et une instance observante, critiquante, punissante (idéal du moi) entre aussi en ligne de compte pour l’interprétation du rêve.
[1] OCF.P, XIV : XXVIIIe leçon. La thérapie analytique.
[2] OCF.P, XV, p. 288 sq.
[3] OCF.P, XV, p. 290.
[4] OCF.P, IV, p. 523-525.
[5] OCF.P, XIII.