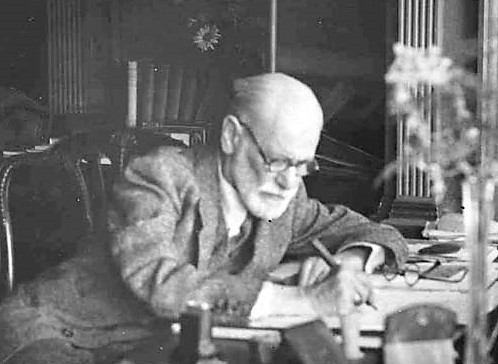
Freud dans le texte
Numéro 2021-4 « Cris et chuchotements »
L’expérience vécue de satisfaction
Lettre à Wilhelm Fliess, Chap. 11 : 625-627, Paris, Puf, 2006.
Le remplissage des neurones nucléaires en ψ aura pour conséquence une propension à l’éconduction, une poussée urgente qui se décharge en direction d’une voie motrice. D’après l’expérience, c’est alors la voie menant à la modification interne (expression des émotions, cris, innervations vasculaire) qui est empruntée en premier. Mais toute éconduction de ce genre n’aboutira pas à un délestage, ainsi que nous l’avons exposé au début, puisque la réception du stimulus endogène persiste néanmoins et rétablit la tension ψ. La suppression du stimulus n’est ici possible que par une intervention qui élimine pour un moment la déliaison-Qή à l’intérieur du corps, et cette intervention exige une modification dans le monde extérieur (introduction de nourriture, proximité de l’objet sexuel), celle-ci ne pouvant se produire en tant qu’action spécifique que par des voies déterminées. L’organisme humain est tout d’abord incapable d’amener l’action spécifique. Cette action se produit au moyen d’une aide étrangère, quand une personne ayant de l’expérience est rendue attentive à l’état de l’enfant du fait de l’éconduction qui emprunte la voie de la modification interne. Cette voie d’éconduction acquiert ainsi une fonction secondaire extrêmement importante, celle de se faire comprendre, et le désaide initial de l’être humain est la source originaire de tous les motifs moraux.
Quand la personne qui apporte son aide a effectué dans le monde extérieur, pour la personne en désaide, le travail de l’action spécifique, cette dernière est en mesure, au moyen de dispositifs réflexes, d’accomplir directement, à l’intérieur de son corps, l’opération nécessaire à la suppression du stimulus endogène. L’ensemble constitue alors une expérience vécue de satisfaction, qui a les conséquences les plus décisives pour le développement fonctionnel de la personne. Il se passe en effet trois sortes de choses dans le système ψ. 1. Il s’opère une éconduction durable et il est mis ainsi fin à la poussée urgente qui avait engendré du déplaisir en ω, 2. Survient dans le pallium l’investissement d’un neurone (ou de plusieurs neurones), qui correspond à la perception d’un objet, 3. En d’autres points du pallium arrivent les informations relatives à l’éconduction du mouvement réflexe déclenché qui se rattache à l’action spécifique. Il se forme alors un frayage entre ces investissements et les neurones nucléaires.
Les informations relatives à l’éconduction réflexe se produisent du fait que chaque mouvement, par ses conséquences annexes, est l’occasion de nouvelles excitations sensitives (de la peau et des muscles), qui ont pour résultat en ψ une « image de mouvement ». Le frayage se forme cependant d’une façon qui permet d’avoir une vue plus pénétrante du développement de ψ. Jusqu’ici nous avons pris connaissance de l’influence exercée sur les neurones ψ par φ et par les conductions endogènes ; mais les différents neurones ψ étaient coupés les uns des autres par des barrières de contact pourvues de fortes résistances. Or il y a une loi fondamentale, l’association par simultanéité, qui est à l’œuvre lors de la pure activité ψ, lors de la remémoration reproductive, et qui est le fondement de toutes les liaisons entre les neurones ψ. L’expérience nous apprend que la conscience, donc l’investissement quantitatif d’un neurone ψ α, passe à un second, β, dès lors que α et β ont été investis simultanément à partir de φ (ou d’ailleurs). Une barrière de contact a donc été frayée par l’investissement simultané de α et β. Dans les termes de notre théorie, il s’ensuit qu’une Qή venue d’un neurone passe plus facilement dans un neurone investi que dans un neurone non investi. L’investissement du second neurone a donc le même effet que l’investissement plus fort du premier. L’investissement s’avère ici une fois encore équivalent au frayage pour le cours-Qή.
Nous prenons donc connaissance ici d’un second facteur important concernant la direction du cours-Qή. Une Qή dans le neurone α n’ira pas seulement dans la direction de la barrière la mieux frayée, mais aussi dans celle de la barrière investie du côté opposé. Les deux facteurs peuvent se soutenir l’un l’autre ou éventuellement agir l’un contre l’autre.
Du fait de l’expérience vécue de satisfaction, un frayage a donc lieu entre deux images mnésiques et les neurones nucléaires qui sont investis dans l’état de poussée urgente. Avec l’éconduction de satisfaction, la Qή s’écoule sans doute aussi à partir des images mnésiques. Avec la réapparition de l’état de poussée urgente ou de souhait, l’investissement passe aussi aux deux souvenirs et le vivifie. Sans doute est-ce l’image mnésique de l’objet qui est tout d’abord touchée par la vivification du souhait.
Je ne doute pas que cette vivification du souhait a tout d’abord le même résultat que la perception, à savoir une hallucination. Si là-dessus l’action réflexe est enclenchée, il ne manquera pas d’y avoir de la déception.
Numéro 2021-3 De l’envie
L’inquiétant (extrait)
OCF.P, XV: 147-188, Paris, Puf, 1996.
[…]L’une des formes de superstition les plus inquiétantes et les plus répandues est l’angoisse du « mauvais œil », qui a fait l’objet d’un traitement approfondi par l’ophtalmologiste hambourgeois S. Seligmann. La source à laquelle puise cette angoisse semble n’avoir’ jamais été méconnue. Celui qui possède quelque chose de précieux et pourtant fragile a peur de l’envie des autres en projetant sur eux cette envie qu’il aurait éprouvée dans le cas inverse. On trahit de telles motions par le regard, même quand on leur refuse l’expression verbale, et quand quelqu’un tranche sur les autres par des caractéristiques frappantes, d’un genre qu’on n’aurait pas particulièrement souhaité, on présume de lui que son envie atteindra une intensité particulière et alors on transposera aussi cette intensité en action. On redoute donc une intention secrète de nuire et, sur la foi de certains indices, on suppose que cette intention a aussi la force à sa disposition.
La féminité (extrait)
Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, XXXIIIe leçon, OCF.P, XIX : 195-219, Paris, Puf, 1995.
Vous voyez, nous attribuons à la femme aussi un complexe de castration. Avec de bonnes raisons, mais il ne peut avoir le même contenu que chez le garçon. Le complexe de castration apparaît chez celui-ci une fois qu’il a appris, par la vue d’un organe génital féminin, que le membre qu’il tient en si haute estime ne doit pas nécessairement aller de pair avec le corps. Il se souvient alors des menaces qu’il s’est attirées en s’occupant de son membre, il commence à leur accorder créance et il tombe dès lors sous l’influence de l’angoisse de castration, qui devient le moteur le plus puissant de son développement ultérieur. Le complexe de castration de la fille, lui aussi, est inauguré par la vue de l’autre organe génital. Elle note aussitôt la différence et aussi – il faut l’avouer – sa signification. Elle se sent gravement lésée, exprime souvent qu’elle voudrait « avoir aussi quelque chose comme ça » et succombe alors à l’envie de pénis, qui laissera derrière elle des traces indélébiles dans son développement et dans la formation de son caractère et qui, même dans le cas le plus favorable, ne pourra être surmontée sans une grande dépense psychique. Que la fille reconnaisse le fait de son défaut de pénis ne veut pas dire pour autant qu’elle s’y soumettre facilement. Au contraire, elle reste encore longtemps attachée au souhait d’acquérir aussi quelque chose comme ça, elle croit à cette possibilité jusqu’à un âge invraisemblablement avancé et, encore en des temps où le savoir de ce qu’est la réalité a depuis longtemps mis au rebut l’accomplissement de ce souhait comme étant inaccessible, l’analyse peut mettre en évidence que ce souhait est resté conservé dans l’inconscient et qu’il a gardé un investissement d’énergie considérable. Le souhait de finir par acquérir quand même le pénis tant désiré peut encore apporter sa contribution aux motifs qui poussent la femme mûre à entrer en analyse, et ce qu’elle peut raisonnablement attendre de l’analyse, par exemple la capacité d’exercer une profession intellectuelle, peut souvent être reconnu comme un avatar sublimé de ce souhait refoulé.
On ne peut pas vraiment douter de la significativité de l’envie de pénis. Entendez comme un exemple d’injustice masculine l’affirmation que l’envie et la jalousie jouent, dans la vie d’âme des femmes, un rôle plus grand que chez les hommes. Non que ces particularités se trouvent absentes chez les hommes ou que, chez les femmes, elles n’aient pas d’autre racine que l’envie de pénis, mais nous penchons à attribuer ce plus chez les femmes à cette dernière influence. Mais chez certains analystes est apparu le penchant à rabaisser dans sa significativité cette première vague d’envie de pénis lors de la phase phallique. Ils estiment que ce qu’on trouve de cette position chez la femme est, pour l’essentiel, une formation secondaire qui s’est produite à l’occasion de conflits ultérieurs, par régression à cette motion infantile-précoce. Il y a là un problème général de la psychologie des profondeurs. Dans beaucoup de positions pulsionnelles pathologiques – ou même seulement inhabituelles –, par exemple dans toutes les perversions sexuelles, la question est de savoir quelle part de leur force doit être attribuée aux fixations infantiles-précoces, et quelle part à l’influence d’expériences vécues et de développements ultérieurs. Il s’agit là presque toujours de séries complémentaires, telles que nous en avons fait l’hypothèse dans la discussion sur l’étiologie des névroses. Les deux facteurs se répartissent dans cette causation en des proportions variables ; un moins d’un côté est compensé par un plus de l’autre. L’infantile apporte dans tous les cas la direction, il n’emporte pas toujours la décision, même s’il le fait souvent. Précisément dans le cas de l’envie de pénis, je voudrais prendre résolument parti pour la prépondérance du facteur infantile.
La découverte de sa castration est un tournant dans le développement de la fille. Trois directions de développement en partent ; l’une conduit à l’inhibition sexuelle ou la névrose, la deuxième à la modification du caractère au sens d’un complexe de masculinité, la dernière enfin à la féminité normale. Sur toutes trois, nous avons appris pas mal de choses, même si ce n’est pas tout. Le contenu essentiel de la première est que la petite fille, qui avait jusqu’alors vécu de façon masculine, sachant se procurer du plaisir par l’excitation de son clitoris et mettant cette activité en relation avec ses souhaits sexuels, souvent actifs, qui concernaient la mère, se laisse gâcher la jouissance de sa sexualité phallique par l’influence de l’envie de pénis. Atteinte dans son amour de soi par la comparaison avec le garçon tellement mieux doté, elle renonce à la satisfaction masturbatoire au niveau du clitoris, rejette son amour pour la mère et, ce faisant, il n’est pas rare qu’elle refoule une bonne part de ses tendances sexuelles en général. L’acte de se détourner de la mère ne s’effectue sans doute pas d’un seul coup, car la fille prend d’abord sa castration pour un malheur individuel, ce n’est que progressivement qu’elle l’étend à d’autres êtres féminins, finalement à la mère aussi. Son amour avait concerné la mère phallique ; avec la découverte que la mère est castrée, il devient possible de la laisser tomber comme objet d’amour, de sorte que les motifs d’hostilité accumulés depuis longtemps prennent le dessus. Cela veut donc dire que, par la découverte de l’absence de pénis, la femme est dévalorisée pour la fille tout comme pour le garçon, et plus tard peut-être pour l’homme.
Vous savez tous quelle significativité étiologique prééminente nos névrosés accordent à leur onanisme. Ils le rendent responsable de tous leurs maux et nous avons grand-peine à les amenés à croire qu’ils sont dans l’erreur. Mais à vrai dire, nous devrions leur concéder qu’ils sont dans leur droit, car l’onanisme est l’agent d’exécution de la sexualité enfantine, le développement défectueux de celle-ci étant en effet ce dont ils souffrent. Mais les névrosés incriminent le plus souvent l’onanisme du temps de la puberté ; l’onanisme de la prime enfance, qui est en réalité celui qui compte, ils l’ont le plus souvent oublié. Je voudrais avoir un jour l’occasion de vous exposer de façon circonstanciée quelle importance acquièrent, pour la névrose ultérieure ou le caractère de l’individu, tous les détails factuels de l’onanisme précoce, à savoir s’il a été découvert ou non, comment les parents l’ont combattu ou toléré, si l’individu a réussi lui-même à le réprimer. Tout cela a laissé derrière soi dans son développement des traces impérissables. Mais je suis plutôt content de ne pas avoir à le faire ; ce serait une tâche longue et ardue, et à la fin, vous me mettriez dans l’embarras, car vous exigeriez très certainement de moi des conseils pratiques sur la façon dont on doit se comporter, en tant que parent ou éducateur, envers l’onanisme des petits enfants. Dans le développement des filles, que je vous expose, vous voyez maintenant un exemple montrant que l’enfant fait elle-même des efforts pour se libérer de l’onanisme. Mais elle n’y réussit pas toujours. Là où l’envie de pénis a éveillé une forte impulsion contre l’onanisme clitoridien et où celui-ci ne veut quand même pas céder s’engage un violent combat de libération, dans lequel la fille prend en quelque sorte elle-même le rôle de la mère à présent destituée et exprime tout son mécontentement envers le clitoris jugé inférieur en s’opposant à la satisfaction trouvée en lui. Bien des années plus tard encore, alors que l’activité onanique est réprimée depuis longtemps, un intérêt persiste, qu’il nous faut interpréter comme une défense contre une tentation qui continue à être encore redoutée. Il se manifeste dans l’émergence d’une sympathie pour des personnes chez qui on suppose des difficultés analogues, il intervient comme motif pour contracter un mariage, il peut même déterminer le choix du partenaire dans le mariage ou dans l’amour. La liquidation de la masturbation de la prime enfance n’est vraiment pas chose facile ou indifférente.
Avec l’abandon de la masturbation clitoridienne, il y a renoncement à une part d’activité. La passivité a maintenant le dessus ; l’acte de se tourner vers le père s’effectue principalement à l’aide de motions pulsionnelles passives. Vous reconnaissez qu’une telle vague de développement, qui écarte du chemin l’activité phallique, aplanit le terrain pour la féminité. S’il n’y a pas alors trop de choses qui se perdent par refoulement, cette féminité peut prendre une tournure normale. Le souhait avec lequel la fille, se tournant vers le père, s’adresse à lui est sans doute, à l’origine, le souhait visant le pénis que la mère lui a refusé et qu’elle attend maintenant du père. Mais la situation féminine n’est instaurée que lorsqu’au souhait .visant le pénis se substitue celui visant l’enfant, l’enfant venant donc à la place du pénis, selon une ancienne équivalence symbolique. Il ne nous échappe pas qu’antérieurement déjà, dans la phase phallique non perturbée, la fille avait souhaité avoir un enfant ; c’était bien là le sens de son jeu avec les poupées. Mais ce jeu n’était pas, à vrai dire, l’expression de sa féminité, il était au service de l’identification à la mère, dans l’intention de remplacer la passivité par l’activité. Elle jouait à la mère et la poupée c’était elle-même ; elle pouvait dès lors faire avec l’enfant tout ce que la mère avait coutume de faire avec elle. C’est seulement avec l’arrivée du souhait de pénis que l’enfant-poupée devient un enfant reçu du père et désormais, le plus fort des buts souhaités par la femme. Le bonheur est grand quand ce souhait d’enfant trouve, un jour à venir, son accomplissement réel, mais tout particulièrement quand l’enfant est un petit garçon qui apporte avec lui le pénis tant désiré. Dans l’assemblage « un enfant reçu du père », il est fort fréquent que l’accent porte sur l’enfant, laissant le père non accentué. Ancien l’ancien souhait masculin de posséder le pénis transparaît encore à travers la féminité achevée. Mais peut-être devrions-nous reconnaître ce souhait de pénis plutôt comme un souhait féminin par excellence.
Numéro 2021-2 Traduire
L’interprétation du rêve (1900)
OCF-P, IV, p. 665-666, Paris, Puf, 2003
L’inconscient et la conscience. La réalité
Si nous y regardons de plus près, l’hypothèse qui nous a été suggérée par les discussions psychologiques des sections précédentes, ce n’est pas l’existence de deux systèmes près de l’extrême motrice de l’appareil, mais bien celle de deux sortes de processus ou de deux types de cours de l’excitation. Cela nous serait indifférent ; car nous devons toujours être prêts à laisser tomber nos représentations auxiliaires si nous nous croyons en position de les remplacer par quelque chose d’autre qui serait plus proche de la réalité effective inconnue. Essayons maintenant de rectifier quelques vues qui pouvaient se former par malentendu aussi longtemps que nous envisagions les deux systèmes au sens le plus immédiat et le plus grossier comme deux localités à l’intérieur de l’appareil animique, vues qui ont laissé derrière elles leur précipité dans les expressions « refouler » et « pénétrer ». Lorsque donc nous disons qu’une pensée inconsciente tend à la traduction dans le préconscient pour pénétrer alors jusqu’à la conscience, nous ne voulons pas dire qu’une deuxième pensée, située en un nouvel endroit, doit être formée, une retranscription en quelque sorte, à côté de de laquelle l’original continue d’exister ; et même pour ce qui est de la pénétration jusqu’à la conscience, nous voulons en détacher soigneusement toute idée d’un changement de lieu. Lorsque nous disons qu’une pensée préconsciente est refoulée et ensuite accueillie par l’inconscient, ces images empruntées à la sphère des représentations du combat pour un territoire pourraient nous induire à faire l’hypothèse qu’effectivement dans l’une des localités psychiques un ordonnancement est dissous pour être remplacé par un nouveau dans l’autre localité. À la place de ces comparaisons, nous posons, ce qui semble mieux correspondre à l’était des choses réel, qu’un investissement d’énergie est reporté sur un ordonnancement déterminé ou est retiré de celui-ci, de sorte que la formation psychique tombe sous la domination d’une instance ou lui est soustraite. Nous remplaçons ici de nouveau un mode représentation topique par un mode de représentation dynamique ; ce n’est pas la formation psychique qui nous apparaît comme étant l’élément mobile, mais son innervation[1].
Cependant, je tiens pour approprié et justifié de continuer de recourir à la représentation visuelle des deux systèmes. Nous échapperons à tout mauvais emploi de ce mode de présentation si nous nous souvenons que les représentations, pensées, formations psychiques en général, ne doivent absolument pas être localisées dans des éléments organiques du système nerveux, mais au contraire pour ainsi dire entre eux, là où résistances et frayages constituent le corrélat correspondant à ces formations. Tout ce qui peut devenir objet de notre perception interne est virtuel, comme l’image donnée par le trajet des rayons lumineux dans la longue-vue. Quant aux systèmes qui ne sont eux-mêmes rien de psychique et ne deviennent jamais accessibles à notre perception psychique, nous sommes en droit de supposer qu’ils sont semblables aux lentilles de la longue-vue qui projettent l’image. Pour poursuivre cette comparaison, la censure entre deux systèmes correspondrait à la réfraction des rayons lors du passage dans le nouveau milieu.
[1] [Note ajoutée en 1925 :] Cette conception fut remaniée et modifiée après que l’on eut reconnu que le caractère essentiel d’une représentation préconsciente est la liaison avec des restes de représentations de mot (L’inconscient [« das Unbewußte », GW, X ; OCF.P, XIII], 1915).
Numéro 2021-1 Quelle liberté?
Psychologie des masses et analyse du moi (1921c/1991)
OCF-P, XVI, p. 49-54, Paris, Puf, 2010
État amoureux et hypnose
L’usage de la langue reste, même dans ses caprices, fidèle à une certaine réalité effective. C’est ainsi qu’il nomme certes« amour » des relations de sentiment très variées, que nous aussi regroupons dans la théorie en tant qu’amour, mais qu’il ne s’en remet pas moins à douter que cet amour soit l’amour proprement dit, authentique, vrai, et qu’ainsi il renvoie à toute une échelle de possibilités au sein des phénomènes amoureux. Il ne nous sera pas non plus difficile de découvrir celle-ci dans l’observation.
Dans une série de cas, l’état amoureux n’est rien d’autre qu’investissement d’objet de la part des pulsions sexuelles aux fins de la satisfaction sexuelle directe, investissement qui d’ailleurs s’éteint lorsque ce but est atteint ; c’est cela qu’on appelle l’amour sensuel, commun. Mais, comme on sait, la situation libidinale demeure rarement aussi simple. L’assurance de pouvoir compter sur le réveil du besoin qui vient de s’éteindre doit bien avoir été le motif premier pour porter sur l’objet sexuel un investissement durable, et pour l’« aimer » aussi dans les intervalles exempts de désir.
Provenant de la très remarquable histoire de développement de la vie amoureuse de l’homme, un second facteur vient s’ajouter. L’enfant, dans 1a première phase, le plus souvent déjà achevée à cinq ans, avait trouvé dans l’un des parents un premier objet d’amour sur lequel s’étaient réunies toutes ses pulsions sexuelles requérant satisfaction. Le refoulement intervenant alors provoqua par contrainte le renoncement à la plupart de ces buts sexuels enfantins et laissa derrière lui une modification en profondeur du rapport aux parents. L’enfant resta désormais lié aux parents, mais par des pulsions qu’on ne peut nommer que « inhibées quant au but ». Les sentiments qu’il éprouve dorénavant pour ces personnes aimées sont qualifiés de « tendres ». Il est connu que dans l’inconscient les tendances « sensuelles » antérieures subsistent plus ou moins fortement, si bien que la plénitude du courant originel se maintient[1] en un certain sens.
Avec la puberté s’instaurent, comme on sait, des tendances nouvelles, très intenses, dirigées vers les buts sexuels directs. Dans des cas défavorables, elles demeurent, comme courant sensuel, distinctes des orientations de sentiment « tendres » qui perdurent. On a alors devant soi le tableau dont les deux aspects sont si volontiers idéalisés par certaines orientations de la littérature. L’homme fait montre de penchants exaltés envers des femmes tenues en haute estime, qui pourtant ne le stimulent pas au commerce amoureux, et il n’est puissant qu’avec d’autres femmes qu’il n’« aime » pas, qu’il estime peu ou même qu’il méprise[2]. Plus fréquemment cependant, l’adolescent parvient à un certain degré de synthèse entre l’amour non sensuel, céleste, et l’amour sensuel, terrestre, et son rapport à l’objet sexuel se caractérise par l’action conjointe de pulsions non-inhibées et inhibées quant au but. C’est à l’apport des pulsions de tendresse, inhibées quant au but, que l’on peut mesurer le niveau de l’état amoureux en opposition au désir purement sensuel.
Dans le cadre de cet état amoureux, nous avons été frappés dès le début par le phénomène de la surestimation sexuelle, le fait que l’objet aimé jouit d’une certaine liberté au regard de la critique, que toutes ses propriétés sont estimées davantage que celles de personnes non aimées ou davantage qu’en un temps où il n’était pas aimé. Lors d’un refoulement ou d’une mise à l’arrière-plan tant soit peu efficaces des tendances sensuelles, s’installe l’illusion que l’objet est aimé, même sensuellement, à cause de ses avantages quant à l’âme, alors qu’à l’inverse c’est seulement le contentement sensuel qui peut lui avoir conféré ces avantages.
La tendance qui fausse ici le jugement est celle de l’idéalisation. Mais de ce fait il nous est plus facile de nous orienter ; nous reconnaissons que l’objet est traité comme le moi propre, que donc dans l’état amoureux une bonne mesure de libido narcissique déborde sur l’objet. Dans maintes formes de choix amoureux, il saute même aux yeux que l’objet sert à remplacer un idéal du moi propre, non atteint. On l’aime à cause des perfections auxquelles on a aspiré pour le moi propre et qu’on voudrait maintenant se procurer par ce détour pour la satisfaction de son narcissisme.
Que la surestimation sexuelle et l’état amoureux continuent d’augmenter et l’interprétation du tableau devient de plus en plus impossible à méconnaître. Les tendances poussant à la satisfaction sexuelle directe peuvent alors être totalement repoussées, comme il advient régulièrement, par exemple, dans l’amour exalté du jeune homme : le moi devient de plus en plus dénué de revendication, de plus en plus modeste, l’objet de plus en plus grandiose, de plus en plus précieux ; celui-ci entre finalement en possession de la totalité de l’amour de·soi du moi, si bien que le sacrifice de soi de ce dernier en devient la conséquence naturelle. L’objet a pour ainsi dire consommé le moi. Des traits d’humilité, de restriction du narcissisme, d’autoendommagement, sont présents dans chaque cas d’état amoureux ; dans le cas extrême, ils ne font qu’être accrus et, de par le passage à l’arrière-plan des revendications sensuelles, ils restent seuls à régner.
Cela est tout particulièrement le cas dans un amour malheureux, impossible à accomplir, car avec chaque satisfaction sexuelle, c’est bien la surestimation sexuelle qui connaît toujours de nouveau un abaissement. Simultanément à cet « abandonnement » du moi à l’objet, qui ne se différencie déjà plus de l’abandonnement sublimé à une idée abstraite, les fonctions imparties à l’idéal du moi font totalement défaillance. Voilà que se tait la critique exercée par cette instance ; tout ce que fait et exige l’objet est juste et irréprochable. La conscience morale ne trouve pas à s’appliquer à tout ce qui advient en faveur de l’objet ; dans l’aveuglement d’amour, on se fait criminel sans remords. Toute la situation se laisse résumer sans reste en une formule : l’objet s’est mis à la place de l’idéal du moi.
La différence entre l’identification et l’état amoureux dans ses plus hautes conformations, qu’on appelle fascination, sujétion amoureuse, est maintenant facile à décrire. Dans le premier cas, le moi s’est enrichi des propriétés de l’objet, s’est, selon l’expression de Ferenczi[3]\, « introjecté » celui-ci ; dans le second cas, il est appauvri, il s’est abandonné à l’objet, a mis celui-ci à la place de sa partie constitutive la plus importante. Cependant, en considérant les choses de plus près, on remarque bientôt qu’une telle présentation fait miroiter des oppositions qui n’existent pas. Il ne s’agit pas économiquement d’appauvrissement ou d’enrichissement, on peut aussi décrire l’état amoureux extrême comme celui où le moi se serait introjecté l’objet. Peut-être une autre différenciation touche-t-elle bien plutôt à l’essentiel. Dans le cas de l’identification, l’objet s’est perdu ou a été abandonné ; il est alors ré-établi dans le moi ; le moi se modifie partiellement selon le modèle de l’objet perdu. Dans l’autre cas, l’objet est resté conservé et est surinvesti en tant que tel de la part et aux dépens du moi. Mais ici aussi se lève une hésitation. Est-il donc certain que l’identification présuppose l’abandon de l’investissement d’objet, ne peut-il y avoir identification, l’objet étant conservé ? Et avant de nous engager dans la discussion de cette question épineuse, l’idée peut déjà poindre en nous qu’une autre alternative inclut l’essence de cet état de choses, à savoir : l’objet est-il mis à la place du moi ou de l’idéal du moi ?
De l’état amoureux à l’hypnose il n’y a manifestement pas un grand pas. Les concordances entre les deux sautent aux yeux. Même soumission humble, même docilité, même absence de critique envers l’hypnotiseur qu’envers l’objet aimé. Même résorption de l’initiative propre ; aucun doute, l’hypnotiseur est venu à la place de l’idéal du moi. Tous les rapports dans l’hypnose sont simplement encore plus nets et plus accrus, si bien qu’il serait plus approprié d’élucider l’état amoureux par l’hypnose que l’inverse. L’hypnotiseur est l’objet unique, nul autre à part lui n’est pris en compte. Que le moi vive comme en rêve ce que l’hypnotiseur exige et affirme, cela nous avertit que nous avons négligé de mentionner aussi, parmi les fonctions de l’idéal du moi, l’exercice de l’examen de réalité[4]. Rien d’étonnant à ce que le moi tienne pour réelle une perception, lorsque l’instance psychique à qui incombe habituellement la tâche de l’examen de réalité se porte garante de cette réalité. L’absence totale de tendances à buts sexuels non-inhibés contribue par ailleurs à l’extrême pureté des phénomènes. La relation hypnotique est un abandonnement amoureux sans restriction, avec exclusion de satisfaction sexuelle, alors que dans l’état amoureux celle-ci n’est guère repoussée que pour un temps et demeure à l’arrière-plan comme possibilité de but ultérieure.
Mais d’un autre côté nous pouvons dire aussi que la relation hypnotique est – si cette expression est permise – une formation en masse à deux. L’hypnose n’est pas un bon objet de comparaison avec la formation en masse parce qu’elle est bien plutôt identique à celle-ci. Elle isole pour nous, de la texture compliquée de la masse, un élément, le comportement de l’individu de la masse envers le meneur. Par cette restriction du nombre, l’hypnose se distingue de la formation en masse, tout comme, par l’absence des tendances directement sexuelles, elle se distingue de l’état amoureux. En ce sens elle tient le milieu entre les deux.
Il est intéressant de voir que ce sont justement les tendances sexuelles inhibées quant au but qui aboutissent à des liaisons aussi durables des hommes entre eux. Mais cela se comprend aisément en partant du fait qu’elles ne sont pas capables d’une pleine satisfaction, alors que les tendances sexuelles non-inhibées connaissent, par l’éconduction survenant chaque fois que le but sexuel est atteint, un extraordinaire abaissement. L’amour sensuel est destiné à s’éteindre dans la satisfaction ; pour pouvoir durer, il faut qu’il soit assorti dès le début de composantes purement tendres, c’est-à-dire inhibées quant au but, ou bien qu’il connaisse une telle transposition.
L’hypnose résoudrait pour nous, tout uniment, l’énigme de la constitution libidinale d’une masse, si elle-même ne comportait pas en outre des traits qui se soustraient à l’élucidation rationnelle donnée jusqu’à présent – état amoureux avec exclusion des tendances directement sexuelles. Il y a encore beaucoup de choses en elle dont il faut reconnaître qu’elles sont incomprises, qu’elles sont mystiques. Elle comporte une adjonction de paralysie provenant du rapport d’un être surpuissant à un être impuissant, en désaide, ce qui en quelque sorte fait la transition avec l’hypnose d’effroi des animaux. La manière dont elle est engendrée, sa relation au sommeil ne sont pas transparentes, et l’assortiment énigmatique de personnes qui s’y prêtent, alors que d’autres s’y opposent totalement, renvoie à un facteur encore inconnu qui, en elle, est effectivement réalisé et qui seul peut-être rend possible en elle la pureté des positions libidinales. Il vaut aussi de prendre en compte que fréquemment la conscience morale de la personne hypnotisée peut se montrer elle-même résistante avec par ailleurs une pleine docilité à la suggestion. Mais cela peut bien provenir de ce que, dans l’hypnose telle qu’elle est pratiquée la plupart du temps, un savoir a pu rester conservé, selon lequel il ne s’agit que d’un jeu, d’une reproduction non vraie d’une autre situation d’une importance vitale bien plus grande.
Par les discussions menées jusqu’à présent nous sommes toutefois pleinement préparés à indiquer la formule de la constitution libidinale d’une masse. Tout au moins d’une masse telle que nous l’avons considérée jusqu’à présent, qui donc a un meneur, et telle que ce n’est pas par un excès d’« organisation » qu’elle pouvait acquérir secondairement les propriétés d’un individu. Une telle masse primaire est un certain nombre d’individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi et se sont, en conséquence, identifiés les uns avec les autres dans leur moi.
[1] Voir « Théorie sexuelle » [Drei Abhandlungen zur Sex.ualtheorit (Trois essais sur la théorie sexuelle), GW, V, p. 100-101; OCF.P, VI, p. 136-137.]
[2] Du rabaissement le plus général de la vie amoureuse [« Über die allgemeinste Emiedrigung des Liebeslebens »]. Sammlung [kleiner Schriften zur Neurosenlehre], 1918, 4e suite [GW, VII ; OCFP, XI].
[3] Sandor Ferenczi (1873-1933), « Introjektion und Übertragung » (Introjection et transfert), Jb. psychoanal. psychopath. Forsch., 1909, 1, p. 422-457.
[4] Voir Complément métapsychologique à la doctrine du rêve [« Metapsychologische Erganzung zur Traumlehre »], Sammlung kleiner Schdften zur Neurosenlehre, 4e suite, 1918 [GW, X, p. 424 ; OCF.P, XIII, p. 256]. [Note ajoutée en 1923 :] Il semble toutefois permis de douter du bien-fondé d’une telle attribution, doute qui requiert une discussion approfondie.
Sur la psychanalyse (1911 [1913m])[1]
OCF.P, XI, p. 29-34, Paris, Puf, 2009.
Répondant à une aimable requête du secrétaire de votre section de neurologie et de psychiatrie, je me permets d’attirer l’attention de ce Congrès sur le sujet de la psychanalyse, qui est largement étudié à l’heure actuelle en Europe et en Amérique.
La psychanalyse est une combinaison remarquable, car elle comprend non seulement une méthode de recherche sur les névroses, mais aussi une méthode de traitement fondée sur l’étiologie découverte par ce moyen. Je commencerai en disant que la psychanalyse n’est pas un enfant de la spéculation, mais le résultat de l’expérience; et pour cette raison, comme chaque nouvelle production de la science, elle est inachevée. Il est loisible à quiconque de se convaincre par ses propres investigations de l’exactitude des thèses qu’elle renferme, et de contribuer à développer plus avant cette étude.
La psychanalyse commença par des recherches sur l’hystérie, mais, au cours des années, elle s’est étendue bien au-delà de ce domaine de travail. Les Études sur l’hystérie, de Breuer et moi-même, publiées en 1895, constituèrent les débuts de la psychanalyse. Elles suivirent la voie ouverte par le travail de Charcot sur l’hystérie « traumatique », les investigations de Liébeault et de Bernheim sur les phénomènes de l’hypnose, et les études de Janet sur les processus mentaux inconscients. La psychanalyse se trouva bientôt en nette opposition avec les conceptions de Janet, parce que a) elle refusait de faire remonter directement l’hystérie à une dégénérescence congénitale héréditaire, b) elle proposait, au lieu d’une simple description, une explication dynamique fondée sur l’interaction de forces psychiques et c) elle attribuait l’origine de la dissociation psychique (dont l’importance avait également été reconnue par Janet), non pas à un [échec de] de la synthèse mentale résultant d’une incapacité congénitale, mais à un processus psychique particulier connu sous le nom de « refoulement » (« Verdrangung »).
Il a été démontré de façon concluante que les symptômes hystériques sont des restes (réminiscences) d’expériences profondément bouleversantes, qui ont été soustraits à la conscience de tous les jours, et que leur forme est déterminée (d’une manière qui exclut toute action délibérée) par des détails des effets traumatiques de ces expériences. Selon cette conception, les chances thérapeutiques résident dans la possibilité de se débarrasser de ce « refoulement », de manière à permettre à une partie du matériel psychique inconscient de devenir conscient et de le priver ainsi de son pouvoir pathogène. Cette conception est dynamique, dans la mesure où elle considère les processus psychiques comme des déplacements d’énergie psychique qui peuvent être mesurés d’après le montant de leur effet sur les éléments affectifs. Cela est particulièrement significatif dans l’hystérie, où le processus de « conversion » crée les symptômes en transformant une quantité d’impulsions mentales en des innervations somatiques.
Les premières explorations et tentatives de traitement psychanalytiques furent faites à l’aide de l’hypnose. Par la suite, celle-ci fut abandonnée et le travail fut mené par la méthode de la « libre association », le patient demeurant dans son état normal. Cette modification présentait l’avantage de permettre au procédé de s’appliquer à un nombre beaucoup plus élevé de cas d’hystérie, de même qu’à d’autres névroses, et aussi aux personnes en bonne santé. Le développement d’une technique particulière d’interprétation devint pourtant nécessaire, afin de tirer des conclusions des idées formulées par la personne soumise à l’investigation. Ces interprétations établirent avec une certitude complète le fait que des dissociations psychiques sont entièrement maintenues par des « résistances internes ». Il semble donc justifié de conclure que les dissociations ont trouvé leur origine dans un conflit interne, qui a conduit au refoulement de l’impulsion sous-jacente. Pour surmonter ce conflit et par là même guérir la névrose, la main secourable d’un médecin formé en psychanalyse est nécessaire.
De plus, il s’est avéré de façon assez générale que dans toutes les névroses, les symptômes pathologiques sont en réalité les produits finaux de conflits de ce type ayant conduit au « refoulement » et au « clivage » de l’esprit. Les symptômes sont engendrés par différents mécanismes : a) soit comme formations venant se substituer aux forces refoulées, ou b) comme compromis entre les forces refoulantes et les forces refoulées, ou c) comme formations réactionnelles et garanties contre les forces refoulées.
Les recherches furent ensuite étendues aux conditions qui déterminent si les conflits psychiques vont ou non conduire au« refoulement » (c’est-à-dire à une dissociation qui a une causation dynamique), puisqu’il va sans dire qu’un conflit psychique, per se,peut aussi trouver une issue normale. La conclusion que la psychanalyse en tira est que des conflits de cette sorte sont toujours entre les pulsions sexuelles (« sexuel » étant pris au sens le plus large) et les souhaits et tendances du reste du moi. Dans les névroses, ce sont les pulsions sexuelles qui succombent au « refoulement » et constituent ainsi la base la plus importante pour la genèse des symptômes, lesquels peuvent donc être tenus pour des substituts de satisfactions sexuelles.
Notre travail sur la question de la disposition aux affections névrotiques a ajouté le facteur « infantile » aux facteurs somatique et héréditaire jusqu’alors reconnus. La psychanalyse a été obligée de faire remonter la vie mentale des patients jusqu’à leur première enfance, et elle est arrivée à la conclusion que ce sont des inhibitions dudéveloppement mental (« infantilismes ») qui offrent une disposition à la névrose. En particulier, nous avons appris de nos investigations sur la vie sexuelle qu’il existe réellement quelque chose comme une « sexualité infantile », que la pulsion sexuelle est constituée de plusieurs composantes et suit un parcours de développement compliqué, dont l’issue finale, après bien des restrictions et transformations, est la sexualité « normale » des adultes. Les énigmatiques perversions de la pulsion sexuelle qui surviennent chez les adultes paraissent être ou des inhibitions du développement, ou des fixations ou des distorsions de croissance. Les névroses sont ainsi le négatif des perversions.
Le développement culturel imposé à l’humanité est le facteur qui rend nécessaires les restrictions et refoulements de la pulsion sexuelle, des sacrifices plus ou moins grands étant exigés en fonction de chaque constitution individuelle. Il est rare que le développement s’effectue sans heurt, et des troubles peuvent survenir (soit en raison de la constitution individuelle, soit en raison d’incidents sexuels prématurés) qui laissent derrière eux une disposition à de futures névroses. Des dispositions de ce genre resteront inoffensives si la vie de l’adulte se déroule de façon satisfaisante et tranquille ; mais elles deviennent pathogènes si les conditions de la vie mature interdisent la satisfaction de la libido ou si elles posent des exigences trop élevées en vue de sa répression.
Les recherches sur l’activité sexuelle des enfants ont conduit à une nouvelle conception de la pulsion sexuelle, fondée non plus sur ses fins mais sur ses sources. La pulsion sexuelle possède à un haut degré la capacité d’être déviée de buts sexuels directs et d’être dirigée sur des buts plus élevés qui ne sont plus sexuels (« sublimation »). La pulsion est ainsi en mesure d’apporter les plus importantes contributions aux réalisations sociales et artistiques de l’humanité.
La reconnaissance de la présence simultanée de ces trois facteurs que sont l’« infantilisme », la « sexualité » et le « refoulement » constitue la principale caractéristique de la théorie psychanalytique, et distingue celle-ci des autres conceptions de la vie mentale pathologique. Dans le même temps, la psychanalyse a démontré qu’il n’existe pas de différence fondamentale, mais une simple différence de degré, entre la vie mentale des gens normaux, celle des névrosés et celle des psychotiques. Une personne normale doit passer par les mêmes refoulements et s’affronter aux mêmes structures substitutives ; la seule différence est qu’elle gère ces éventualités avec moins de trouble et plus de succès. C’est pourquoi la méthode d’investigation psychanalytique peut également s’appliquer à l’explication des phénomènes psychiques normaux, et a permis de découvrir la relation étroite existant entre des productions psychiques pathologiques et des structures normales telles que les rêves, les petits ratés de la vie quotidienne, et ces phénomènes non sans valeur que sont les traits d’esprit, les mythes et les œuvres d’imagination. C’est dans le cas des rêves que l’explication de ces phénomènes a été poussée le plus loin, et là elle a abouti à la formulation générale suivante : « Un rêve est un accomplissement déguisé d’un souhait refoulé. » L’interprétation des rêves a pour objectif de lever le déguisement auquel les pensées du rêveur ont été soumises. De plus, elle apporte une aide d’une haute valeur à la technique psychanalytique, car elle constitue la méthode la plus commode pour prendre connaissance de 1a vie mentale inconsciente.
Il existe souvent, dans les cercles médicaux et particulièrement dans les cercles psychiatriques, une tendance consistant à contredire les théories de la psychanalyse sans les avoir réellement étudiées ou les avoir mises en pratique. Cela est dû non seulement à la nouveauté frappante de ces théories et au contraste qu’elles offrent avec les conceptions soutenues jusqu’à présent par les psychiatres, mais aussi au fait que les prémisses et la technique de la psychanalyse sont beaucoup plus étroitement apparentées au domaine de la psychologie qu’à celui de la médecine. On ne peut contester cependant que les enseignements purement médicaux et non psychologiques ont très peu contribué jusqu’à présent à la compréhension de la vie mentale. En outre, le progrès de la psychanalyse a été retardé par la peur que ressent l’observateur moyen à se voir lui-même dans son propre miroir. Les hommes de science ont tendance à aborder des résistances émotionnelles avec des arguments, et ainsi à se satisfaire eux-mêmes de leur propre satisfaction ! Celui qui souhaite ne pas ignorer une vérité fera bien de se méfier de ses antipathies, et, s’il souhaite soumettre la théorie de la psychanalyse à un examen critique, de commencer par s’analyser lui-même.
Je ne pense certes pas avoir réussi dans ces quelques lignes à brosser un tableau clair des principes et des fins de la psychanalyse. Mais j’y joindrai une liste des principales publications sur le sujet, dont l’étude fournira des éclaircissements supplémentaires à tous ceux que j’ai pu intéresser.
- Breuer et Freud, Études sur l’hystérie [Studien über Hysterie], 1895, Fr. Deuticke, Vienne. Une partie de cet ouvrage a été traduite en anglais dans « Selected Papers on Hysteria and other Psycho-neuroses », par le Dr A. A. Brill, New York, 1909.
- Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie], Vienne, 1905. Traduction anglaise par le D’ Brill, « Three Contributions ta the Sexual Theory », New York, 1910.
- Freud, Sur la psychopathologie de la vie quotidienne [Zur Psychopa thologie des Alltagslebens], S. Karger, Berlin, 3e éd., 1910.
- Freud, L’interprétation du rêve [Die Traumdeutung], Vienne, 1900, 3e éd., 191l.
- Freud, « The Origin and Development of Psycho-Analysis », Amer. Jour. of Psychology, avril 1910. Aussi en allemand : Über Psychoanalyse [De la psychanalyse]. Cinq leçons données à la Clark University, Worcester, Mass., 1909.
- Freud, Le trait d’esprit et sa relation à l’inconscient [Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten], Vienne, 1905.
- Freud, Collection of minor papers on the Doctrine of Neuroses [Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre], 1893-1906. Vienne, 1906.
- Idem. Second recueil, Vienne, 1909.
- Hitschmann, Freuds Neurosenlehre [La doctrine des névroses de Freud], Vienne, 191l.
- C.G. Jung, Diagnostische Assoziationsstudien [Études des associations en vue du diagnostic]. Deux volumes, 1906-1910.
- C.G.]ung, Über die Psychologie der Dementia praecox [De la psychologie de la dementia praecox], 1907.
- Jahrbuch far psycho-analytische und psychopathologische Forschnugen, publié par E. Bleuler et S. Freud, dirigé par Jung. Depuis 1909.
- Schriflen zur angewandœn Seelenkunde, Fr. Deuticke, Vienne. Depuis 1907. 11 fascicules, par Freud, Jung, Abraham, Pfister, Rank. Jones, Riklin, Graf, Sadger.
- Zentralblattfar Psychoanalyse. Dirigé par A Adler et W. Sookt l, J. Bergmann, Wiesbaden. Depuis sept. 1910.
[1] Communication de Freud lue à Sydney en 1911. L’original allemand n’a pas été retrouvé.
numéro 2020-4 Pulsion de vie
Au-delà du principe de Plaisir
OCF.P, XV, extraits : p. 323-335, Paris, Puf, 1996.
Tentons hardiment de faire un pas de plus. Selon une façon de voir générale, l’union de nombreuses cellules en une association pour la vie, la pluricellularité des organismes, est devenue un moyen d’allonger leur durée de vie. Une cellule aide à conserver la vie des autres et l’État cellulaire peut continuer à vivre même si telles ou telles cellules doivent succomber à la mort. Nous avons déjà vu que la copulation aussi, fusion momentanée de deux unicellulaires, agit sur l’un et l’autre dans le sens de la conservation de la vie et du rajeunissement. Ainsi pourrait-on tenter de transférer au rapport des cellules entre elles la théorie de la libido acquise en psychanalyse et se représenter que ce sont les pulsions de vie – ou pulsions sexuelles –, actives dans chaque cellule, qui prennent pour objet les autres cellules, en neutralisent en partie les pulsions de mort, c’est-à-dire les procès suscités par celles-ci, et les conservent ainsi en vie, tandis que d’autres cellules en font autant pour les premières, d’autres encore se sacrifient elles-mêmes dans l’exercice de cette fonction libidinale. Les cellules germinales, elles, se comporteraient de façon absolument « narcissique », selon notre désignation habituelle dans la doctrine des névroses lorsqu’un individu tout entier maintient sa libido dans le moi et n’en dépense rien pour des investissements d’objet. Les cellules germinales ont besoin pour elles-mêmes de leur libido, l’activité de leurs pulsions de vie, comme provision pour leur activité ultérieure prodigieusement constructive. Peut-être est-on en droit de qualifier également de narcissiques, au même sens du terme, les cellules des néo-formations malignes qui détruisent l’organisme. La pathologie est en effet prête à tenir leurs germes pour innés et à leur concéder des propriétés embryonnaires[1]. C’est ainsi que la libido de nos pulsions sexuelles coïnciderait avec l’Éros des poètes et des philosophes, qui maintient en cohésion tout ce qui est vivant.
Nous trouvons ici l’occasion de prendre une vue d’ensemble sur le lent développement de notre théorie de la libido. L’analyse des névroses de transfert nous contraignit tout d’abord à l’opposition entre des « pulsions sexuelles », qui sont dirigées sur l’objet, et d’autres pulsions que nous ne reconnaissions que très insuffisamment et désignions provisoirement comme « pulsions du moi ». Parmi celles-ci durent être reconnues en premier des pulsions qui servent à l’autoconservation de l’individu. Quelles autres sortes de différenciations il y avait à faire là, on ne pouvait le savoir. Aucune connaissance n’aurait été aussi importante, pour fonder une psychologie correcte, qu’une compréhension approximative de la nature générale et des particularités éventuelles des pulsions. Mais il n’y avait pas de domaine de la psychologie où l’on avançât à ce point à tâtons dans l’obscurité. Chacun posait l’existence d’autant de pulsions ou de « pulsions fondamentales » qu’il lui plaisait et en jouait comme faisaient dans la Grèce ancienne les philosophes de la nature avec leurs quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. La psychanalyse, qui ne pouvait de toute façon se passer d’une hypothèse sur les pulsions, s’en tint tout d’abord à la différenciation pulsionnelle populaire qui a pour modèle la locution « faim et amour ». Du moins n’était-ce pas là un nouvel acte arbitraire. Avec cela on avança suffisamment loin dans l’analyse des psychonévroses. Le concept de « sexualité » – et partant celui d’une pulsion sexuelle – dut, bien sûr, être étendu au point d’inclure bien des choses qui ne s’intégraient pas dans la fonction de reproduction, et cela n’alla pas sans faire du bruit dans le monde rigoriste, distingué, ou tout simplement hypocrite.
Le pas suivant fut franchi lorsque la psychanalyse s’approcha en tâtonnant du moi psychologique qui n’avait d’abord été connu d’elle que comme instance refoulante, censurante et capable de produire des constructions protectrices et des formations réactionnelles. Il est vrai que des têtes critiques et autres esprits aux larges vues avaient depuis longtemps reproché au concept de libido d’être restreint à l’énergie des pulsions sexuelles tournées vers l’objet. Mais ils négligaient de nous communiquer d’où leur était venue cette meilleure façon de voir et ils ne s’entendaient pas à en déduire quelque chose d’utilisable pour l’analyse. En avançant plus prudemment, l’observation psychanalytique fut alors frappée de la régularité avec laquelle la libido est retirée de l’objet et dirigée sur le moi (introversion), et en étudiant le développement de la libido de l’enfant dans ses toutes premières phases, elle parvint à voir que le moi est le réservoir véritable et originel de la libido, qui doit partir de là avant d’être étendue à l’objet. Le moi prit alors rang parmi les objets sexuels et fut aussitôt reconnu comme le plus distingué d’entre eux. Quand la libido séjournait ainsi dans le moi, elle était appelée narcissique[2]. Cette libido narcissique était naturellement aussi la manifestation de la force des pulsions sexuelles, au sens analytique, que l’on ne put qu’identifier avec les « pulsions d’autoconservation » admises dès le départ. Ainsi l’opposition originelle entre pulsions du moi et pulsions sexuelles était-elle devenue inadéquate. Une partie des pulsions du moi était reconnue comme étant libidinale ; dans le moi étaient également à l’œuvre – vraisemblablement à côté d’autres– des pulsions sexuelles ; on est cependant justifié à dire que l’ancienne formule, selon laquelle la psychonévrose repose sur un conflit entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles, ne contenait rien qui soit aujourd’hui à rejeter. La différence entre les deux espèces de pulsions, qui à l’origine était à prendre en quelque sorte qualitativement, ne peut maintenant être déterminée qu’autrement, à savoir topiquement. La névrose de transfert en particulier, le véritable objet d’étude de la psychanalyse, reste le résultat d’un conflit entre le moi et l’investissement d’objet libidinal.
Il nous faut maintenant d’autant plus insister sur le caractère libidinal des pulsions d’autoconservation que nous risquons ce pas supplémentaire : reconnaître la pulsion sexuelle comme étant l’Éros qui conserve tout, et faire dériver la libido narcissique du moi des apports de libido au moyen desquels les cellules du soma adhèrent les unes aux autres. Mais nous voici subitement confrontés à la question suivante : si les pulsions d’autoconservation sont, elles aussi, de nature libidinale, nous n’avons peut-être absolument pas d’autres pulsions que libidinales. Du moins n’en existe-t-il pas d’autres qui soient visibles. Mais alors il faut donner raison aux critiques qui ont pressenti dès le début que la psychanalyse explique tout par la sexualité ou aux novateurs comme Jung qui, prompt à se décider, ont tout simplement utilisé libido pour « force de pulsion ». N’en est-il pas ainsi ?
Ce résultat ne serait certes pas dans nos intentions. En effet nous sommes bien plutôt partis d’une démarcation tranchée entre pulsions du moi = pulsions de mort et pulsions sexuelles = pulsions de vie. En effet, nous étions prêts à mettre aussi les prétendues pulsions d’autoconservation du moi au nombre des pulsions de mort, ce que, pour nous corriger, nous avons depuis lors retiré. Notre conception était dès le début dualiste et elle l’est aujourd’hui de façon plus tranchée qu’auparavant, depuis que nous dénommons les opposés, non plus pulsions du moi et pulsions sexuelles, mais pulsions de vie et pulsions de mort. La théorie de la libido de Jung est au contraire moniste ; qu’il ait appelé libido sa force de pulsion unique ne pouvait que créer de la confusion, mais ne doit pas pour autant nous influencer[3]. Nous supposons que dans le moi sont actives d’autres pulsions encore que les pulsions d’autoconservation libidinales[4], sauf que nous devrions être capables de les montrer. Il est regrettable que l’analyse du moi ait fait si peu de progrès et que cette mise en évidence nous soit vraiment difficile. Les pulsions libidinales du moi peuvent d’ailleurs être connectées d’une façon particulière aux autres pulsions du moi qui nous sont encore étrangères. Avant même que nous ayons clairement reconnu le narcissisme, le soupçon existait déjà en psychanalyse que les « pulsions du moi » ont attiré à elles des composantes libidinales. Mais ce sont là des possibilités bien incertaines dont nos adversaires ne tiendront guère compte. Il reste fâcheux que jusqu’à présent l’analyse ne nous ait jamais rendus capables que de mettre en évidence les pulsions libidinales. Ce n’est cependant pas une raison pour adopter la conclusion qu’il n’y en a effectivement pas d’autres.
Dans l’obscurité présente de la doctrine des pulsions, nous aurions bien tort de rejeter la moindre idée incidente nous promettant des lumières. Nous sommes partis de la grande relation d’opposition entre pulsions de vie et pulsions de mort. L’amour d’objet lui-même nous montre une seconde polarité de ce genre, celle de l’amour (tendresse) et de la haine (agression). Si seulement nous réussissions à mettre en relation ces deux polarités entre elles, à ramener l’une à l’autre ! Nous avons de tout temps reconnu une composante sadique de la pulsion sexuelle[5] ; comme nous le savons, elle peut se rendre autonome et dominer comme perversion la tendance sexuelle d’ensemble de la personne. Elle se détache aussi comme pulsion partielle dominante dans une de ces organisations que j’ai nommées « organisations prégénitales ». Mais comment faire dériver de l’Éros, qui conserve la vie, la pulsion sadique qui a pour but l’endommagement de l’objet ? N’y a-t-il pas lieu de faire ici l’hypothèse que ce sadisme est à proprement parler une pulsion de mort qui a été repoussée du moi par l’influence de la libido narcissique, de sorte qu’elle ne vient à apparaître qu’au niveau de l’objet ? Il entre alors au service de la fonction sexuelle ; au stade d’organisation oral de la libido, l’emprise amoureuse coïncide encore avec l’anéantissement de l’objet, plus tard la pulsion sadique se sépare et finalement, au stade du primat génital, elle se charge, aux fins de la reproduction, d’avoir pour fonction de maîtriser l’objet sexuel dans la mesure où l’exige l’exécution de l’acte sexué. Enfait on pourrait dire que le sadisme expulsé hors du moi a montré la voie aux composantes libidinales de la pulsion sexuelle ; celles-ci vont plus tard se presser à la suite vers l’objet. Là où le sadisme originel ne connaît ni modération ni fusion, s’instaure l’ambivalence amour-haine de la vie amoureuse, que nous connaissons bien.
S’il est permis de faire une telle hypothèse, on aurait satisfait à l’exigence d’apporter l’exemple d’une pulsion de mort, à vrai dire déplacée. Sauf que cette conception est très loin de pouvoir être visualisée de quelque façon que ce soit et qu’elle donne une impression franchement mystique. Nous nous exposons au soupçon d’avoir cherché à tout prix un moyen pour sortir d’un grand embarras. Nous pouvons ici invoquer qu’une telle hypothèse n’est pas nouvelle, que nous l’avions déjà faite antérieurement, alors qu’il n’était pas encore question d’embarras. Des observations cliniques nous ont en leur temps forcés à concevoir que le masochisme, pulsion partielle complémentaire du sadisme, est à comprendre comme un retournement en arrière du sadisme sur le moi propre[6]. Mais un retournement de la pulsion de l’objet vers le moi n’est, par principe, rien d’autre que son retournement du moi vers l’objet, ce qui est le point nouveau ici en question. Le masochisme, le retournement de la pulsion sur le moi propre, serait donc en réalité un retour à une phase antérieure de cette pulsion, une régression. Sur un point, la présentation du masochisme donnée alors aurait -besoin d’être corrigée dans ce qu’elle a de trop exclusif ; le masochisme pourrait être aussi un masochisme primaire, ce que j’entendais alors contester[7].
Mais revenons aux pulsions sexuelles conservatrices de la vie. De la recherche sur les protistes nous avons déjà appris que la fusion de deux individus, sans partition consécutive, la copulation, a sur les deux individus qui vont se détacher bientôt l’un de l’autre une action fortifiante et rajeunissante (cf. plus haut, Lipschütza). Ils ne montrent pas de phénomènes de dégénérescence dans les générations ultérieures et il semble qu’ils aient été rendus capables de résister plus longtemps aux nuisances de leur propre métabolisme. J’estime que cette observation, bien qu’unique, peut être prise aussi comme modèle de l’effet résultant de l’union sexuée.
Mais de quelle manière la fusion de deux cellules peu distinctes l’une de l’autre amène-t-elle un tel renouvellement de la vie? L’expérience qui, chez les protozoaires, remplace la copulation par l’action de stimuli chimiques ou même mécaniques permet bien de donner une réponse certaine : cela se produit par l’apport de nouvelles sommes de stimuli. Voilà certes qui cadre bien avec l’hypothèse selon laquelle le procès de vie de l’individu conduit, pour des raisons internes, au nivellement de tensions chimiques, c’est-à-dire à la mort, tandis que l’union avec une substance vivante individuellement distincte augmente ces tensions, introduisant pour ainsi dire de nouvelles différences vitales qui doivent ensuite être éliminées par la vie. Pour cet écart il faut naturellement qu’il y ait un ou plusieurs optima. Que nous ayons reconnu comme étant la tendance dominante de la vie animique, peut-être de la vie nerveuse en général, cette tendance à abaisser, à maintenir constant, à supprimer la tension de stimulus interne (le principe de Nirvâna, selon l’expression de Barbara Lowe), telle qu’elle trouve son expression dans le principe de plaisir, voilà bien l’un de nos plus puissants motifs de croire à l’existence de pulsions de mort.
Pourtant nous ne cessons d’éprouver comme une perturbation sensible du cheminement de nos pensées le fait de ne pas pouv·oir mettre en évidence, justement pour la pulsion sexuelle, ce caractère de contrainte de répétition qui nous a d’abord mis sur la piste des pulsions de mort. Le domaine des processus de développement embryonnaires abonde sans doute en de tels phénomènes de répétition, les deux cellules germinales de la reproduction sexuée et leur histoire de vie ne sont elles-mêmes que des répétitions des débuts de la vie organique; mais l’essentiel des processus auxquels tend la pulsion sexuelle n’en est pas moins la fusion de deux corps cellulaires. C’est par elle seule qu’est assurée chez les êtres vivants supérieurs l’immortalité de la substance vivante.
En d’autres termes : nous devons nous informer sur l’apparition de la reproduction sexuée et la provenance des pulsions sexuelles en général, une tâche qui ne peut qu’effrayer quelqu’un de l’extérieur, et qui jusqu’à présent n’a pas encore pu être menée à bien par les chercheurs spécialisés. Dégageons donc de la façon la plus condensée possible ce qui, dans toutes ces données et opinions contradictoires, permet de rejoindre notre cheminement de pensée.
Une de ces conceptions ôte au problème de la reproduction son attrait mystérieux en présentant cette reproduction comme une manifestation partielle de la croissance (multiplication par division, prolifération, bourgeonnement). L’apparition de la reproduction par cellules germinales différenciées quant au sexe, on pourrait, selon le mode de pensée prosaïque de Darwin, se la représenter en disant que l’avantage de l’amphimixis, obtenu un jour par la copulation fortuite de deux protistes, fut maintenu dans l’évolution ultérieure et continue d’être exploité[8]. Le « sexe » ne serait donc pas très ancien et les pulsions extraordinairement impétueuses qui tendent à l’union sexuée répéteraient ainsi quelque chose qui jadis a eu lieu fortuitement et depuis s’est consolidé comme avantageux.
La question se pose ici de nouveau, comme pour la mort, de savoir si l’on ne doit pas supposer chez les protistes quelque chose d’autre que ce qu’ils montrent et si l’on peut admettre que des forces et des processus qui ne deviennent visibles que chez des êtres vivants supérieurs sont apparus aussi pour la première fois chez ceux-ci. La conception de la sexualité mentionnée ci-dessus apporte bien peu à nos desseins. On pourra lui objecter qu’elle présuppose l’existence de pulsions de vie qui agissent déjà dans l’être vivant le plus simple, sans quoi la copulation, qui agit à l’encontre du cours de la vie et rend difficile la tâche d’éliminer la vie en la menant à son terne, n’aurait en effet pas été maintenue et perfectionnée mais bien évitée. Si donc on ne veut pas abandonner l’hypothèse de pulsions de mort, il faut leur associer, dès le tout début, des pulsions de vie. Mais on est forcé de concéder que nous travaillons là sur une équation à deux inconnues. Par ailleurs, ce que nous trouvons dans la science sur l’apparition de la sexuation est si peu de chose que l’on peut comparer ce problème à une profonde obscurité où n’a pas même pénétré le rayon de lumière d’une hypothèse. C’est d’ailleurs en un tout autre endroit que nous rencontrons une telle hypothèse, mais qui est d’un genre si fantastique – assurément plutôt un mythe qu’une explication scientifique – que je n’oserais pas ici en faire état si elle ne remplissait précisément la seule condition que nous aspirons à remplir. Effectivement, elle fait dériver une pulsion du besoin de réinstaurer un état antérieur.
Je pense naturellement à la théorie que, dans le Banquet, Platon fait développer par Aristophane et qui ne traite pas seulement de la provenance de la pulsion sexuelle, mais aussi de celle de la plus importante de ses variations en ce qui concerne l’objet[9].
«Notre corps, en effet, n’était d’abord pas du tout formé comme maintenant ; il était tout autre. Premièrement, il y avait trois sexes, pas seulement comme maintenant, masculin et féminin, mais encore un troisième qui réunissait les deux […], le masculin-féminin. » Mais tout dans ces êtres humains était double, ils avaient donc quatre mains et quatre pieds, deux visages, des parties honteuses doubles, etc. Alors Zeus fut amené à diviser chaque être humain en deux parties, « comme on coupe de part en part les cormes pour en faire des conserves […] Étant donné que l’être entier était maintenant coupé en deux, la désirance poussa les deux moitiés à se rejoindre : elles s’enlaçaient de leurs mains, se mêlaient l’une à l’autre dans le désir de se conjoindre […][10]. »
Devons-nous, à l’invite du philosophe-poète, risquer l’hypothèse que la substance vivante, au moment où elle prit vie, fut déchirée en petites particules, qui depuis lors aspirent à leur réunion de par les pulsions sexuelles ? Que ces pulsions, dans lesquelles se poursuit l’affinité chimique de la matière non douée de vie, surmontent progressivement, à travers le règne des protistes, les difficultés qu’oppose à cette tendance un environnement chargé de stimuli dangereux pour la vie, qui les oblige à la formation d’une couche corticale protectrice ? Que ces fragments dispersés de substance vivante atteignent ainsi à la pluricellularité et finissent par transférer aux cellules germinales, avec le maximum de concentration, la pulsion à la réunion ? Rompons-là, je crois que c’en est ici le moment.
Et pourtant, non sans ajouter quelques mots de réflexion critique. On pourrait me demander si et dans quelle mesure je suis moi-même convaincu des hypothèses développées ici. Je répondrais que je ne suis pas moi-même convaincu et que je ne demande pas non plus aux autres d’y croire. Plus exactement: je ne sais pas dans quelle mesure j’y crois. Il me semble qu’ici le facteur affectif de la conviction n’a pas du tout à entrer en ligne de compte. On peut bien s’abandonner à un cheminement de pensée, le poursuivre aussi loin qu’il mène, par simple curiosité scientifique ou, si l’on veut, en advocatus diaboli qui ne s’est pas pour autant engagé par écrit avec le diable. Je ne méconnais pas que le troisième pas dans la doctrine des pulsions que j’entreprends ici ne peut prétendre à la même certitude que les deux précédents, quand nous avons élargi le concept de sexualité et quand nous avons posé la thèse du narcissisme. Ces innovations étaient des traductions directes de l’observation en théorie, ne comportant pas de plus grandes sources d’erreur qu’il n’est inévitable dans tous les cas semblables. L’affirmation du caractère régressif des pulsions repose aussi, il est vrai, sur du matériel observé, nommément sur les faits de la contrainte de répétition. Mais peut-être ai-je surestimé leur significativité. En tout cas, poursuivre cette idée n’est pas possible autrement qu’en combinant plusieurs fois de suite du factuel avec du pur produit de la pensée, et ainsi en s’éloignant beaucoup de l’observation. On sait que le résultat final acquiert d’autant moins de fiabilité qu’on fait plus souvent cela au cours de l’édification d’une théorie, mais le degré d’incertitude ne peut pas être précisé. On peut ici tout aussi bien connaître la chance d’être tombé juste que la honte de s’être fourvoyé. Dans des travaux de ce genre, je me fie peu à ce qu’on appelle l’intuition ; la façon dont je l’ai envisagée m’a semblé être plutôt le succès d’une certaine impartialité de l’intellect. Sauf que, malheureusement, on est rarement impartial lorsqu’il s’agit des choses dernières, des grands problèmes de la science et de la vie. Je crois que tout un chacun est là dominé par des préférences profondément enracinées à l’intérieur, dont il fait le jeu, sans le savoir, avec sa spéculation. Avec d’aussi bons motifs de méfiance, il ne reste guère d’autre possibilité qu’une bienveillance un peu froide envers les résultats de nos propres efforts de pensée. Je m’empresse toutefois d’ajouter qu’une telle autocritique n’oblige absolument pas à une tolérance particulière envers des opinions divergentes. On est en droit d’écarter impitoyablement des théories que contredisent d’emblée les premiers pas dans l’analyse de l’observation, tout en sachant par ailleurs que l’exactitude de celles qu’on soutient n’est que provisoire. Dans le jugement concernant notre spéculation sur les pulsions de vie et de mort, il nous gênerait peu que s’y rencontrent des processus aussi déconcertants et non visualisables que celui d’une pulsion qui est expulsée par d’autres ou qui se retourne du moi vers l’objet, etc. Cela vient seulement de ce que nous sommes forcés de travailler avec les termes scientifiques, c’est-à-dire avec le langage d’images propre à la psychologie (exactement : à la psychologie des profondeurs). Faute de quoi nous ne pourrions absolument pas décrire les processus correspondants et même nous ne les aurions pas du tout perçus. Les défauts de notre description disparaîtraient vraisemblablement si, à la place des termes psychologiques, nous pouvions déjà mettre les termes physiologiques ou chimiques. Ceux-ci, il est vrai, ne relèvent, eux aussi, que d’un langage d’images, mais qui nous est familier depuis plus longtemps et qui est peut-être aussi plus simple.
En revanche, rendons-nous bien compte que l’incertitude de notre spéculation a été accrue à un haut degré par la nécessité de faire des emprunts à la science biologique. La biologie est en vérité un royaume aux possibilités illimitées ; nous avons à attendre d’elle les éclaircissements les plus surprenants et nous ne pouvons pas deviner quelles réponses elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. Peut-être justement des réponses susceptibles de renverser d’un souffle tout notre édifice artificiel d’hypothèses. Mais dans ces conditions, pourrait-on demander, à quelle fin entreprendre alors des travaux comme ceux consignés dans ce chapitre et pourquoi donc en faire communication ? Eh bien, je ne puis contester que quelques-unes des analogies, connexions et corrélations qui s’y trouvent m’ont paru dignes de considération[11].
[1] Cette phrase et la précédente ont été ajoutées en 1921.
[2] Pour introduire le narcissisme [Zur Einführung des Narzißmus, GW, X ; OCF.P, XII°], Jahrbuch der Psychoanalyse, VI, 1914 [, 1-24].
[3] Ces deux phrases furent ajoutées en 1921.
[4] Mot ajouté en 1921.
[5] « Trois essais sur la théorie sexuelle » [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, GW, V ; OCF.P, VI], dès la première édition de 1905.
[6] Cf. Théorie sexuelle, 4′ éd., 1920 [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie] et « Pulsions et destins de pulsions » [Triebe und Triebschicksale, GW, X ; OCF.P, XIII).
[7] Dans un travail riche de contenu et de pensées, mais qui malheureusement n’est pas toujours pour moi parfaitement transparent, Sabina Spielrein a anticipé toute une partie de cette spéculation. Elle désigne la composante sadique de la pulsion sexuelle comme « destructrice ». (La destruction comme cause du devenir [Die Destruktion als Ursache des Werdens], Jahrbuch für Psychoanalyse, IV, 1912 [465-503]). D’une autre façon encore, A. [August] Starcke (Introduction à la traduction hollandaise de S. Freud, Morale sexuelle « culturelle » et nervosité moderne [Inleiding bij de vertaling van S. Freud, De sexuele beschavingsmoral, Baarn, Hollandia], 1914) a cherché à identifier le concept de libido lui-même avec le concept biologique d’une impulsion à la mort qui devrait être postulé en théorie. (Voir aussi Rank, L’artiste [Der Künstler, Wien, Heller, 1907]). Tous ces efforts, comme ceux de ce texte, témoignent de l’existence du besoin pressant d’une clarification non encore atteinte dans la doctrine des pulsions.
[8] Bien que Weismann (Le plasma germinal, 1892) dénie même cet avantage : « La fécondation ne signifie en aucun cas un rajeunissement ou un renouvellement de la vie ; elle ne serait absolument pas nécessaire à la continuation de la vie ; elle n’est rien qu’un dispositif pour rendre possible la mixtion de deux tendances héréditaires distinctes. » Il considère cependant qu’une telle mixtion a pour effet un accroissement de la variabilité des êtres vivants.
[9] Traduction de U. [Ulrich] v. Wilamowitz-Moellendorff (Platon I, [Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1919], p. 366sq.) [retraduite ici en français].
[10] [Ajout de 1921 :] Sur la provenance du mythe platonicien, je dois au professeur Heinrich Gomperz, de Vienne, les indications suivantes que je reproduis ici partiellement dans ses propres termes : j’aimerais attirer l’attention sur le fait que la même théorie se retrouve déjà pour l’essentiel dans les Upanishads. Car dans l’Upanishad Brihad-Aranyaka, 1, 4, 3 (Deussen, 60 Upanishads du Véda, p. 393), où est décrite l’émergence du monde à partir de l’Atman (le soi ou moi) on lit : « … Mais il (l’Atman, le soi ou le moi) n’avait en effet aucune joie ; c’est ainsi que n’a aucune joie celui qui est seul. Il eut alors le désir d’un second. C’est qu’il était aussi grand qu’une femme et un homme quand ils se tiennent enlacés. Ce soi, qui était sien, il le divisa en deux parties : de là naquirent époux et épouse. C’est pourquoi ce corps échu au soi est semblable à une demi-part, ainsi l’a expliqué en effet Yâjnavalkya. Et c’est pourquoi cet espace vide est ici rempli par la femme. »
L’Upanishad Brihad-Aranyaka est la plus ancienne de toutes les Upanishad et aucun chercheur compétent ne la situerait plus tard qu’en l’an 800av. J.-C. environ. À la question de savoir s’il est possible qu’il existe une dépendance, serait-ce indirecte, de Platon à l’égard de ces pensées indiennes, je n’apporterai pas forcément une réponse négative, contrairement à l’opinion dominante, car une telle possibilité ne peut être contestée non plus pour la doctrine de la transmigration des âmes. Une telle dépendance, d’abord par l’intermédiaire des Pythagoriciens, n’ôterait guère de significativité à cette rencontre de pensées, car Platon n’aurait pas fait sienne une semblable histoire venue jusqu’à lui d’une tradition orientale, et lui aurait encore moins assigné une place aussi significative, si ce qu’elle contient de vérité ne lui avait à lui-même sauté aux yeux.
Dans un article de K. Ziegler, Devenir des hommes et des mondes [Menschen und Weltenwerden) (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, t. 31, p.529 sq., 1913), qui s’occupe d’explorer méthodiquement cette pensée problématique avant Platon, celle-ci est ramenée à des représentations babyloniennes.
[11] Ici, quelques mots encore pour clarifier notre nomenclature qui, au cours de ces discussions, a suivi une certaine évolution. Ce que sont les « pulsions sexuelles », nous le savions par leur relation aux sexes et à la fonction de reproduction. Nous conservâmes ensuite ce nom lorsque nous fûmes obligés par les résultats de la psychanalyse de rendre plus lâche leur relation à la reproduction. Quand nous eûmes posé la thèse de la libido narcissique et étendu le concept de libido aux cellules individuelles, nous vîmes la pulsion sexuelle se transformer en l’Éros, qui cherche à pousser l’une vers l’autre et à maintenir en cohésion les parties de la substance vivante, et ce qu’on appelle communément les pulsions sexuelles apparut comme la part de cet Éros tournée vers l’objet. La spéculation veut que cet Éros soit à l’œuvre dès le début de la vie et qu’il entre comme « pulsion de vie » en opposition avec la « pulsion de mort » qui est apparue du fait que l’inorganique a pris vie. Elle tente de résoudre l’énigme de la vie en faisant l’hypothèse de ces deux pulsions en lutte l’une contre l’autre dès les primes origines. [Ajout de 1921 :] Il est peut-être plus difficile d’avoir une vue d’ensemble de la transformation qu’a connue le concept de« pulsions du moi ». À l’origine, nous appelions ainsi toutes les directions pulsionnelles, connues de nous approximativement, qui peuvent se démarquer des pulsions sexuelles dirigées sur l’objet et nous mettions les pulsions du moi en opposition avec les pulsions sexuelles dont l’expression est la libido. Plus tard, nous nous rapprochâmes de l’analyse du moi et reconnûmes qu’une partie des « pulsions du moi » est elle aussi de nature libidinale et a pris le moi propre pour objet. Il fallait donc mettre désormais les pulsions d’autoconservation narcissiques au nombre des pulsions sexuelles libidinales. L’opposition entre pulsions du moi et pulsions sexuelles se transformait en l’opposition entre pulsions du moi et pulsions d’objet, les unes et les autres de nature libidinale. Mais à la place de la première opposition en apparut une nouvelle, entre les pulsions libidinales (pulsions du moi et d’objet) et d’autres pulsions dont il faut poser l’existence dans le moi et qu’il faut peut-être reconnaître dans les pulsions de destruction. La spéculation transmue cette opposition en celle des pulsions de vie (Éros) et des pulsions de mort.
numéro 2020-3 Analyse terminable ?
Sur l’engagement du traitement
OCF.P, XII : 161-184. Paris, Puf, 2005
Sur la question de la fin de l’analyse, le texte de Freud qui s’impose est évidemment L’analyse finie, l’analyse infinie (1937). Mais à considérer qu’une cure ne peut trouver sa fin qu’à condition d’avoir véritablement commencé, le texte de 1913, « Sur l’engagement du traitement », nous a semblé un complément intéressant à celui de 1937, dont nous avons souvent donné des extraits dans cette rubrique.
[…]Les dispositions concernant le temps et l’argent sont des points importants au commencement de la cure analytique.
Pour ce qui est du temps, je suis exclusivement le principe de la location d’une heure déterminée. Chaque patient se voit attribuer une certaine heure dans les disponibilités de ma journée de travail ; cette heure est la sienne, il en reste redevable, même s’il ne l’utilise pas. Cette disposition qui, dans notre bonne société, passe pour aller de soi concernant le professeur de musique ou de langue paraît peut-être bien dure pour le médecin, et même indigne de sa condition. On sera enclin à évoquer les nombreux incidents fortuits qui peuvent empêcher le patient de se présenter chez le médecin chaque fois à l’heure dite et on exigera que soient prises en compte les multiples affections intercurrentes qui peuvent se produire au cours d’un traitement analytique relativement long. Or voici ma réponse : c’est comme cela et pas autrement. Quand la pratique est plus souple, les annulations « occasionnelles » sont si fréquentes que le médecin voit son existence matérielle mise en danger. Quand on respecte rigoureusement cette disposition, il s’avère par contre que les empêchements fortuits ne se présentent pas du tout et que les affections intercurrentes ne sont que très rares. On n’est presque jamais mis en situation de bénéficier d’un moment de loisir dont on aurait à avoir honte du fait qu’on est rémunéré; on peut poursuivre le travail sans perturbation et on échappe à cette expérience pénible et déroutante que doive toujours survenir une suspension indue dans le travail justement quand celui-ci promettait d’être important et riche de contenu. On n’acquiert une véritable conviction de la signification de la psychogenèse dans la vie quotidienne des êtres humains, de la fréquence des « maladies de l’écolier » et de l’inanité du hasard qu’après avoir exercé la psychanalyse quelques années durant, en suivant rigoureusement le principe de la location des heures. Dans le cas d’affections indubitablement organiques, qui ne sauraient malgré tout être exclues du fait de leur intérêt psychique, j’interromps le traitement et je m’estime en droit d’attribuer autrement l’heure libérée, je reprends le patient dès qu’il est rétabli et que j’ai retrouvé une autre heure de libre.
Je travaille quotidiennement avec mes patients, à l’exception des dimanches et des jours de grande fête, donc habituellement six fois par semaine. Pour les cas légers ou pour la poursuite des traitements qui ont grandement progressé, trois séances par semaine suffisent d’ailleurs. Sinon, les restrictions de temps ne procurent d’avantage ni au médecin ni au patient ; au début, elles sont totalement à rejeter. Même de courtes interruptions ne manquent jamais d’ébranler un peu le travail; nous avions coutume de parler en plaisantant d’une « croûte du lundi » au moment de reprendre après le repos du dimanche ; quand le travail est moins fréquent, on court le risque que l’on ne puisse pas tenir le même pas que l’expérience de vie réelle du patient, que la cure perde le contact avec le présent et qu’elle soit poussée sur des voies latérales. Il arrive aussi que l’on tombe sur des malades auxquels on doit consacrer plus de temps que la moyenne d’une heure, parce qu’ils emploient la plus grande partie de l’heure à se dégeler, à devenir tout simplement communicatifs.
Une question déplaisante pour le médecin, et que le malade lui adresse au tout début, est la suivante : Combien de temps le traitement va-t-il durer ? De combien de temps avez-vous besoin pour me délivrer de ma souffrance ? Si l’on a proposé un traitement probatoire de quelques semaines, on se soustrait à une réponse directe à cette question en promettant de pouvoir donner un avis plus fiable une fois écoulée la période probatoire. On fait en quelque sorte la même réponse que l’Ésope de la fable au voyageur qui l’interroge sur la longueur du chemin en lui enjoignant : Marche ![1], et l’on commente cette consigne en donnant pour raison que l’on doit d’abord connaître le pas du voyageur avant de pouvoir calculer la durée de son voyage. Avec cet expédient on se tire des premières difficultés, mais la comparaison n’est pas bonne, car le névrosé peut facilement modifier son rythme et ne faire à certains moments que des progrès très lents. En vérité, il n’est guère possible de répondre à la question concernant la durée prévisible du traitement.
L’absence de clairvoyance des malades et l’insincérité des médecins ont pour effet conjoint de poser à l’analyse les exigences les plus démesurées, tout en lui accordant le temps le plus bref qui soit. Je communiquerai par exemple les données suivantes tirées d’une lettre d’une dame de Russie qui m’est parvenue il y a quelques jours. Elle a 53 ans[2], souffre depuis 23 ans et n’est plus capable d’aucun travail suivi depuis dix ans. Son « traitement dans plusieurs établissements de soins pour nerveux » n’a pas pu lui rendre possible une « vie active ». Elle espère être totalement guérie par la psychanalyse dont elle a eu connaissance par ses lectures, mais son traitement a déjà tellement coûté à sa famille qu’elle ne peut séjourner à Vienne plus de six semaines ou deux mois. À quoi s’ajoute la difficulté que dès le début elle ne veut « s’expliquer » que par écrit, car toucher à ses complexes provoquerait chez elle une explosion, ou bien la « rendrait temporairement muette » – Personne ne s’attendrait d’ordinaire à ce qu’on soulève de deux doigts une lourde table comme s’il s’agissait d’un léger tabouret ou qu’on puisse bâtir une grande maison dans le même laps de temps qu’une cabane en bois, et pourtant dès qu’il s’agit des névroses, qui ne semblent pas encore de nos jours avoir trouvé leur place dans l’ensemble de la pensée humaine, même les personnes intelligentes oublient la nécessaire proportionnalité entre le temps, le travail et le résultat. C’est là par ailleurs une conséquence bien concevable de la profonde ignorance de l’étiologie des névroses. Du fait de cette ignorance, la névrose est pour ces personnes une sorte de « jeune fille venue d’ailleurs[3] ». On ne savait d’où elle venait, c’est pourquoi on s’attend à ce qu’un jour elle ait disparu.
Les médecins confortent cette confiance bienheureuse ; même ceux d’entre eux qui savent n’apprécient pas convenablement dans bien des cas la gravité des affections névrotiques. Un confrère de mes amis que j’estime au plus haut point pour m’être converti, après plusieurs décennies d’un travail scientifique fondé sur d’autres présupposés, à la pleine reconnaissance de la psychanalyse, m’écrivait un jour : Ce qu’il nous faut, c’est un traitement bref, commode, ambulatoire, des névroses de contrainte. Je ne pouvais répondre à sa demande, j’eus honte et je cherchai à m’excuser en faisant remarquer que même les généralistes seraient vraisemblablement très satisfaits d’une thérapie de la tuberculose ou du cancer qui réunirait ces avantages.
Pour le dire plus directement, il s’agit toujours en psychanalyse de périodes longues, demi-années ou années entières, plus longues que celles auxquelles le malade s’attend. C’est pourquoi on a l’obligation de révéler au malade cet état de choses avant qu’il ne finisse par se décider à entreprendre le traitement. Je tiens, somme toute, comme plus digne, mais également comme plus approprié, d’attirer d’emblée son attention – sans aller précisément jusqu’à l’effrayer – sur les difficultés et les sacrifices propres à la thérapie analytique et de lui ôter ainsi tout droit d’affirmer plus tard qu’on l’aurait entraîné dans ce traitement, dont il n’aurait pas connu l’ampleur et la significativité. Celui qui se laisse arrêter par de telles communications se serait de toute façon révélé plus tard impropre à l’analyse. Il est bon, avant le commencement du traitement, de procéder à une sélection de ce type ; mais à mesure que les éclaircissements font leur chemin parmi les malades, le nombre de ceux qui réussissent cette première épreuve s’accroît.
Je refuse d’obliger les patients à respecter une certaine durée où il faut persévérer dans le traitement, je permets à chacun d’interrompre la cure quand il lui plaît, sans lui cacher pourtant qu’une rupture après un travail de courte durée ne sera suivie d’aucun résultat et qu’elle peut facilement, telle une opération inachevée, le mettre dans un état insatisfaisant. Dans les premières années de mon activité psychanalytique, je rencontrais la plus grande difficulté à amener les malades à rester ; ces difficultés se sont depuis longtemps déplacées, à présent je dois m’efforcer avec angoisse de les obliger aussi à s’arrêter.
Abréger la cure analytique demeure un souhait justifié : comme nous allons le voir, on tend à son accomplissement par divers moyens. S’y oppose malheureusement un facteur très significatif : la lenteur avec laquelle s’effectuent les modifications animiques en profondeur, et en dernier lieu certainement l’« atemporalité » de nos processus inconscients. Lorsque les malades sont mis devant la difficulté que constitue la grande dépense de temps requise par l’analyse, il n’est pas rare qu’ils s’entendent à proposer un certain expédient. Ils répartissent leurs maux entre ceux qu’ils décrivent comme insupportables et d’autres comme accessoires, et disent : Si seulement vous me libérez de l’un d’entre eux (par ex. du mal de tête, de telle angoisse déterminée), je ferai bien moi-même mon affaire de l’autre dans la vie. Mais ils surestiment ainsi le pouvoir électif de l’analyse. À coup sûr, le médecin est capable de beaucoup, mais il ne peut pas déterminer avec précision ce qu’il arrivera à faire. Il engage un processus, celui de la résolution des refoulements existants, il peut le surveiller, le promouvoir, écarter du chemin les obstacles, il peut aussi à coup sûr y gâcher beaucoup de choses. Mais dans l’ensemble le processus, une fois engagé, va son propre chemin et ne se laisse prescrire ni son orientation ni la succession des points qu’il aborde. Il en va donc du pouvoir de l’analyste sur les manifestations de la maladie à peu près comme de la puissance masculine. L’homme le plus vigoureux peut certes engendrer un enfant tout entier, mais il ne peut faire naître dans l’organisme féminin seulement une tête, un bras ou une jambe ; il ne peut même pas décider du sexe de l’enfant. Il ne fait d’ailleurs là qu’engager un processus hautement embrouillé et déterminé par d’anciens événements, qui prend fin avec le détachement de l’enfant d’avec sa mère. La névrose d’un être humain possède aussi les caractères d’un organisme, ses manifestations partielles ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles se conditionnent les unes les autres, elles ont coutume de se soutenir mutuellement ; on ne souffre jamais que d’une seule névrose, et non de plusieurs qui se seraient fortuitement rejointes dans un individu. Le malade que l’on a, conformément à son souhait, libéré de l’unique symptôme insupportable pourrait facilement faire l’expérience que désormais un symptôme jusqu’alors modéré s’accroisse jusqu’à l’insupportable. Celui qui, d’une façon générale, voudrait détacher autant que possible le résultat de ses conditions suggestives (c.-à-d. transférentielles) fera bien de renoncer également à ces traces d’une influence élective sur le résultat thérapeutique, qui sont en quelque sorte le fait du médecin. Le psychanalyste ne peut que préférer ceux de ses patients qui exigent qu’il leur donne une santé pleine et entière, pour autant qu’on puisse l’avoir, et qui mettent à sa disposition tout le temps que requiert le processus de rétablissement. Naturellement, on ne peut s’attendre à des conditions aussi favorables que dans peu de cas.
[…]Avant de clore ces remarques sur l’engagement du traitement analytique, un mot encore sur uncertain cérémonial propre à la situation dans laquelle la cure est conduite. Je tiens ferme à ce conseil de faire s’allonger le malade sur un lit de repos, alors qu’on prend place derrière lui de façon à n’être pas vu de lui. Cet aménagement a un sens historique, il est le reste du traitement hypnotique à partir duquel la psychanalyse s’est développée. Mais il mérite d’être maintenu pour de multiples raisons. D’abord pour un motif personnel, mais que d’autres peuvent bien partager avec moi. Je ne supporte pas d’être dévisagé par les autres huit heures par jour (ou plus longtemps). Comme pendant l’écoute je m’abandonne moi-même au cours de mes pensées inconscientes, je ne veux pas que mes mimiques procurent au patient matière à interprétation ou l’influencent dans ce qu’il communique. Le patient conçoit habituellement la situation à laquelle il est contraint comme une privation et il se rebelle contre elle, en particulier lorsque la pulsion de regarder (le voyeurisme) joue un rôle significatif dans sa névrose. Mais je persiste à faire valoir cette mesure qui a pour visée et pour résultat de prévenir le mélange imperceptible du transfert avec les idées incidentes du patient, d’isoler le transfert et de le faire ressortir au bon moment comme résistance avec des contours précis. Je sais que beaucoup d’analystes font autrement, mais je ne sais pas si ce qui participe le plus à leur divergence est la rage de faire autrement ou bien un avantage qu’ils y ont trouvé.
Lorsque les conditions de la cure sont réglées de cette façon, la question se pose de savoir sur quel point et avec quel matériel on doit commencer le traitement.
Il est totalement indifférent de savoir avec quel matériau on commence le traitement, si c’est avec l’histoire de vie, l’histoire de maladie ou les souvenirs d’enfance du patient. Mais en tout cas de manière à ce qu’on laisse raconter le patient et qu’on lui donne le libre choix de son point de départ. On lui dit donc : « Avant de pouvoir vous dire quelque chose, je dois en avoir appris beaucoup sur vous ; communiquez-moi, s’il vous plaît, ce que vous savez de vous. »
C’est seulement pour la règle fondamentale de la technique psychanalytique à observer par le patient que l’on fait une exception. On la lui fait connaître dès le tout début : Encore une chose avant que vous ne commenciez. Votre récit doit pourtant sur un point se différencier d’une conversation habituelle. Alors que d’ordinaire vous essayez à bon droit de maintenir dans votre présentation le fil de la cohérence et que vous écartez toutes les idées incidentes et pensées adventices perturbantes pour ne pas, comme on dit, discourir à perte de vue, vous devez ici procéder autrement. Vous observerez que pendant votre récit vous viendront diverses pensées que vous aimeriez repousser en recourant à certaines objections critiques. Vous serez tenté de vous dire : Telle ou telle chose ne relève pas ici du sujet, ou bien elle est dénuée de toute importance, ou bien elle est dénuée de sens, et on n’a donc pas besoin de la dire. Ne cédez jamais à cette critique et dites la chose malgré tout, cela précisément parce que vous éprouvez une aversion à le faire. La raison de cette prescription – à vrai dire la seule que vous deviez suivre –, c’est plus tard que vous l’apprendrez et saurez la comprendre. Dites donc tout ce qui vous passe par l’esprit. Conduisez-vous par exemple à la manière d’un voyageur, assis côté fenêtre dans un wagon de chemin de fer, qui décrit à quelqu’un d’installé à l’intérieur le paysage se modifiant sous ses yeux. Enfin, n’oubliez pas que vous avez promis une totale franchise et ne passez jamais sur quelque chose parce que, pour une raison ou une autre, la communication vous en serait désagréable[4].
Les patients qui calculent leur état de maladie à partir d’un moment déterminé se repèrent habituellement par rapport à la circonstance occasionnant la maladie ; d’autres, qui ne méconnaissent pas eux-mêmes la corrélation entre la névrose et leur enfance, commencent souvent par la présentation de toute leur histoire de vie. On ne s’attendra en aucun cas à un récit systématique et on ne fera rien pour le favoriser. Chaque parcelle de l’histoire devra plus tard être racontée de nouveau, et c’est seulement lors de ces répétitions qu’apparaîtront les ajouts qui livrent les corrélations importantes, inconnues du malade. Il y a des patients qui dès les premières séances se préparent soigneusement à leur récit, soi-disant pour assurer une meilleure exploitation du temps du traitement. Ce qui se drape ainsi sous les plis du zèle est de la résistance. On déconseillera une telle préparation qui n’a pour but que de se protéger contre l’émergence d’idées incidentes non souhaitées[5]. Le malade a beau croire en toute franchise à sa louable intention, la résistance exigera sa part dans cette sorte de préparation intentionnelle et parviendra à ce que le matériel le plus précieux échappe à la communication. On ne tardera pas à remarquer que le patient invente encore d’autres méthodes pour soustraire au traitement ce qui est demandé. Il s’entretiendra par exemple quotidiennement de la cure avec un ami intime et logera dans cette conversation toutes les pensées qui devraient s’imposer à lui en présence du médecin. La cure comporte alors une fuite par où s’écoule précisément le meilleur. Il sera alors bientôt temps de conseiller au patient de traiter sa cure analytique comme une affaire entre son médecin et lui-même et d’exclure de la confidence toutes les autres personnes, si proches ou si curieuses soient-elles. À des stades ultérieurs du traitement, le patient n’est pas, en règle générale, soumis à de telles tentations.
Les malades qui veulent tenir secret leur traitement, souvent parce qu’ils ont également tenu secrète leur névrose, je ne leur fais pas de difficultés. Tant pis, naturellement, si par suite de cette réserve quelques-uns des plus beaux résultats thérapeutiques manquent de faire leur effet sur le monde contemporain. Le fait que les patients optent pour le secret met déjà bien évidemment en lumière un trait de leur histoire secrète.
Si l’on enjoint aux malades de ne mettre dans la confidence, au commencement du traitement, qu’un minimum de personnes, on les protège par là même aussi dans une certaine mesure des nombreuses influences hostiles qui tenteront de les détacher de l’analyse. Les influences ainsi exercées peuvent être pernicieuses au début de la cure. Par la suite, elles sont la plupart du temps indifférentes, ou même utiles pour mettre au jour les résistances qui veulent se cacher.
Si pendant le traitement analytique le patient a temporairement besoin d’une autre thérapie généraliste ou spécialisée, il est bien plus opportun de solliciter un confrère non-analyste que de se charger soi-même de ces autres soins. Les traitements combinés pour des souffrances névrotiques à fort étayage organique sont la plupart du temps impraticables. Les patients détournent leur intérêt de l’analyse dès qu’on leur montre plus d’une voie susceptible de mener à la guérison. Le mieux est d’ajourner le traitement organique jusqu’à la conclusion du traitement psychique ; si l’on mettait en premier le traitement organique, il resterait dans la plupart des cas sans résultat.
Revenons à l’engagement du traitement. On rencontrera à l’occasion des patients qui commencent leur cure par une récusation, en assurant que rien ne leur vient à l’idée qu’ils puissent raconter, bien que le domaine entier de leur histoire de vie et de maladie s’offre intact à leurs yeux. On n’accédera pas à la prière qu’ils nous adressent de leur indiquer tout de même de quoi ils doivent parler, cette première fois aussi peu que les fois suivantes. On ne perdra pas de vue à quoi on a affaire dans de tels cas. Une forte résistance est montée là en première ligne pour défendre la névrose ; on relèvera le défi et on prendra la résistance à bras-le-corps. En assurant le patient de façon énergique et répétée qu’il n’y a pas au début une semblable absence de toute idée incidente et qu’il s’agit d’une résistance contre l’analyse, on l’oblige bientôt à faire les aveux attendus ou bien on met à découvert une première part de ses complexes. Cela se présente mal s’il doit avouer que pendant qu’il écoutait la règle fondamentale il s’est ménagé une réserve, à savoir qu’il va garder pour lui telle ou telle chose. La chose est moins grave si tout ce qu’il a à nous communiquer, c’est la méfiance qu’il éprouve à l’égard de l’analyse ou les choses effroyables qu’il a entendues à son sujet. S’il conteste ces possibilités et d’autres semblables qu’on lui présente, on peut, en faisant pression sur lui, l’obliger à avouer qu’il a malgré tout négligé certaines pensées qui l’occupent. Il a pensé à la cure elle-même, mais à rien de précis, ou bien c’est l’image de la pièce où il se trouve qui l’a occupé, ou bien il est forcé de penser aux objets qu’il y a dans le cabinet de traitement, et aussi qu’il est allongé ici sur un divan, toutes choses qu’il a remplacées par cet expédient : « rien ». Ces indications sont fort compréhensibles ; tout ce qui se rattache à la situation présente correspond à un transfert sur le médecin, qui s’avère approprié à une résistance. On est ainsi obligé de commencer par mettre à découvert ce transfert ; c’est en partant de lui qu’on trouve rapidement la voie pour pénétrer dans le matériel pathogène du malade. Ce sont les femmes s’attendant d’après le contenu de leur histoire de vie à une agression sexuelle, ce sont les hommes avec une homosexualité refoulée excessivement forte, qui seront les plus enclins à opposer à l’analyse le préalable d’un tel refus des idées incidentes.
Tout comme la première résistance, les premiers symptômes ou les premières actions fortuites des patients peuvent aussi prétendre à un intérêt particulier et trahir un complexe qui domine leur névrose. Un jeune philosophe plein d’esprit, aux orientations esthétiques choisies, s’empresse de rectifier le pli de son pantalon avant de s’allonger pour commencer le traitement ; il s’avère qu’il avait été jadis un coprophile au raffinement extrême, comme il fallait s’y attendre pour un futur esthète. Une jeune fille dans la même situation tire hâtivement l’ourlet de sa jupe sur sa cheville qui dépasse ; elle a ainsi trahi le meilleur de ce que l’analyse mettra plus tard à découvert, la fierté qu’elle tire de la beauté de son corps et ses penchants exhibitionnistes.
Un nombre particulièrement élevé de patients se rebellent contre la position allongée qui leur est proposée, alors que le médecin est assis derrière eux sans être vu, et demandent la permission de faire tout le traitement dans une autre position, le plus souvent parce qu’ils ne veulent pas se passer de la vue du médecin. Cela leur est régulièrement refusé, mais on ne peut les empêcher de s’arranger pour dire quelques phrases avant le commencement de la « séance » ou après l’annonce de la fin de celle-ci, une fois qu’ils se sont levés. Pour eux le traitement se divise en une tranche officielle pendant laquelle ils se comportent la plupart du temps avec beaucoup d’inhibition, et une autre, « intime », où ils parlent vraiment en toute liberté et communiquent toutes sortes de choses qu’ils ne mettent pas eux-mêmes au compte du traitement. Le médecin ne consent pas longtemps à cette séparation, il note bien ce qui a été dit avant et après la séance et, en en tirant parti à la première occasion, il abat la cloison de séparation que le patient voulait élever. Celle-ci sera montée de nouveau à partir du matériel d’une résistance transférentielle.
Tant que les communications et idées incidentes du patient se produisent sans marquer d’arrêt, on laissera intact le thème du transfert. On attendra pour cette procédure, la plus épineuse de toutes, que le transfert soit devenu résistance.
La question suivante devant laquelle nous nous trouvons placés est une question principielle. Elle s’énonce ainsi : Quand devons-nous commencer à faire des communications à l’analysé ? Quand est-il temps de lui dévoiler la signification secrète de ses idées incidentes, de l’initier aux présupposés et procédures techniques de l’analyse ?
La réponse ne peut que s’énoncer ainsi : pas avant que ne se soit instauré chez le patient un transfert efficace, un rapport véritable. Le premier but du traitement est bien d’attacher le patient à la cure et à la personne du médecin. Pour cela on n’a rien d’autre à faire que de lui laisser du temps. Lorsqu’on témoigne au patient un intérêt sérieux, qu’on élimine soigneusement les résistances qui émergent au début et qu’on évite certaines interventions malencontreuses, celui-ci instaure de lui-même un tel attachement et relie le médecin à l’une des imagines[6] de toute cette série de personnes dont il avait l’habitude de recevoir des marques d’amour. On peut toutefois compromettre ce premier résultat quand on adopte dès le début un autre point de vue que celui de l’empathie, par exemple un point de vue moralisateur, ou quand on se conduit comme le représentant ou le mandataire d’une des parties, par exemple de l’autre conjoint, etc[7].
Cette réponse inclut naturellement la condamnation d’un procédé qui prétendrait communiquer au patient les traductions de ses symptômes dès qu’on les a soi-même devinées, ou qui irait jusqu’à considérer comme un triomphe particulier de lui jeter en pleine figure ces « solutions » dès la première rencontre. Il n’est pas difficile à un analyste relativement exercé d’entendre déjà de façon nettement perceptible dans les plaintes et le rapport de maladie d’un malade les souhaits que ce dernier retient par-devers lui ; mais quel degré d’autocomplaisance et d’irréflexion ne faut-il pas pour révéler à un étranger dont on vient à peine de faire la connaissance et qui n’a aucune familiarité avec tous les présupposés analytiques, qu’il est attaché incestueusement à sa mère, qu’il nourrit des souhaits de mort à l’égard de sa femme prétendument aimée, qu’il cultive l’intention de berner son chef, etc. ! J’ai entendu dire qu’il y a des analystes qui se targuent de semblables diagnostics instantanés et traitements-éclair, mais je mets en garde quiconque voudrait suivre de tels exemples. On jettera ainsi un total discrédit sur soi et sur sa cause et l’on suscitera même les protestations les plus violentes, que l’on ait deviné juste ou pas ; à vrai dire, on suscitera même une résistance d’autant plus violente que l’on aura deviné juste. En règle générale, l’effet thérapeutique sera dans l’immédiat égal à zéro et la frayeur provoquée par l’analyste sera définitive. Même à des stades ultérieurs du traitement, on devra user de prudence pour ne pas communiquer une solution de symptôme ou une traduction de souhait tant que le patient ne s’en trouvera pas tout près, au point de n’avoir plus qu’un petit pas à faire pour s’emparer lui-même de cette solution. Dans les toutes premières années, j’ai eu fréquemment l’occasion d’apprendre que la communication prématurée d’une solution entraînait pour la cure une fin prématurée, tant du fait des résistances si subitement éveillées qu’en raison du soulagement accompagnant la solution.
On fera ici l’objection suivante : Notre tâche est-elle donc de prolonger le traitement et n’est-ce pas plutôt de le conduire aussi rapidement que possible à sa fin ? Le malade ne souffre-t-il pas à cause de son non-savoir et de son non-comprendre et n’est-ce pas un devoir de lui donner accès au savoir aussitôt que possible, aussitôt donc que le médecin lui-même y a eu accès ?
Répondre à cette question nous invite à faire une petite digression sur la significativité du savoir et sur le mécanisme de la guérison en psychanalyse.
Dans les tout premiers temps de la technique analytique, nous avons – il est vrai dans une attitude de pensée intellectualiste – accordé une grande valeur au savoir du malade touchant ce qui était oublié de lui et nous avons en cela à peine différencié notre savoir du sien. Nous considérions comme une chance toute particulière de réussir à obtenir d’une autre source – par exemple les parents, les personnes qui ont pris soin de lui ou le séducteur lui-même, comme cela fut possible dans tel ou tel cas – des renseignements sur son trauma d’enfance oublié ; et nous nous empressions de porter à la connaissance du malade l’information et les preuves de son exactitude, dans l’attente assurée de conduire ainsi la névrose et le traitement à une fin rapide. Ce fut une grave déception de voir le résultat escompté faire défaut. Comment pouvait-il donc se faire que le malade qui savait maintenant ce qu’il en était de son expérience vécue traumatique se soit pourtant conduit comme s’il n’en savait pas plus qu’autrefois ? À la suite de la communication et de la description du trauma refoulé, pas même le souvenir de celui-ci ne voulait émerger.
Dans un cas bien déterminé, la mère d’une jeune fille hystérique m’avait révélé l’expérience vécue homosexuelle à laquelle revenait une grande influence sur la fixation des accès de la jeune fille. La mère avait elle-même surpris la scène, mais la malade l’avait complètement oubliée, bien que celle-ci se situât déjà dans les années de la prépuberté. Je pus alors faire une expérience instructive. Chaque fois que je répétais le récit de la mère devant la jeune fille, celle-ci réagissait par un accès hystérique, après quoi ce qui avait été communiqué était de nouveau oublié. Il n’y avait pas de doute que la malade manifestait la plus violente résistance à l’égard d’un savoir qui lui était imposé ; elle finit par simuler la débilité mentale et une totale perte de mémoire pour se protéger contre ce que je communiquais. Ainsi on devait donc se résoudre à retirer au savoir en tant que tel la significativité qu’on lui avait attribuée et à mettre l’accent sur les résistances qui avaient en leur temps causé le non-savoir et qui à présent étaient encore prêtes à le défendre. Mais le savoir conscient, même sans avoir été une nouvelle fois expulsé, était face à ces résistances impuissant.
Le comportement déconcertant des malades qui s’entendent à unir un savoir conscient avec un non-savoir reste inexplicable pour ce qu’on appelle la psychologie normale. Ce comportement ne fait aucune difficulté à la psychanalyse en raison de sa reconnaissance de l’inconscient : mais le phénomène décrit est l’un des meilleurs arguments à l’appui d’une conception qui met davantage à sa portée les processus animiques en les différenciant topiquement. Or les malades savent dans leur pensée ce qu’il en est de l’expérience vécue refoulée, mais il manque à cette pensée la liaison avec ce lieu où est contenu, d’une façon ou d’une autre, le souvenir refoulé. Une modification ne peut survenir que lorsque le processus de pensée conscient a opéré sa poussée jusqu’à ce lieu et a surmonté là les résistances de refoulement. C’est exactement comme si avait été promulgué au ministère de la Justice un décret en vertu duquel il faut juger les délits de la jeunesse avec une certaine indulgence. Tant que ce décret n’est pas parvenu à la connaissance de chacun des tribunaux de district, ou pour le cas où les juges de district n’auraient pas l’intention de s’y conformer, mais auraient bien plutôt celle de juger de leur propre chef, rien ne peut être changé au traitement de chacun des jeunes délinquants. Ajoutons encore, à titre de correction, que la communication consciente du refoulé au malade ne reste pourtant pas sans effet. Elle ne produira pas l’effet souhaité – mettre fin aux symptômes –, mais aura d’autres conséquences. Elle suscitera d’abord des résistances, mais ensuite, lorsque celles-ci auront été surmontées, un procès de pensée au cours duquel se met enfin en place l’influence escomptée s’exerçant sur le souvenir inconscient.
Il est maintenant temps d’acquérir une vue d’ensemble du jeu de forces que nous enclenchons par le traitement. Le moteur immédiat de la thérapie est la souffrance du patient et le souhait de guérison qui en découle pour lui. De la grandeur de cette force de pulsion viennent se soustraire bien des choses qui ne sont mises à découvert qu’au cours de l’analyse, avant tout le bénéfice secondaire de la maladie, mais la force de pulsion elle-même doit rester maintenue jusqu’à la fin du traitement ; chaque amélioration provoque une réduction de celle-ci. À elle seule elle est cependant incapable d’éliminer la maladie, il lui manque pour cela deux choses : elle ne connaît pas les voies à emprunter pour atteindre cette fin et elle ne rallie pas contre les résistances les montants d’énergie nécessaires. Le traitement analytique remédie à ces deux manques. Les grandeurs d’affect requises pour surmonter les résistances, il les fournit en mobilisant les énergies qui sont prêtes pour le transfert ; par les communications faites en temps opportun, il montre au malade les voies sur lesquelles il doit diriger ces énergies. Le transfert peut assez fréquemment éliminer à lui seul les symptômes de souffrance, mais alors seulement de façon provisoire, aussi longtemps précisément qu’il existe lui-même. C’est alors un traitement suggestif, non une psychanalyse. Le traitement ne mérite ce dernier nom que lorsque le transfert a utilisé son intensité pour le surmontement des résistances. Alors seulement être malade est devenu impossible, même si le transfert a été résolu à son tour, comme le veut sa destination.
Au cours du traitement, un autre facteur favorisant est encore éveillé, l’intérêt et la compréhension intellectuels du malade. Mais ce facteur n’entre guère en ligne de compte face aux autres forces en lutte les unes contre les autres ; il est constamment menacé de dévalorisation par suite de l’obscurcissement du jugement qui provient des résistances. Ne restent ainsi que transfert et instruction (par la communication) comme nouvelles sources de forces dont le malade est redevable à l’analyste. Mais le malade ne se sert de l’instruction que dans la mesure où il y est amené par le transfert ; pour cette raison la première communication doit attendre que se soit instauré un puissant transfert, et pour cette même raison, ajouterons-nous, toute communication ultérieure doit attendre que soit éliminée la perturbation du transfert par les résistances transférentielles émergeant l’une après l’autre.
[1] L’anecdote est introuvable dans les fables d’Ésope, mais la réplique est en revanche attribuée à Till l’Espiègle.
[2] Dans les éditions antérieures à 1925 : 33 ans.
[3] Allusion au titre du poème de Schiller, « Das Mädchen aus der Fremde » (« La fille venue d’ailleurs », 1797), dont Freud reprend partiellement les vers 6-8 : « On ne savait pas d’où elle venait/ Et sa trace avait vite disparu/ Sitôt qu’elle prenait congé. »
[4] Sur les expériences que l’on fait avec la règle fondamentaleil y aurait beaucoup à dire. Il arrive qu’on rencontre des personnes qui se conduisent comme si elles s’étaient donné elles-mêmes cette règle. D’autres pèchent contre elle dès le tout début. Ce qu’elles communiquent est dans les premiers stades du traitement indispensable et même profitable ; plus tard, sous la domination des résistances, l’obéissance envers la règle est défaillante, et pour chacun viendra un jour le moment d’y passer outre. On doit se rappeler, en partant de son autoanalyse, quelle irrésistible tentation surgit de céder à ces prétextes critiques visant à écarter les idées incidentes. Onpeut régulièrement se convaincre de la faible efficacité des contrats que l’on conclut avec le patient en posant la règle fondamentale psychanalytique, lorsque survient pour la première fois quelque chose d’intime à communiquer concernant de tierces personnes. Le patient sait qu’il doit tout dire, mais il fait de la discrétion envers d’autres personnes un nouvel empêchement. « Dois-je vraiment tout dire ? J’ai cru que cela n’était valable que pour les choses qui me concernent moi-même. » Il est naturellement impossible de pratiquer un traitement analytique dans lequel sont exceptées de la communication les relations du patient à d’autres personnes et ses pensées à leur sujet. Pour faire une omelette il faut casser des œufs. Un homme comme il faut s’empresse d’oublier ce qui dans de tels secrets touchant des personnes étrangères ne lui semble pas mériter d’être su. On ne peut pas renoncer non plus à la communication des noms. Sans cela, les récits du patient ont quelque chose de nébuleux – comme chez Goethe les scènes de La Fille naturelle – qui n’arrive pas à se fixer dans la mémoire du médecin ; de plus, les noms gardés par-devers soi occultent l’accès à toutes sortes de relations importantes. On pourrait permettre à l’analysé de tenir en réserve les noms jusqu’à ce qu’il se soit familiarisé avec le médecin et le procédé. Il est fort remarquable que toute la tâche devienne insoluble pour peu qu’on ait autorisé cette réserve sur un seul point. Mais imaginons qu’il existe chez nous un droit d’asile concernant par exemple un lieu unique dans la ville, combien de temps faudrait-il pour que toute la racaille de la ville converge en ce lieu unique ? J’ai eu un jour en traitement un haut fonctionnaire qui était tenu, par son serment professionnel, de soustraire à toute communication certaines choses – des secrets d’État, et j’ai échoué avec lui du fait de cette restriction. Le traitement psychanalytique doit passer outre à tous les égards, car la névrose et ses résistances n’ont d’égard pour rien.
[5] On ne tolérera d’exceptions que pour des données telles que : tableau généalogique, séjours, opérations, etc.
[6] Pluriel d’imago.
[7] Dans la première édition : « … le représentant ou le mandataire de l’une des parties avec laquelle le patient se trouve en conflit, par exemple des parents, de l’autre conjoint, etc.
Numéro Deux 2020-2
Formulations sur les deux principes de l’advenir psychique. OCF.P, IX : 13-21. Paris, Puf, 1998.
Nous avons depuis longtemps remarqué que toute névrose a pour conséquence, donc vraisemblablement pour tendance, d’expulser le malade hors de la vie réelle, de le rendre étranger à la réalité effective. Aussi bien un fait de cette sorte ne pouvait-il échapper à l’observation de P. Janet[1] ; il parlait d’une perte « de la fonction du réel »[2] comme d’un caractère particulier des névrosés, mais sans mettre à découvert la corrélation entre ce trouble et les conditions fondamentales de la névrose[3].
L’introduction du procès de refoulement dans la genèse de la névrose nous a permis d’acquérir l’intelligence de cette corrélation. Le névrosé se détourne de la réalité effective parce qu’il la trouve – elle tout entière ou des parties de celle-ci – insupportable. Le type le plus extrême de cet acte de se détourner de la réalité nous est montré par certains cas de psychose hallucinatoire, dans lesquels doit être dénié l’évènement même qui a provoqué la folie (Griesinger[4]). Mais à vrai dire, tout névrosé fait de même avec une parcelle de réalité[5]. La tâche qui nous incombe maintenant est d’examiner dans son développement la relation du névrosé et de l’homme en général à la réalité, et d’intégrer ainsi la signification psychologique du monde extérieur réel dans la trame de nos doctrines.
Dans la psychologie fondée sur la psychanalyse, nous nous sommes habitués à prendre pour point de départ les processus animiques inconscients, dont les particularités ont été portées à notre connaissance par l’analyse. Nous tenons ceux-ci pour les processus les plus anciens, primaires, pour des vestiges provenant d’une phase de développement dans laquelle ils étaient l’unique sorte de processus animiques. La tendance suprême à laquelle obéissent ces processus primaires est facile à reconnaître ; elle est désignée comme le principe de plaisir-déplaisir (ou, plus brièvement, comme le principe de plaisir). Ces processus tendant à obtenir du plaisir : l’activité psychique se retire des actes qui peuvent susciter du déplaisir (refoulement). Notre rêver nocturne, notre tendance pendant la veille à nous arracher aux impressions pénibles, sont des restes de la domination de ce principe et des preuves de sa puissance.
J’en reviens à des cheminements de pensée que j’ai développés ailleurs (dans le chapitre général de l’Interprétation du rêve[6]), lorsque je suppose que l’état de repos psychique fut initialement perturbé par les exigences impérieuses des besoins internes. Dans ce cas, le pensé (le souhaité) fut tout simplement posé de façon hallucinatoire, comme cela advient aujourd’hui encore chaque nuit pour ce qui est de nos pensées de rêve[7]. C’est seulement l’absence de la satisfaction attendue, la déception, qui eut pour conséquence l’abandon de cette tentative de satisfaction par voie hallucinatoire. À la place de celle-ci, l’appareil psychique dut se résoudre à représenter l’état des faits réel du monde extérieur et à tendre à la motivité animique ; ne fut plus représenté ce qui était agréable, mais ce qui était réel, même si cela devait être désagréable[8]. Cette instauration du principe de réalité s’avéra être un pas lourd de conséquences.
1) les nouvelles exigences rendirent tout d’abord nécessaire une série d’adaptations de l’appareil psychique, que nous ne pouvons citer que très rapidement, en raison de l’insuffisance ou de l’incertitude de nos connaissances.
L’élévation de la significativité des organes sensoriels tournés vers ce monde extérieur et de la conscience qui s’y rattache, laquelle, en dehors des qualités de plaisir et de déplaisir, jusqu’ici seules intéressantes, apprit à appréhender les qualités sensorielles. Une fonction particulière fut instaurée, qui avait à explorer périodiquement le monde extérieur pour que les données de celui-ci soient connues à l’avance au cas où s’installerait un besoin interne impossible à différer : l’attention. Cette activité va au-devant des impressions sensorielles au lieu d’attendre leur survenue. Il est vraisemblable que fut en même temps instauré un système de marques[9] qui avait à mettre en dépôt les résultats de cette activité de conscience périodique, une partie de ce que nous appelons mémoire.
À la place du refoulement, qui excluait de l’investissement, en tant que génératrices de déplaisir, une partie des représentations qui émergent, vint le prononcé de jugement impartial qui avait à décider si une représentation déterminée était vraie ou fausse, c’est-à-dire était ou non en harmonie avec la réalité, et en décidait par la comparaison avec les traces mnésiques de la réalité.
L’éconduction motrice qui, pendant la domination du principe de plaisir, avait servi à soulager l’appareil animique des surcroîts de stimulus et avait satisfait à cette tâche par des innervations envoyées à l’intérieur du corps (mimique, manifestations d’affect), recevait maintenant une nouvelle fonction en étant utilisée pour modifier la réalité selon une fin. Elle se transformait en agir.
La suspension devenue nécessaire de l’éconduction motrice (de l’action) fut assurée par le procès de pensée qui se constitua à partir du représenter. Le penser fut doté des propriétés qui permettaient à l’appareil animique de supporter l’élévation de la tension de stimulus durant l’ajournement de l’éconduciton. Il est pour l’essentiel une action d’épreuve avec déplacement d’assez petites quantités d’investissement, moyennant une dépense minime de celles-ci (éconduction). Pour cela était requise une translation des investissements librement déplaçables en investissements liés, et une telle translation fut obtenue par le moyen d’une élévation du niveau de tout le processus d’investissent. Le penser était vraisemblablement, à l’origine, inconscient, dans la mesure où il s’élevait au-dessus du simple représenter et se tournait vers les relations des impressions d’objet, et il ne reçut de nouvelles qualités perceptibles pour la conscience que par la liaison aux restes de mot.
2) Une tendance générale de notre appareil animique, que l’on peut ramener au principe économique de l’épargne de dépense, semble se manifester dans l’opiniâtreté avec laquelle on s’accroche aux sources de plaisir disponibles et dans la difficulté avec laquelle on renonce à celles-ci. Avec l’instauration du principe de réalité fut séparée par clivage une sorte d’activité de pensée qui demeura libre à l’égard de l’examen de réalité » et soumise seulement au principe de plaisir[10]. C’est là le fantasier qui commence déjà avec le jouer des enfants et qui, ultérieurement prolongé en rêver diurne, abandonne son étayage sur des objets réels.
3) Le relai du principe de plaisir par le principe de réalité, avec les conséquences psychiques qui en découlent – relai réduit ici, dans une présentation qui schématise, à une proposition unique – ne s’effectue pas en réalité en une fois ni sur toute la ligne en même temps. Mais tandis que ce développement a lieu pour les pulsions du moi, les pulsions sexuelles se détachent d’elles de façon très significative. Les pulsions sexuelles se comportent tout d’abord auto-érotiquement, elles trouvent leur satisfaction sur le corps propre et de ce fait ne parviennent pas à la situation de refusement qui a imposé par contrainte l’instauration du principe de réalité. Puis, lorsque commence plus tard pour elles le procès de la trouvaille de l’objet, celui-ci connaît aussitôt une longue interruption du fait de la période de latence qui retarde le développement sexuel jusqu’à la puberté. Ces deux facteurs – auto-érotisme et période de latence – ont pour conséquence que la pulsion sexuelle est suspendue dans sa mise en forme psychique de plaisir, à laquelle, chez de nombreuses personnes, elle n’est absolument jamais en mesure de se soustraire.
Par suite de ces conditions s’établit une relation plus étroite entre la pulsion sexuelle et la fantaisie d’une part, les pulsions du moi et les activités de conscience d’autre part. Cette relation se montre à nous, aussi bien chez les bien portants que chez les névrosés, comme étant une relation très intime, quoiqu’elle soit reconnue comme secondaire par ces considérations issues de la psychologie génétique. L’auto-érotisme persistant rend possible que la satisfaction instantanée et fantastique relative à l’objet sexuel, laquelle est plus facile, soit maintenue si longtemps à la place de la satisfaction réelle, exigeant, elle, efforts et ajournements. Le refoulement reste tout-puissant dans le royaume du fantasier ; il parvient à inhiber des représentations in statu nascendi, avant qu’elles puissent se faire remarquer de la conscience, lorsque leur investissement peut occasionner une déliaison de déplaisir. C’est là le point faible de notre organisation psychique, qui peut être utilisé pour ramener sous la domination du principe de plaisir des processus de pensée déjà devenus rationnels. Un élément essentiel de la disposition psychique à la névrose est donc fourni par le fait que la pulsion sexuelle a té tardivement éduquée à tenir compte de la réalité et en outre par les conditions qui rendent possible ce retard.
4) de même que le moi-plaisir ne peut rien d’autre que souhaiter, travailler à l’obtention du plaisir et esquiver le déplaisir, de même le moi-réel n’a rien d’autre à faire que tendre à l’utile et s’assurer contre les dommages[11]. En fait, la substitution du principe de réalité au principe de plaisir ne signifie pas une destitution du principe de plaisir, mais seulement une façon d’assurer celui-ci. Un plaisir instantané, aux conséquences peu sûres, est abandonné, mais ce n’est que pour gagner, sur cette nouvelle voie, un plaisir plus tardif, assuré. Pourtant l’impression endopsychique laissée par cette substitution a été si puissante qu’elle se reflète dans un mythe religieux particulier. La doctrine de la récompense dans l’au-delà, en échange du renoncement – volontaire ou imposé par contrainte – aux plaisirs terrestres, n’est rien d’autre que la projection mythique de cette révolution psychique. En développant ce modèle dans toutes ses conséquences, les religions ont pu imposer l’absolu renoncement au plaisir dans cette vie contre la promesse d’un dédommagement dans une existence future ; par ce moyen elles ne sont pas parvenues à un surmontement du principe de plaisir. C’est la science qui réussit le mieux ce surmontement, elle qui au demeurant procure un plaisir intellectuel pendant le travail et promet pour finir un gain pratique.
5) L’éducation peut être décrite, sans plus d’hésitation, comme une incitation à surmonter le principe de plaisir, à lui substituer le principe de réalité ; elle va donc venir en aide à ce procès de développement qui concerne le moi, se servant à cette fin des primes d’amour dispensées par les éducateurs et échouant de ce fait quand l’enfant gâté croit qu’il possède cet amour de toute façon et qu’il ne peut venir à le perdre en aucune circonstance.
6) L’art parvient par une voie qui lui est propre à une réconciliation des deux principes. L’artiste est à l’origine un homme qui se détourne de la réalité parce qu’il ne peut se faire au renoncement à la satisfaction des pulsions exigé d’emblée par elle, et qui dans la vie de fantaisie laisse libre cours à ses souhaits érotiques et ambitieux. Mais il trouve la voie qui ramène de ce monde de la fantaisie à la réalité ; grâce à ses dons particuliers, il donne forme à ses fantaisies pour en faire des réalités effectives d’une nouvelle sorte, auxquelles les hommes donnent cours en tant que précieuses copies de la réalité. C’est ainsi que d’une certaine manière il devient effectivement le héros, le roi, le créateur, le favori qu’il voulait devenir, sans emprunter l’énorme détour par la modification effective du monde extérieur. Mais il ne peut y arriver que parce que les autres hommes ressentent le même mécontentement que lui à l’égard du renoncement exigible dans le réel et parce que ce mécontentement qui résulte de la substitution du principe de réalité au principe de plaisir est lui-même un morceau de la réalité[12].
7) Pendant que le moi fait sa mutation de moi-plaisir en moi-réel, les pulsions sexuelles connaissent ces modifications qui les conduisent, par diverses phases intermédiaires, de l’auto-érotisme initial à l’amour d’objet au service de la fonction de reproduction. S’il est exact que chaque stade de ces deux parcours de développement peut devenir le siège d’une disposition à l’affection névrotique ultérieure, on est tenté de faire dépendre la décision quant à la forme de l’affection ultérieure (le choix de la névrose) de la phase de développement du moi et de la libido dans laquelle est intervenue l’inhibition du développement qui y dispose. Les caractères temporels non encore étudiés des deux développements, leur possible décalage[13] l’un par rapport à l’autre, acquièrent ainsi une significativité insoupçonnée.
8) Le caractère le plus déconcertant des processus inconscients (refoulés), auquel tout investigateur ne s(‘habitue qu’au prix d’un grand surmontement de soi, tient à ce que l’examen de réalité ne vaut rien en ce qui les concerne, que la réalité de pensée est assimilée à la réalité effective, le souhait à l’accomplissement, à l’évènement, comme cela découle tout droit de la domination du vieux principe de plaisir. C’est aussi pourquoi il est si difficile de différencier fantaisies inconscientes et souvenirs devenus inconscients. Mais qu’on ne se laisse jamais entraîner à inscrire la valeur-réalité dans les formations psychiques refoulées et, par exemple, à sous-estimer les fantaisies dans la formation de symptôme parce qu’elles ne sont justement pas des réalités effectives, ou bien à faire découler d’ailleurs un sentiment de culpabilité névrotique, parce qu’aucun crime effectivement exécuté ne peut être mis en évidence. On a obligation de se servir de la monnaie qui a justement cours dans le pays que l’on explore, dans notre cas la monnaie névrotique. Que l’on tente, par exemple, de résoudre un rêve comme celui-ci. Un homme, qui a autrefois soigné son père durant une longue et cruelle maladie dont il est mort, rapporte que, dans les mois quoi suivirent le décès de ce père, il a rêvé de façon répétée ceci : son père était de nouveau en vie, mais il parlait avec lui comme autrefois. Mais en même temps il avait ressenti avec une extrême douleur le fait que son père était pourtant déjà mort et simplement ne le savait pas. Aucune autre voie ne mène à la compréhension de ce rêve qui rend un son absurde que l’adjonction de « selon son souhait » ou « par suite de son souhait » après les mots « que son père était pourtant mort » et l’ajout de « qu’il le souhaitait » après les derniers mots. La pensée du rêve s’énonce alors : c’était pour lui un souvenir douloureux que d’avoir dû souhaiter à son père la mort (comme délivrance) lorsqu’il vivait encore, et comme il eût été effroyable que son père s’en fût douté. Il s’agit alors du cas bien connu des autoreproches après la perte d’une personne aimée, et le reproche dans cet exemple remonte à la signification infantile du souhait de mort envers le père[14].
Les insuffisances de ce petit article, plus introductif qu’exhaustif, ne se trouveront peut-être excusées que pour une faible part si je les donne pour inévitables. Dans les quelques propositions sur les conséquences psychiques de l’adaptation au principe de réalité, il m’a fallu indiquer des opinions que j’aurais préféré garder encore par-devers moi et dont la justification ne sera certainement pas sans coûter bien de la peine. Je veux pourtant espérer que les lecteurs bienveillants ne manqueront pas de saisir où commence, dans ce travail aussi, la domination du principe de réalité.
[1] Pierre Janet [1859-1947).
[2] En français dans le texte.
[3] P. Janet, Les névroses, 1909. Bibliothèque de philosophie scientifique. [Paris, E. Flammarion.]
[4] Wilhem Griesinger (1817-1868), psychiatre berlinois. Freud se réfère sans doute à son traité Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten (La pathologie et la thérapie des maladies psychiques), Stuttgart, A. Krabbe, 1845.
[5] Otto Rank a récemment mis en évidence un pressentiment remarquablement clair de cette causation dans un passage de Schopenhauer (Le monde comme volonté et représentation, t. II. Voir Zentralblatt für Psychoanalyse, fac. 1/2, 1910).
[6] Die traumdeutung, GW, II-III ; OCF.P, IV, chap. VII.
[7] L’état de sommeil peut restituer l’image même de la vie d’âme avant la reconnaissance de la réalité, parce qu’il prend pour présupposé le déni intentionnel de celle-ci (souhait de dormir).
[8] Je vais tenter de compléter la présentation schématique ci-dessus par quelques développements : on objectera à juste titre qu’une telle organisation, qui est asservie au principe de plaisir et néglige la réalité du monde extérieur, ne pourrait se maintenir en vie, fût-ce pour le temps le plus bref, de sorte qu’elle n’aurait absolument pas pu apparaitre. Mais l’utilisation d’une fiction de ce genre se justifie si l’on remarque que le nourrisson, pour peu qu’on y ajoute les soins de la mère, est bien prêt de réaliser un tel système psychique. Il hallucine vraisemblablement l’accomplissement de ses besoins internes, trahit son déplaisir, quand le stimulus croît et que la satisfaction est absente, par l’éconduction motrice consistant à crier et à gigoter, et vit alors la satisfaction hallucinée. Plus tard, enfant, il apprend à utiliser intentionnellement ces manifestations d’éconduction comme moyen d’expression. Comme les soins au nourrisson sont le prototype de la façon de s’occuper ultérieurement des enfants, la domination du principe de plaisir ne peut véritablement prendre fin qu’avec le plein détachement psychique d’avec les parents. – Un bel exemple d’un système psychique fermé aux stimuli du monde extérieur et qui peut satisfaire même ses besoins en nourriture de façon autistique (d’après un terme de Bleuler) nous est donné par l’œuf d’oiseau enfermé avec sa provision de nourriture dans sa coquille, pour lequel les soins maternels se restreignent à l’apport de chaleur. – Je considèrerai qu’il y a non pas rectification, mais seulement élargissement du schéma en question si l’on exige, pour le système qui vit selon le principe de plaisir, des dispositifs au moyen desquels il peut se soustraire aux stimuli de la réalité. Ces dispositifs ne sont que le corrélatif du « refoulement » qui traite les stimuli de déplaisir internes comme s’ils étaient externes, donc les impute au monde extérieur.
[9] Ein System von Merken. Freud utilise ici le terme ancien de Merk, qui renvoie au mot souligné deux lignes plus haut ; Aufmerksamkeit (attention).
[10] Tout comme une nation dont la richesse repose sur l’exploitation des trésors de son sol réserve pourtant un domaine déterminé, qui doit être laissé dans son état originaire et épargné par les modifications de la culture (parc de Yellowstone).
[11] L’avantage du moi-réel sur le moi-plaisir, Bernard Shaw l’exprime avec pertinence en ces termes : To be able to choose the line of greatest advantage instead of yiedling in the direction of the least resistance. (Man ans Superman. A comedy and a philosophy.) [London, Constable, 1903. « Être à même de choisir la ligne du plus grand avantage au lieu de s’abandonner dans la direction de la moindre résistance. » L’homme et le surhomme. Comédie et philosophie. Trad. de A. et H. Hamon, Paris, Éditions Montaigne, 1931.]
[12] Cf. une idée semblable chez O. Rank, L’artiste [Der Künstler], Vienne, [Heller] 1907.
[13] Verschiebung.
[14] Rêve ajouté à l’édition de 1911 de L’interprétation du rêve, peu après la publication du présent article. Cf. OCF.P, IV, p. 478-479.
Numéro L’enfant modèle 2020-1
Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans. OCF.P, IX : 128. Paris, Puf, 1998.
Je ne puis prendre congé de la phobie de notre petit patient sans formuler la supposition qui me rend tout particulièrement précieuse l’analyse conduisant à la guérison de cette phobie. De cette analyse, je n’ai, rigoureusement parlant, rien appris de nouveau, rien que je n’eusse déjà deviné, souvent d’une manière moins nette et plus médiate, chez d’autres patients traités à l’âge mûr. Et comme les névroses de ces autres malades devaient à chaque fois être ramenées à ces mêmes complexes infantiles, qui se laissaient mettre à découvert derrière la phobie de Hans, je suis tenté de revendiquer pour cette névrose d’enfant une significativité typique et exemplaire, comme si la variété des manifestations de refoulement névrotiques et l’abondance du matériel pathogène n’empêchaient pas de les faires dériver d’un très petit nombre de procès concernant ces mêmes complexes de représentation.
Numéro Bisexualités et genres 2019-5
Lors de leur « Congrès » à Breslau en décembre 1897, Fliess avait fait part à Freud de sa théorie établissant un rapport entre bisexualité et bilatéralité (Bi-bi). De retour à Vienne, Freud écrit à Fliess : « Me voici de retour et de nouveau attelé à la tâche, avec le délicieux arrière-goût de nos journées à Breslau. Bi-bi résonne à mes oreilles » (29-12-1897). Avant de constituer entre les deux hommes un motif de rupture, la bisexualité, dissociée de la bilatéralité, fut au cœur de leurs échanges. Considérée par Freud comme disposition réunissant en chacun masculin et féminin, d’abord envisagée dans les Trois essais sur la théorie sexuelle (1905) comme donnée constitutionnelle biologique, souvent davantage évoquée comme ce dont dérive le féminin, la bisexualité devient, dans « L’analyse finie et l’analyse infinie » (1937), disposition psychique dans les deux sexes.
Trois essais sur la théorie sexuelle. OCF.P, VI : 73-75. Paris, Puf, 2006.
Pour expliquer la possibilité d’une inversion sexuelle, on a eu recours, depuis Frank Lydstone, Kiernan et Chevalier, à une suite de pensées qui comporte une nouvelle contradiction avec l’opinion populaire. Pour celle-ci, un être humain, c’est soit un homme soit une femme. Mais la science connaît des cas où les caractères sexués apparaissent estompés, de sorte que la détermination du sexe est rendue difficile, et ceci d’abord dans le domaine anatomique. Les organes génitaux de ces personnes réunissent les caractères masculins et féminins (hermaphrodisme véritable) ; le plus souvent on trouve une atrophie des deux côtés.
Mais ce qu’il y a de significatif dans ces anormalités, c’est qu’elles facilitent de façon inattendue la compréhension de la formation normale. Un certain degré d’hermaphrodisme anatomique relève en effet de la norme ; chez aucun individu masculin ou féminin normalement conformé ne sont absentes les traces de l’appareil de l’autre sexe, qui ou bien subsistent, dénuées de fonction, en tant qu’organes rudimentaires, ou bien ont même été remodelées pour assumer d’autres fonctions.
La conception qui résulte de ces faits anatomiques depuis longtemps connus est celle d’une prédisposition originellement bisexuelle qui se modifie au cours de l’évolution jusqu’à donner la monosexualité avec de menus restes du sexe atrophié.
Il était tentant de transférer cette conception au domaine psychique et de comprendre l’inversion dans ses variétés comme l’expression d’un hermaphrodisme psychique. Pour trancher la question, il n’était plus besoin que de faire coïncider régulièrement l’inversion avec les signes animiques et somatiques de l’hermaphrodisme.
Or cette attente initiale est vouée à l’échec. On ne saurait se représenter de façon si étroite les relations entre l’hybridation psychique supposée et l’hybridation anatomique démontrable. Ce que l’on trouve chez les invertis, c’est souvent un abaissement de la pulsion sexuée en général (Havelock Ellis) et une légère atrophie anatomique des organes. Souvent, mais nullement de façon régulière ni même prépondérante. On doit par conséquent reconnaître que l’inversion et l’hermaphrodisme somatique sont dans l’ensemble indépendant l’un de l’autre.
L’analyse finie et l’analyse infinie. OCF.P, XX : 45-46. Paris, Puf, 2010.
Il est connu qu’il y a eu à toutes les époques et qu’il y a encore des êtres humains qui peuvent prendre comme objets sexuels des personnes du même sexe aussi bien que de l’autre, sans que l’une des orientations porte préjudice à l’autre. Nous appelons ces gens des bisexuels, nous prenons acte de leur existence sans beaucoup nous en étonner. Mais nous avons appris que tous les êtres humains sont en ce sens bixesuels et répartissent leur libido, d’une manière soit manifeste soit latente, sur des objets des deux sexes. À ce sujet, toutefois, nous remarquons la chose suivante : alors que dans le premier cas les deux orientations se sont accordées sans heurt, elles se trouvent dans l’autre cas, qui est le plus fréquent, dans un état de conflit excluant toute conciliation. L’hétérosexualité d’un homme ne tolère aucune homosexualité, et vice versa. La première est-elle la plus forte, elle réussit à maintenir la seconde à l’état latent et à l’écarter de la satisfaction dans le réel ; par ailleurs, il n’y a pas de plus grand danger pour la fonction hétérosexuelle d’un homme que la perturbation par l’homosexualité latente. On pourrait tenter l’explication que justement seul un montant déterminé de libido est disponible, les deux orientations rivalisant l’une avec l’autre devant se le disputer. Mais on ne voit pas pourquoi les rivaux ne partagent pas régulièrement entre eux, chaque fois en fonction de leur force relative, le montant disponible de la libido, alors que pourtant ils peuvent le faire en bien des cas. On a bel et bien l’impression que l’inclination au conflit est quelque chose de particulier, un élément nouveau qui ajoute à la situation, indépendamment de la quantité de libido. Une telle inclination au conflit survenant de façon indépendante ne peut guère être ramenée à autre chose qu’à l’intervention d’une part d’agression libre.
Numéro Infini et illimité 2019-4
Entre Romain-Rolland et Freud, le « sentiment océanique »
S. Freud, Le malaise dans la culture (1929[1930a]), OCP-F, XVIII, Puf, 1994, p. 249-251.
Il est certains hommes auxquels la vénération de leurs contemporains ne se refuse pas, bien que leur grandeur repose sur des qualités et des réalisations qui sont tout à fait étrangères aux buts et aux idéaux de la foule. […]
L’un de ces hommes distingués se déclare dans ses lettres mon ami. Je lui avais adressé mon petit écrit qui traite la religion comme une illusion [L’avenir d’une illusion, 1927c] et il me répondit qu’il serait entièrement d’accord avec mon jugement sur la religion, mais qu’il regrettait que je n’eusse pas pris en compte la source véritable de la religiosité. Celle-ci, dit-il, est un sentiment particulier qui n’a jamais coutume de le quitter lui-même, qu’il a trouvé confirmé par beaucoup d’autres et qu’il est en droit de présupposer chez des millions d’humains. Sentiment qu’il appellerait volontiers la sensation de l’ « éternité », sentiment comme de quelque chose sans frontière, sans borne, pour ainsi dire « océanique ». Selon lui, ce sentiment est un fait purement subjectif, pas un article de foi ; aucune assurance de survie personnelle ne s’y rattache, mais il est la source de l’énergie religieuse, qui est captée, dirigée dans des canaux déterminés et certainement même absorbée en totalité par les diverses Eglises et systèmes de religion. Sur la seule base de ce sentiment océanique, on est selon lui en droit de se dire religieux, alors même qu’on récuse toute croyance et toute illusion.
Cette déclaration de mon ami vénéré, qui a lui-même un jour rendu un hommage poétique à l’enchantement de l’illusion, ne m’a pas causé de minces difficultés[1]. Pour ma part, je ne puis découvrir en moi ce sentiment « océanique ». Il n’est pas commode de procéder à l’élaboration scientifique des sentiments. On peut tenter de décrire leurs indices physiologiques. Là où ce n’est pas possible – le sentiment océanique lui aussi se soustraira, j’en ai peur, à une telle caractérisation-, il ne reste évidemment rien d’autre à faire qu’à s’en tenir au contenu de représentation qui, associativement, se joint de préférence à ce sentiment. Si j’ai bien compris mon ami, il entend la même chose que ce qu’un poète original et passablement singulier attribue à son héros comme consolation avant une mort qu’il a librement choisie : « Nous ne pouvons tomber hors de ce monde. »[2] Sentiment, donc, d’un lien indissoluble, d’une appartenance à la totalité du monde extérieur. Je dirais volontiers que pour moi cela a plutôt le caractère d’une vue intellectuelle, qui n’est certes pas sans s’accompagner d’une tonalité sentimentale, telle qu’elle ne manquera d’ailleurs pas non plus dans d’autres actes de pensée de semblable portée. Sur ma propre personne je ne pourrais pas me convaincre de la nature primaire d’un tel sentiment. Mais je n’ai pas pour autant le droit de contester sa présence effective chez d’autres. La seule question est de savoir s’il est interprété exactement et s’il doit être reconnu comme « fons et origo » [source et origine] de tous les besoins religieux.
[1] Depuis la parution des deux livres La vie de Ramakrishna et La vie de Vivekananda (1930), je n’ai plus besoin de cacher que l’ami à qui il est fait allusion dans le texte est Romain Rolland.
[2] D. Chr. Grabbe, Hannibal (1835) : « Oui, nous ne tomberons jamais hors du monde. Nous sommes dedans une fois pour toutes ». [Grabbe fut qualifié par Heine de « Shakespeare ivre », note des OCP]
Numéro Alexithymie, pensée opératoire et affect 2019-3
Dans le texte paru dans ce numéro de la Rfp, « Une vie dans “l’écume des jours“ », Robert Asséo évoque le lien entre certaines images, les processus somatiques et le phénomène de Silberer. Ce dernier phénomène est décrit par Freud essentiellement dans deux passages ajoutés en 1914 à L’Interprétation du rêve. Les principaux ouvrages de H. Silberer sur la formation des symboles sont parus entre 1909 et 1912 (voir bibliographie, OCF.P, IV, 702).
« Herbert Silberer a montré une bonne manière d’observer directement la transposition des pensées en images qui se produit dans la formation du rêve et d’étudier ainsi isolément ce facteur du travail du rêve. Lorsque, accablé de fatigue et ivre de sommeil, il s’imposait un effort de pensée, il arrivait fréquemment que la pensée lui échappât et que survînt à sa place une image en laquelle il pouvait alors reconnaître le substitut de la pensée. D’une manière qui n’est pas tout à fait appropriée, Silberer qualifie ce substitut d’ “autosymbolique“. Je reproduis ici quelques exemples du travail de Silberer, auxquels je reviendrai encore ailleurs à cause de certaines qualités des phénomènes observés.
Exemple n°1. Je pense que je projette d’améliorer dans un article un passage raboteux.
Symbole : Je me vois polir au rabot un morceau de bois.
[…]Exemple n° 9. Dans un cheminement de pensée je perds le fil. Je me donne de la peine pour le retrouver, mais je dois reconnaître que le point de départ m’a complètement échappé.
Symbole : Un morceau de phrase écrite, dont les dernières lignes sont tombées.
L’interprétation du rêve, OCF.P, IV, p. 389-390.
« À la prise en compte de l’élaboration secondaire je rattache celle d’une nouvelle contribution au travail du rêve, révélée par les subtiles observations de H. Silberer. Comme je l’ai mentionné ailleurs, Silberer a en quelque sorte surpris in flagranti la transposition de pensées en images, en se forçant à une activité mentale dans des états de fatigue et dans l’ivresse du sommeil. La pensée élaborée lui échappait alors et à sa place s’installait une vision qui s’avérait être le substitut de la pensée le plus souvent abstraite (Voir les exemples ci-dessus). Au cours de ces expériences, il arrivait alors que l’image émergeant, assimilable à un élément du rêve, présentât quelque chose d’autre que la pensée en attente d’élaboration, à savoir la fatigue elle-même, la difficulté ou le déplaisir à faire ce travail, donc l’état subjectif et le mode de fonctionnement de la personne se livrant à ces efforts, au lieu de l’objet de ses efforts. Ce cas survenant très fréquemment chez lui, Silberer l’a qualifié de “phénomène fonctionnel“ pour le différencier du phénomène “matériel“ auquel on devait s’attendre.
Par ex. : Un après-midi, je suis allongé sur mon divan, tout ensommeillé, et je me contrains pourtant à réfléchir à un problème philosophique. En l’occurrence, je cherche à comparer les vues de Kant et de Schopenauher sur le temps. Parce que je suis ivre de sommeil, je ne réussis pas à maintenir côte à côte les lignes de pensée de l’un et de l’autre, ce qui serait nécessaire pour la comparaison. Après plusieurs vaines tentatives, je m’imprègne encore une fois, avec toute la force de ma volonté, de la déduction kantienne pour l’appliquer ensuite à la position du problème chez Schopenhauer. Là-dessus, je dirige mon attention sur cette dernière ; puis lorsque je veux revenir à Kant, il apparaît qu’il m’a de nouveau échappé, je m’efforce en vain de le rattraper. Et voilà que ces vains efforts pour retrouver immédiatement les dossiers-Kant remisés quelque part dans ma tête se présentent brusquement, alors que j’ai les yeux fermés, comme dans une image de rêve, sous la forme d’un symbole visuel et plastique : Je demande des renseignements à un secrétaire grincheux qui, penché sur un bureau, ne se laisse pas troubler par mon insistance. Il se redresse à demi et d’un regard mécontent, il m’éconduit.
Voici d’autres exemples, qui se rapportent à l’oscillation entre le sommeil et l’état de veille :
Exemple n°2 – Conditions : Le matin au réveil. Dans un sommeil d’une certaine profondeur (état crépusculaire), réfléchissant à un rêve précédent, en quelque sorte le re-rêvant et l’achevant, je sens que je me rapproche de la conscience vigile, mais je veux pourtant demeurer encore dans l’état crépusculaire.
Scène : Je pose le pied sur l’autre bord d’un ruisseau mais le retire aussitôt, cherchant à rester sur ce bord-ci.
[…]Le “phénomène fonctionnel“, la “présentation de ce qui est propre à l’état au lieu de ce qui est propre à l’objet“, Silberer l’a observé essentiellement dans deux circonstances, l’endormissement et le réveil. Il est aisé de comprendre que seul le dernier cas entre en ligne de compte pour l’interprétation du rêve. Silberer a montré sur de bons exemples que les parties terminales du contenu manifeste de nombreux rêves auxquels se rattache immédiatement le réveil ne présentent rien d’autre que le projet ou le processus du réveil lui-même. […]
Le très intéressant phénomène fonctionnel de Silberer a entraîné beaucoup d’abus – sans que celui qui l’a découvert en soit responsable – car le vieux penchant à l’interprétation symbolique abstraite des rêves a trouvé à s’y étayer. La préférence accordée à la catégorie fonctionnelle va si loin chez certains qu’ils parlent de phénomène fonctionnel où qu’apparaissent, dans le contenu des pensées de rêve, des activités intellectuelles ou des processus affectifs, bien que ce matériel ne puisse prétendre ni plus ni moins que tout autre à entrer dans le rêve en tant que reste du jour.
Reconnaissons que les phénomènes de Silberer constituent une seconde contribution du penser vigile à la formation du rêve, contribution toutefois moins constante et significative que la première qui a été introduite sous le nom d’ “élaboration secondaire“. Il était apparu qu’une partie de l’attention active dans la journée reste aussi tournée vers le rêve pendant l’état de sommeil, qu’elle le contrôle, le critique et se réserve le pouvoir de l’interrompre. Nous avons été tout près de reconnaître dans cette instance animique restée éveillée le censeur auquel revient une si forte influence restreignante sur la mise en forme du rêve. Ce que les observations de Silberer apportent en plus, c’est le fait que dans certaines circonstances une sorte d’auto-observation vient aussi coopérer, fournissant sa contribution au contenu du rêve. C’est en un autre endroit qu’il conviendra de traiter des relations probables de cette instance auto-observante – qui, particulièrement chez les têtes philosophiques, peut devenir envahissante – avec la perception endopsychique, le délire d’être remarqué, la conscience morale et le censeur du rêve. »
L’interprétation du rêve, OCF.P, IV, p. 554-557.
Numéro Identité 2019-2
L’inquiétant (1919)
par S. Freud.
[…]E.T.A Hoffmann est le maître inégalé de l’inquiétant dans la création littéraire. Son roman, Les Elixirs du diable, offre tout un faisceau de motifs auxquels on aimerait attribuer l’effet inquiétant de l’histoire. Le contenu du roman est trop riche et emmêlé pour qu’on puisse risquer d’en citer un extrait. À la fin du livre, quand sont fournis après coup les présupposés de l’action qui avaient été jusque-là soustraits au lecteur, le résultat n’en est pas d’éclairer le lecteur, mais de le plonger dans une totale confusion. Le poète a accumulé trop de choses similaires ; l’impression de l’ensemble n’en pâtit pas, mais assurément la compréhension. Il faut se contenter de dégager, parmi ces motifs aux effets inquiétants, ceux qui sont les plus saillants, afin d’examiner si, pour eux aussi, une dérivation à partir de sources infantiles est permise. Il s’agit du phénomène du double dans toutes ses gradations et extensions, à savoir l’entrée en scène de personnes qui, du fait d’une même apparence, sont forcément tenues pour identiques ; l’intensification de ce rapport par le passage de processus animiques de l’une de ces personnes à l’autre – ce que nous appellerions télépathie –, de sorte que l’une possède en commun avec l’autre ce qui est su, senti et vécu ; l’identification à une autre personne, de sorte qu’on est désorienté quant à son moi, ou qu’on met le moi étranger à la place du moi propre – donc dédoublement du moi, division du moi, permutation des moi – ; et enfin, le constant retour du mêmea, la répétition des mêmes traits de visage, caractères, destins, actes criminels, voire celle des noms à travers plusieurs générations successives.
Le motif du double a fait l’objet d’une étude approfondie dans le travail d’O. Rank qui porte ce nom[1]. Y sont examinées les relations du double à l’image en miroir et l’image en ombre portée, à l’esprit tutélaire, à la doctrine de l’âme et à la crainte de la mort ; mais du même coup une vive lumière tombe sur la surprenante histoire de l’évolution du motif. Car le double était à l’origine une assurance contre la disparition du moi, un « démenti énergique de la puissance de la mort » (O. Rank), et l’âme « immortelle » fut vraisemblablement le premier double du corps. La création d’un tel dédoublement comme défense contre l’anéantissement a son pendant dans une présentation figurée de la langue du rêve qui aime à figurer la castration par dédoublement ou multiplication du symbole génital ; dans la culture des anciens Égyptiens, elle donne une impulsion à l’art de modeler l’image du défunt dans un matériau durable. Mais ces représentations sont nées sur le terrain de l’amour de soi illimité, celui du narcissisme primaire, lequel domine la vie d’âme de l’enfant comme celle du primitif, et avec le surmontement de cette phase l’indice affectant le double se modifie ; d’assurance de survie qu’il était, il devient l’annonciateur inquiétant de la mort.
La représentation du double ne disparaît pas nécessairement avec ce narcissisme des primes origines, car elle peut acquérir, des stades de développements ultérieurs du moi, un nouveau contenu. Dans le moi se constitue lentement une instance particulière, qui peut s’opposer au reste du moi, qui sert à l’auto-observation et à l’autocritique, qui accomplit le travail de la censure psychique et se fait connaître à notre conscience comme « conscience morale ». Dans le cas pathologique du délire d’être remarqué, elle est isolée, séparée du moi par clivage, perceptible pour le médecin. Le fait qu’existe une telle instance pouvant traiter le reste du moi comme un objet, donc que l’homme est capable d’auto-observation, permet de remplir d’un contenu nouveau l’ancienne représentation du double et de lui attribuer bien des choses, principalement tout ce qui apparaît à l’autocritique comme relevant de l’ancien narcissisme des temps originaires qui a été surmonté[2].
Or ce n’est pas seulement ce contenu heurtant la part critique du moi qui peut être incorporé au double, mais aussi bien toutes les possibilités non réalisées de forger notre destin, auxquelles la fantaisie veut s’accrocher encore, et toutes les aspirations du moi qui n’ont pu se faire une place par suite de circonstances extérieures défavorables, de même que toutes les décisions de la volonté réprimées, qui ont créé l’illusion du libre arbitre[3].
Cependant, après avoir considéré la motivation manifeste de la figure du double, nous ne pouvons que nous dire : rien de tout cela ne nous rend compréhensible le degré extraordinairement élevé d’inquiétance qui s’y attache, et notre connaissance des processus animiques pathologiques nous autorise à ajouter que rien dans ce contenu ne saurait expliquer les efforts défensifs qui le projettent au-dehors du moi comme quelque chose d’étranger. Le caractère de l’inquiétant, en effet, peut seulement venir de ceci que le double est une formation appartenant aux temps originaires de l’âme qui ont été surmontés, formation qui du reste revêtait alors un sens plus favorable. Le double est devenu une image d’effroi, tout comme les dieux, après l’écroulement de leur religion, deviennent des démons [Heine, Les dieux en exilb].
Les autres perturbations du moi utilisées chez Hoffmann sont faciles à apprécier d’après le modèle du motif du double. Il s’agit dans chaque cas d’un retour à telle ou telle phase de l’histoire de développement du sentiment du moi, d’une régression à des époques où le moi ne s’était pas encore rigoureusement délimité par rapport au monde extérieur et à l’autre. Je crois que ces motifs sont responsables ensemble de l’impression de l’inquiétant, même s’il n’est pas facile de dégager sous une forme isolée la part qu’ils prennent à cette impression.
Le facteur de la répétition de ce qui est de même nature ne sera peut-être pas reconnu par tout un chacun comme source du sentiment inquiétant. D’après mes observations, il provoque indubitablement, sous certaines conditions, en combinaison avec des circonstances déterminées, un tel sentiment, lequel, de plus, fait penser au désaide de bien des états de rêve. Un jour que je flânais, par une chaude après-midi d’été, dans les rues inconnues de moi et désertes d’une petite ville italienne, je tombai dans un quartier sur le caractère duquel je ne pus longtemps rester dans le doute. Aux fenêtres des petites maisons, on ne pouvait voir que des femmes fardées, et je me hâtai de quitter cette rue étroite au premier croisement. Mais après avoir un moment tourné en rond sans guide, je me retrouvai soudain dans la même rue où je commençai alors à faire sensation, et mon éloignement hâtif eut pour seule conséquence de m’y faire retomber une troisième fois par un nouveau détour. Mais alors s’empara de moi un sentiment que je ne puis qualifier que d’inquiétant, et je fus bien content, renonçant à poursuivre mes explorations, de me retrouver sur la piazza que j’avais quittée peu de temps auparavant. D’autres situations, ayant en commun avec celle que je viens de décrire ce retour non intentionnel et s’en distinguant fondamentalement sur les deux autres points, ont pourtant pour conséquence le même sentiment de désaide et d’inquiétance. Par exemple, lorsqu’on s’est égaré dans une futaie, surpris peut-être par le brouillard, et qu’en dépit de tous les efforts pour trouver un chemin balisé ou connu on revient de façon répétée au même endroit caractérisé par une configuration particulière. Ou bien lorsqu’on tourne dans une pièce inconnue et obscure à la recherche de la porte ou de l’interrupteur, et que, ce faisant, on entre en collision pour la énième fois avec le même meuble, situation que Marl Twain, en l’exagérant il est vrai jusqu’au grotesque, a transformé en une situation d’un comique irrésistiblec.
Dans une autre série d’expériences, nous reconnaissons également sans peine que c’est seulement le facteur de la répétition non intentionnelle qui rend inquiétant ce qui sinon serait anodin et qui nous impose l’idée du néfaste, de l’inéluctable, là où sinon nous aurions seulement parlé de « hasard ». Ainsi par exemple est-ce assurément une expérience vécue indifférente que de recevoir, en échange de ses habits déposés au vestiaire, un ticket marqué d’un certain nombre – disons : 62 –, ou de constater que la cabine qui nous a été attribuée sur un bateau porte ce numéro. Mais cette impression se modifie si ces deux événements en soi indifférents se rapprochent au point qu’on est confronté plusieurs fois dans la même journée au nombre 62, et si de plus on venait ensuite à faire l’observation que tout ce qui porte un nombre (adresses, chambres d’hôtel, wagons de chemin de fer, etc.) ne cesse de ramener le même nombre, au moins comme composant. On trouve cela « inquiétant », et quiconque n’est pas cuirassé contre les tentations de la superstition se trouvera enclin à attribuer à ce retour obstiné du même nombre une signification secrètec, à y voir par exemple une référence au temps de vie qui lui est assignéd. Ou bien si l’on est justement en train d’étudier les écrits du grand physiologiste H. Heringe et qu’à ce moment-là, à peu de jours d’intervalle, on reçoive de pays distincts des lettres de deux personnes de ce nom, alors que jusque-là on n’était jamais entré en relation avec des gens s’appelant ainsi. Un chercheur en sciences de la nature, esprit éminent, a récemment tenté de soumettre des événements de ce genre à certaines lois, ce par quoi l’impression de l’inquiétant serait forcément supprimé. Je ne me hasarderai pas à décider s’il a réussi[4].
Comment l’inquiétant lié au retour sous une même forme doit être dérivé de la vie d’âme infantile, je ne puis ici que l’évoquer, et il me faut renvoyer pour cela à une présentation détaillée déjà faite dans un autre contextef. Dans l’inconscient animique, en effet, on peut reconnaître la domination d’une contrainte de répétition émanant des motions pulsionnelles, qui dépend vraisemblablement de la nature la plus intime des pulsions elles-mêmes, qui est assez forte pour se placer au-dessus du principe de plaisir, qui confère à certains côtés de la vie d’âme un caractère démonique, qui se manifeste très nettement dans les tendances du petit enfant et qui domine une part du cours de la psychanalyse du névrosé. Nous sommes préparés par toutes les considérations précédentes à ce quez soit éprouvé comme inquiétant cela même qui peut faire penser à cette contrainte de répétition interne.
Mais je pense qu’à présent il est temps de nous détourner de ces données, dont il est d’ailleurs difficile de juger, et de nous mettre en quête de cas indubitables d’inquiétant, dont il nous est permis d’attendre que l’analyse décidera définitivement de la validité de notre hypothèse.
Dans « l’anneau de Polycrate »g, l’invité se détourne avec horreurh, parce qu’il remarque que chaque souhait de son ami s’accomplit aussitôt, que chacun de ses soucis est supprimé sans délai par le destin. Son hôte est devenu pour lui « inquiétant ». L’argument qu’il donne lui-même – celui qui est trop heureux doit redouter l’envie des dieux – nous paraît encore opaque, son sens est mythologiquement voilé. Allons donc chercher un autre exemple, emprunté à un ordre de choses beaucoup plus modeste : dans l’histoire de maladie d’un névrosé de contrainte[5], j’ai raconté que ce malade avait fait une fois un séjour dans un établissement hydrothérapique, dont il avait retiré une grande amélioration. Mais il était assez avisé pour attribuer ce succès non pas à la vertu curative de l’eau, mais à la situation de sa chambre qui se trouvait à proximité immédiate de celle d’une charmante soignante. Lorsqu’il revint pour la deuxième fois dans cet établissement, il réclama de nouveau la même chambre, mais il dut s’entendre dire qu’elle était déjà occupée par un vieux monsieur, et il exprima sa mauvaise humeur en ces termes : « Eh bien ! pour ça, il va être frappé d’une attaque. » Quinze jours plus tard, le vieux monsieur fut effectivement victime d’une attaque. Pour mon patient, cela fut une expérience vécue « inquiétante ». L’impression de l’inquiétant aurait été encore plus forte si un laps de temps beaucoup plus court s’était écoulé entre cette exclamation et l’accident, ou si le patient avait pu faire état d’un grand nombre d’expériences vécues tout à fait semblables. En fait, il ne fut pas embarrassé pour trouver de telles confirmations, mais il n’est pas le seul, tous les névrosés de contrainte que j’ai étudiés étaient en mesure de raconter sur eux-mêmes des faits analogues. Ils n’étaient pas du tout surpris de rencontrer régulièrement la personne à laquelle ils venaient justement de penser – et ce, peut-être après un long intervalle – ; d’habitude ils recevaient régulièrement le matin une lettre d’un ami, quand ils avaient dit la veille au soir : « Tiens, voilà longtemps qu’on n’a pas eu de nouvelle de celui-là », et surtout les malheurs et les décès se produisaient rarement sans avoir un instant auparavant effleuré leurs pensées. D’habitude, ils exprimaient cet état de fait de la manière la plus modérée, en affirmant avoir des « pressentiments » qui se confirment « la plupart du temps ».
L’une des formes de superstition les plus inquiétantes et les plus répandues est l’angoisse du « mauvais œili », qui a fait l’objet d’un traitement approfondi par l’ophtalmologiste hambourgeois S. Seligmann[6]. La source à laquelle puise cette angoisse semble n’avoir jamais été méconnue. Celui qui possède quelque chose de précieux et pourtant fragile a peur de l’envie des autres en projetant sur eux cette envie qu’il aurait éprouvée dans le cas inverse. On trahit de telles motions par le regard, même quand on leur refuse l’expression verbale, et quand quelqu’un tranche sur les autres par des caractéristiques frappantes, d’un genre qu’on n’aurait pas particulièrement souhaité, on présume de lui que son envie atteindra une intensité particulière et alors transposera aussi cette intensité en action. On redoute dont une intention secrètej de nuire, et sur la foi de certains indices, on suppose que cette intention a aussi la force à sa disposition.
Les derniers exemples d’inquiétant mentionnés dépendent de ce principe que j’ai nommé, en suivant la suggestion d’un patientk, la « toute-puissance » des pensées ». Nous ne pouvons plus désormais méconnaître le terrain sur lequel nous nous trouvons. L’analyse des cas d’inquiétant nous a ramenés à cette ancienne conception du monde qu’est l’animisme, qui se caractérisait par le peuplement du monde avec des esprits humains, par la surestimation narcissique des processus animiques propres, la toute-puissance des pensées et la technique de la magie fondée sur elle, l’attribution à des personnes et à des choses étrangères de forces d’enchantement aux gradations soigneusement établies (mana), ainsi que par toutes les créations grâce auxquelles le narcissisme illimité de cette période de l’évolution se défendait contre l’objection irrécusable de la réalité. Il semble qu’au cours de notre développement individuel nous ayons traversé une phase correspondant à cet animisme des primitifs, qu’elle ne se soit déroulée chez aucun d’entre nous sans laisser des restes et des traces encore capables de s’exprimer, et que tout ce qui nous paraît aujourd’hui « inquiétant » remplisse la condition qui est de toucher à ces restes d’une activité d’âme animiste et de les inciter à s’exprimer.
Ici trouvent maintenant leur place deux remarques dans lesquelles je voudrais consigner le contenu essentiel de cette petite investigation. Premièrement, si la théorie psychanalytique a raison quand elle affirme que tout affect d’une motion de sentiment, de quelque mode qu’il soit, est transformé en angoisse par le refoulement, il faut qu’il y ait parmi les cas angoissant un groupe où l’on puisse montrer que cet angoissant est quelque chose de refoulé qui fait retour. Ce mode d’angoissant serait justement l’inquiétant, et ici, il est forcément indifférent qu’à l’origine cet inquiétant ait été lui-même angoissant ou bien qu’il ait été porté par un autre affect. Deuxièmement, si telle est effectivement la nature secrètel de l’inquiétant, nous comprenons que l’usage de la langue fasse passer le Heimlich en son opposé, l’Unheimlich (p. 153sq.), car cet Unheimlich n’est effectivement rien de nouveau ou d’étranger, mais quelque chose qui est pour la vie d’âme de tout temps familier, et qui ne lui a été rendu étranger que par le procès du refoulement. La mise en relation avec le refoulement éclaire aussi maintenant pour nous la définition de Schelling selon laquelle l’inquiétant serait quelque chose qui aurait dû rester dans le monde du caché et qui est venu au jour.
[…]a die beständige Wiederkehr des Gleichen. Allusion probable à Nietzsche.
[1] O. Rank, Le Double [Der Doppelgänger], Imago, 1914 [97-164].
[2] Je crois que quand les poètes se plaignent de ce que deux âmes habitent dans la poitrine de l’hommea, et quand les psychologues populaires parlent du clivage du moi en l’homme, c’est cette désunion, ressortissant à la psychologie du moi, entre l’instance critique et le reste du moi qu’ils ont en tête, et non la relation d’opposition, mise à découvert par la psychanalyse, entre le moi et le refoulé inconscient. Il est vrai que cette différence est estompée du fait que parmi ce qui est rejeté par la part critique du moib se trouvent en premier lieu les rejetons du refoulé.
[3] Dans l’œuvre de H.H. Ewersc, « L’étudiant de Prague », dont est partie l’étude de Rank sur le double, le héros a promis à sa fiancée de ne pas tuer son adversaire dans le duel. Mais voilà que sur le chemin menant au lieu du duel vient à sa rencontre le double, qui a déjà liquidé le rival.
a Freud transpose ici le vers 1112 du Premier Faust de Goethe :
« Zwei Seelen wohnen, ach ! in meiner Brust… »
[Deux âmes, hélas, habitent en ma poitrine]b « part critique du moi » traduit Ich-Kritik.
c Hanns Heins Ewers (1871-1943).
b Die Göetter im Exil, in Vermischte Schriften, t. I, p. 77, Hambourg, Hoffmann und Campe, 1854, où Heine parle de « la transformation en démons qu’ont subie les divinités gréco-romaines lorsque le christianisme parvint à l’hégémonie dans le monde ».
c Mark Twain, A Tramp Abroad (Un vagabond à l’étranger), Londres, Chatto et Windus, 1880, I, 107.
c geheim.
d Freud lui-même avait atteint l’âge de soixante-deux ans un an plus tôt, en 1918.
e Il s’agit plus vraisemblablement de Ewald Hering (1834-1918).
[4] P. Kammerer (1880-1926), La loi de la série (Das Gesetz der Serie], Vienne [Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt], 1919.
f Au-delà du principe de plaisir, publié un an après le présent essai (1920).
g Ballade de Schiller inspirée d’Hérodote (1797).
h Ces six mots sont la reprise littérale du vers 91 de la ballade.
[5] Remarques sur un cas de névrose de contrainte [« Bermerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, GW, VII ; OCF-P, IX, p. 202].
i der Böse Blick. Mot à mot : le mauvais regard.
[6] Siegfried Seligmann (1870-1926)]. Le mauvais œil et faits apparentés [Der Böse Blick und Verwandtes], 2 vol., Berlin, [H. Bardsdorf] 1910 et 1911.
j geheim.
k L’homme aux rats, voir supra, n. 5.
l geheim.
Freud, Œuvres complètes. Psychanalyse, t. XV, 1916-1920, Paris, Puf, 2012, p. 147-188 (extrait).
Numéro Regard 2019-1
Le trouble de vision psychogène dans la conception psychanalytique (1910)
Par S. Freud
[…]Des expérimentations judicieuses ont montré que les aveugles par hystérie voient malgré tout, en un certain sens, quoique non au sens plein. Les excitations de l’œil aveugle peuvent malgré tout avoir certaines conséquences psychiques, par exemple provoquer des affects, bien qu’elles ne deviennent pas consciente.
Les aveugles par hystérie ne sont donc aveugles que pour la conscience, dans l’inconscient ils sont voyants. Ce sont justement des expériences de cette sorte qui nous oblige à faire le départ entre processus animique conscient et inconscient. D’où vient qu’ils développent « l’auto suggestion » inconsciente d’être aveugle alors que dans l’inconscient pourtant ils voient.
[…]Les mêmes organes et système d’organes sont d’une manière générale à la disposition des pulsions sexuelles tout comme des pulsions du moi. Le plaisir sexuel n’est pas seulement rattaché à la fonction des organes génitaux ; la bouche sert au baiser tout aussi bien qu’au manger à la communication langagière, les yeux ne perçoivent pas seulement les modifications du monde extérieur, importantes pour la conservation de la vie, mais également les propriétés des objets par lesquels ceux-ci sont élevés au rang d’objet du choix d’amour, leurs « attraits[1] ». Il se confirme dès lors qu’il n’est facile pour personne de servir deux maîtres à la fois.
Plus un organe doué de cette double fonction entre en relation intime avec l’une des grandes pulsions, plus il se refuse[2] à l’autre. Ce principe conduit forcément à des conséquences pathologiques si les deux fonctions fondamentales se sont désunies, si de la part du moi un refoulement est entretenu contre la pulsion partielle sexuelle en question.
L’application à l’œil et à la vision se révèle aisée. Si la pulsion partielle sexuelle qui se sert du regard, le plaisir-désir de regarder sexuel, a attiré sur elle, en raison de ses prétentions excessives, la contre-offensive des pulsions du moi, si bien que les représentations dans lesquelles s’exprime sa tendance succombent au refoulement et sont tenues à l’écart du devenir-conscient, alors la relation de l’œil et de la vision au moi et à la conscience se trouve tout à fait troublée.
Le moi a perdu sa domination sur l’organe qui se met désormais entièrement à la disposition de la pulsion sexuelle refoulée. On a l’impression que de la part du moi, le refoulement va trop loin, qu’il jette l’enfant avec l’eau du bain, du fait que le moi ne veut à présent plus rien voir, dès lors que dans la vision les intérêts sexuels se sont tellement poussés en avant.
Mais il y a certes plus de pertinence dans l’autre présentation qui reporte l’activité du côté du plaisir-désir de regarder-refoulé. C’est la vengeance, le dédommagement de la pulsion refoulée que, tenue à l’écart de tout épanouissement psychique ultérieur, elle soit à même d’accroître sa domination sur l’organe à son service. La perte de la domination consciente sur l’organe est la formation substitutive nuisible, en place du refoulement raté qui n’était rendu possible qu’à ce prix.
Plus nettement encore que dans le cas de l’œil, cette relation qu’a l’organe, revendiqué de deux côtés, avec le moi conscient et avec la sexualité refoulée est visible dans le cas des organes moteurs, lorsque par exemple la main qui voulait exécuter une agression sexuelle est hystériquement paralysée et, l’agression une fois inhibée, ne peut plus rien faire d’autre, quasiment comme si elle s’en tenait avec entêtement à l’exécution de cette seule innervation refoulée, où lorsque les doigts de personnes qui ont renoncé à la masturbation se refusent[3] à apprendre le subtil jeu de mouvement que requiert le piano ou le violon. Pour l’œil, nous avons coutume de traduire les obscurs processus psychiques intervenant lors du refoulement du plaisir-désir de regarder sexuel et lors de l’apparition du trouble de vision psychogène, comme si s’élevait dans l’individu une voix punitive qui dît : « puisque tu voulais mésuser de ton organe de la vision pour un mauvais plaisir des sens c’est très bien fait pour toi si tu ne vois plus rien du tout » et qui approuvât ainsi l’issue du procès.
Alors il y a là inclusion l’idée du talion et à vrai dire notre explication du trouble de vision psychogène a coïncider avec celle qui est proposée par la fable, le mythe, la légende.
Dans la belle fable de Lady Godiva[4], tous les habitants de la petite ville se cachent derrière leurs fenêtres fermées pour rendre plus facile à la dame la tache de parcourir les rues en plein jour, nue sur un cheval. Le seul qui épie à travers ses persiennes la beauté dénudée est puni en devenant aveugle. Ce n’est d’ailleurs pas le seul exemple qui nous fasse pressentir que la névrotique[5] recèle aussi la clé de la mythologie.
[1] Reize. Dans d’autres contextes, Reiz est traduit par « stimulus »
[2] Verweigrt sich.
[3] Such weigern.
[4] Épouse du comte de Chester, Leofric. Elle n’obtint de son mari un allégement des impôts qui écrasaient la population de Coventry qu’à la condition de traverser la ville entièrement nue sur un cheval.
[5] Die Neurotik : le champ des névroses
Numéro Transformations et accomplissements psychiques 2018-5
Josef Popper-Lynkeus et la théorie du rêve (1923f)
En 1923, Freud écrit un petit texte, « Joseph Popper-Lynkeus et la théorie du rêve », dans lequel il revient sur l’importance du concept de déformation (Die Entstellung) qu’il considère comme « sa seule et unique découverte » ayant permis tous ses développements ultérieurs. Freud avait montré l’importance de ce processus dans le chapitre IV de la Traumdeutung (1900) auquel il avait donné pour titre « La déformation ».
À cette époque, Freud relie la déformation aux pensées latentes, elles-mêmes reliées à un désir inconscient. Ces pensées latentes réapparaissent sous une forme déguisée dans le produit (contenu ?) manifeste du rêve et on peut les retrouver via l’interprétation. Freud considère donc déjà en 1900 que la déformation est une exigence imposée par la censure qui assure cette fonction de dissimulation. La déformation des pensées latentes a aussi pour fonction de représenter les désirs infantiles refoulés qui ne peuvent être connus que par le biais du travail de rêve. Cependant, la pensée de Freud évolue au fil du temps, car ce sont les qualités des désirs infantiles qu’on doit dissimuler, voire celles de l’inconscient lui-même. Enfin, c’est l’exigence de la censure puis du surmoi qui, s’opposant au traumatique inconscient, réalise le travail de déformation.
Dans ce texte de 1923, Freud revient à sa conception première d’une déformation due aux « grandes valeurs morales et esthétiques ». On peut se demander si, au nom de son admiration pour Popper-Lynkeus, Freud ne met pas de côté toutes les autres fonctions de la déformation qu’il a progressivement découvertes. Mais ce texte, peu connu, mérite de l’être.
Sabina Lambertucci-Mann
Josef Popper-Lynkeus et la théorie du rêve (1923f)
Par S. FREUD
Sur l’apparence d’originalité scientifique, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Lorsqu’en science émerge une idée nouvelle, à qui tout d’abord est attribuée valeur de découverte, et qui en règle générale est combattue aussi comme telle, l’exploration objective ne tarde pas à mettre en évidence qu’à vrai dire elle n’est pourtant pas une nouveauté. En règle générale, elle a déjà été produite de façon répétée, puis de nouveau oubliée, souvent à des périodes fort éloignées les unes des autres. Ou bien, elle a eu tout au moins des précurseurs, a été indistinctement pressentie ou imparfaitement énoncée. Tout cela est trop précisément connu pour nécessiter un plus ample développement.
Mais le côté subjectif de l’originalité, lui aussi, mérite qu’on s’y attache. Un travailleur scientifique peut bien une fois se poser la question de savoir d’où viennent les idées lui appartenant en propre, qu’il a appliquées à son matériel. Il trouve alors pour une partie d’entre elles, sans beaucoup de réflexion, jusqu’à quelles incitations il remonte, quelles indications provenant d’un autre côté il a ainsi ramassées, modifiées et développées dans toutes leurs conséquences. Pour une autre part de ses idées il ne peut rien confesser de tel, il lui faut admettre que ces pensées et points de vue ont pris naissance – il ne sait comment – dans sa propre activité de pensée, c’est par eux qu’il soutient sa prétention à l’originalité.
Une investigation psychologique soigneuse restreint alors encore davantage cette prétention. Elle met à découvert des sources dissimulées, depuis longtemps oubliées, d’où a jailli l’incitation produisant les idées apparemment originales, et à la place de la néo-création présumée elle met une revivification de l’oublié dans l’application à un nouveau matériau. Il n’y a là rien à regretter ; on n’avait en effet aucun droit d’attendre que l’« original » fût quelque chose de non dérivable, d’indéterminé. C’est de cette façon que, dans mon cas aussi, l’originalité de nombreuses pensées nouvelles que j’avais utilisées dans l’interprétation du rêve et dans la psychanalyse s’est volatilisée. D’une seule de ces pensées j’ignore la provenance. Elle est justement devenue la clef de ma conception du rêve et elle m’a aidé à résoudre ses énigmes, pour autant qu’elles soient, jusqu’à ce jour, devenues résolubles. Je suis parti du caractère étrange, embrouillé, insensé de tant de rêves, et en suis venu à l’idée que le rêve devait devenir tel parce que, en lui, quelque chose lutte pour l’expression, quelque chose qui a contre soi la résistance d’autres puissances de la vie d’âme. Dans le rêve s’agitent des motions secrètes qui sont en contradiction avec l’aveu, pour ainsi dire officiel, éthique et esthétique, du rêveur ; c’est pourquoi le rêveur a honte de ces motions, s’en détourne le jour, n’en veut rien savoir, et s’il ne peut, de nuit, leur défendre toute forme d’expression, il les contraint à la déformation de rêve, par laquelle le contenu de rêve apparaît embrouillé et insensé. La puissance animique en l’homme, qui tient compte de cette contradiction interne et qui déforme, au profit des revendications conventionnelles ou même des revendications morales suprêmes, les motions pulsionnelles du rêve, je l’ai nommée la censure de rêve.
Or c’est justement ce pan essentiel de ma théorie du rêve que Popper-Lynkeus a lui-même trouvé. Qu’on se réfère à la citation suivante tirée de son récit « Rêver de même façon que veiller » dans les « Fantaisies d’un réaliste » qui, à coup sûr, ont été écrites sans la connaissance de ma « Théorie du rêve » publiée en 1900 [L’interprétation du rêve], tout comme alors, moi non plus, je ne connaissais pas encore les Fantaisies de Lynkeus :
« D’un homme, qui a la propriété remarquable de ne jamais rêver de non-sens […] » « Cette magnifique propriété de rêver de même façon que veiller repose sur tes vertus, sur ta bonté, sur ton équité, ton amour de la vérité : c’est la clarté morale de ta nature qui me rend tout compréhensible en toi. »
« Mais tout bien considéré, répliqua l’autre, je ne suis pas loin de croire que tous les hommes sont faits comme moi, et qu’absolument personne ne rêve jamais de non-sens ! Un rêve dont on se souvient si nettement qu’on ne peut le raconter qu’après, qui n’est donc pas un rêve de fièvre, a toujours du sens. Et il ne peut absolument pas en être autrement ! Car ce qui est en contradiction réciproque ne pourrait évidemment pas se grouper en un tout. Le fait que temps et lieu se télescopent souvent l’un l’autre n’ôte absolument rien à la véritable teneur du rêve, car tous deux ont été à coup sûr sans significativité pour son contenu essentiel. N’en faisons-nous pas souvent autant dans la veille : pense au conte, à tant de formations de fantaisie pleines de sens, dont seul celui qui ne comprend pas dirait : cela va contre le sens ! Car ce n’est pas possible ! »
« Si l’on savait seulement interpréter les rêves toujours exactement ainsi que tu viens de le faire pour le mien ! » dit l’ami.
« Cela n’est certes pas une tâche facile, mais au prix de quelque attention celui qui rêve ne devrait pas manquer d’y réussir toujours. Pourquoi la plupart du temps cela ne réussit pas toujours ? Il semble chez vous y avoir quelque chose de caché dans les rêves, quelque chose d’impudique, d’une espèce propre à vous et plus élevée, un certain côté secret en votre être, qui est difficile à imaginer ; et c’est pourquoi ce que vous rêvez semble si souvent dénué de sens et même être un contresens. Mais dans le tréfonds il n’en va pas ainsi ; en vérité il ne peut absolument pas en être autrement, car c’est toujours le même homme, qu’il veille ou qu’il rêve. »
Je crois que ce qui m’a rendu capable de dépister la cause de la déformation de rêve fut mon courage moral. Chez Popper ce fut la pureté, l’amour de la vérité et la clarté morale de son être.
Freud, Œuvres complètes. Psychanalyse, t. XVI, Paris, Puf, 1991, p. 317-319.
Numéro Lacan aujourd’hui 2018-4
De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l’homosexualité
Par S. FREUD
Traduit de l’allemand par Jacques LACAN
(Paru pour la première fois dans Internationale Zeilschriftfûr Psychoanalyse, Bd VIII, 1922)
A) La jalousie ressortit à ces états affectifs que l’on peut classer, comme on le fait pour la tristesse, comme états normaux. Quand elle paraît manquer dans le caractère et la conduite d’un homme, on est justifié à conclure qu’elle a succombé à un fort refoulement, et en joue dans la vie inconscient un rôle d’autant plus grand. Les cas de jalousie anormalement renforcée, auxquels l’analyse a affaire se montrent triplement stratifiés. Ces trois assises ou degrés de la jalousie méritent les dénominations de :
- jalousie de concurrence, ou jalousie normale ;
- jalousie de projection ;
- jalousie délirante.
Sur la jalousie normale, il y a peu à dire du point de vue de l’analyse. Il est facile de voir qu’essentiellement elle se compose de la tristesse ou douleur de croire perdu l’objet aimé, et de la blessure narcissique, pour autant que celle-ci se laisse isoler de la précédente ; elle s’étend encore aux sentiments d’hostilité contre le rival préféré, et, dans une mesure plus ou moins grande, à l’autocritique qui veut imputer au propre moi du sujet la responsabilité de la perte amoureuse. Cette jalousie, pour normale que nous la dénommions, n’est pour cela nullement rationnelle, je veux dire issue de situations actuelles, commandée par le moi conscient en fonction de relations réelles et uniquement par lui. Elle prend, en effet, sa racine profonde dans l’inconscient, prolonge les toutes primes tendances de l’affectivité infantile, et remonte au complexe d’Œdipe et au complexe fraternel, qui sont de la première période sexuelle. II reste très digne de remarque qu’elle soit vécue par maintes personnes sous un mode bisexuel, je veux dire chez l’homme, qu’à part la douleur au sujet de la femme aimée et la haine contre le rival masculin, une tristesse aussi, qui lient à un amour inconscient pour l’homme, et une haine contre la femme, vue comme rivale, agissent en lui pour renforcer le sentiment. Je sais un homme qui souffrait très fort de ses accès de jalousie, el qui selon son dire, traversait ses tourments les plus durs dans une substitution imaginative consciente à la femme infidèle. La sensation qu’il éprouvait alors d’être privé de tout recours, les images qu’il trouvait pour son état, se dépeignant comme livré, tel Prométhée, à la voracité du vautour, ou jeté enchaîné dans un nid de serpents, lui-même les rapportait à l’impression laissée par plusieurs agressions homosexuelles, qu’il avait subies. tout jeune garçon.
La jalousie du second degré, jalousie de projection, provient chez l’homme comme chez la femme, de l’infidélité propre du sujet, réalisée dans la vie, ou bien d’impulsions à l’infidélité qui sont tombées dans le refoulement. C’est un fait d’expérience quotidienne, que la fidélité, surtout celle qu’on exige dans le mariage, ne se maintienne qu’au prix d’une lutte contre de constantes tentations, Celui-là même qui en soi les nie, ressent pourtant leur pression avec une telle force, qu’il sera enclin à adopter un mécanisme inconscient pour se soulager, Il atteindra ce soulagement, j’entends l’absolution de sa conscience, en projetant ses propres impulsions à l’infidélité sur la partie opposée, à qui il doit fidélité. Ce motif puissant peut alors se servir des données immédiates de l’observation qui trahissent les tendances inconscientes de même sorte de l’autre partie, et trouverait encore à se justifier par la réflexion que le ou la partenaire, selon toute vraisemblance, ne vaut pas beau coup plus que l’on ne vaut soi-même (1).
Les usages sociaux ont mis ordre à ce commun état de choses avec beaucoup de sagesse, en laissant un certain champ au goût de plaire de la femme mariée et au mal de conquête du mari. Par celle licence, on tend à drainer l’irrépressible tendance à l’infidélité et à la rendre inoffensive, La convention établit que les deux parties n’ont pas mutuellement à se tenir compte de ces menus entrechats sur le versant de l’infidélité, et il arrive le plus souvent que le désir qui s’enflamma à un objet étranger s’assouvisse, dans un retour au bercail de la fidélité, près de l’objet qui est le sien. Mais le jaloux ne veut pas reconnaître cette tolérance conventionnelle, il ne croit pas qu’il y ait d’arrêt ni de retour dans cette voie une fois prise. Ni que ce jeu de société, qu’est le « flirt » même, puisse être une assurance contre la réalisation de l’infidélité. Dans le traitement d’un tel jaloux on doit se garder de discuter les données de fait sur lesquelles il s’appuie ; on ne peut viser qu’à le déterminer à les apprécier autrement.
La jalousie qui tire origine d’une telle projection a déjà presque un caractère délirant, mais elle ne s’oppose pas au travail analytique qui révélera les fantasmes inconscients, propres à l’infidélité du sujet lui-même.
Il en va moins bien de la jalousie de la troisième espèce, jalousie véritablement délirante. Elle aussi vient de tendances réprimées à l’infidélité, mais les objets de ses fantasmes sont de nature homosexuelle. La jalousie délirante répond à une homosexualité « tournée à l’aigre », et a sa place toute désignée parmi les formes classiques de la paranoïa. Essai de défense contre une trop forte tendance homosexuelle, elle pourrait (chez l’homme) se laisser circonscrire par cette formule : Je ne l’aime pas lui, c’est elle qui l’aime (2).
Dans un cas donné de délire de jalousie, il faut s’attendre à voir la jalousie tirer sa source de l’ensemble de ces trois assises, jamais seulement de la troisième.
B) La paranoïa – Pour des raisons connues, les cas de paranoïa se soustraient le plus souvent à l’examen analytique. Cependant, j’ai pu ces derniers temps tirer de l’étude intensive des deux paranoïaques quelque chose qui était pour moi
Le premier cas fut celui d’un jeune homme qui présentait, pleinement épanouie, une paranoïa de jalousie, dont l’objet était son épouse d’une fidélité au-dessus de tout reproche. Il sortait alors d’une période orageuse, dans laquelle il avait été dominé sans rémission par son délire. Lorsque je le vis, il présentait encore des accès bien isolés qui duraient plusieurs jours, et, point intéressant, débutaient régulièrement le lendemain d’un acte sexuel, qui se passait d’ailleurs à la satisfaction des deux parties. On est en droit d’en conclure qu’à chaque fois, après que fut assouvie la libido hétérosexuelle, la composante homosexuelle, réveillée avec elle, se frayait son expression par l’accès de jalousie.
Le malade tirait les faits dont prenait donnée son accès, de l’observation des plus petits signes par où la coquetterie pleinement inconsciente de la femme s’était trahie pour lui, là où nul autre n’eût rien vu. Tantôt elle avait frôlé de la main par mégarde le monsieur qui était à côté d’elle, tantôt elle avait trop penché son visage vers lui et lui avait adressé un sourire plus familier que si elle était seule avec son mari. Pour toutes ces manifestations de son inconscient il montrait une attention extraordinaire et s’entendait à les interpréter avec rigueur, si bien qu’à vrai dire il avait toujours raison et pouvait encore en appeler à l’analyse pour confirmer sa jalousie. En vérité, son anomalie se réduisait à ce qu’il portait sur l’inconscient de sa femme une observation trop aiguë et qu’il y attachait beaucoup plus d’importance qu’il ne serait venu à l’idée de tout autre.
Souvenons-nous que les paranoïaques persécutés se comportent de façon tout à fait analogue. Eux aussi ne reconnaissent chez autrui rien d’indifférent et, dans leur « délire de relation », sollicitent les plus petits indices que leur livrent les autres, les étrangers. Le sens de ce délire de relation est précisément qu’ils attendent de tous les étrangers quelque chose comme de l’amour, mais les autres ne leur montrent rien de pareil, ils se gaussent en leur présence, brandissent leurs cannes et crachent aussi bien par terre sur leur passage, et réellement c’est là ce qu’on ne fait pas lorsqu’on prend à la personne qui est dans le voisinage le moindre intérêt amical. Ou alors, on ne fait cela que lorsque cette personne vous est tout à fait indifférente, lorsqu’on peut la traiter comme l’air ambiant, et le paranoïaque n’a, quant à la parenté foncière des concepts d’«étranger » et d’« hostile » pas si grand tort en ressentant une telle indifférence, en réponse à son exigence amoureuse à la façon d’une hostilité.
Nous soupçonnons maintenant qu’est peut-être insuffisante notre description de la conduite des paranoïaques, tant du jaloux que du persécuté, quand nous disons qu’ils projettent au dehors sur autrui ce qu’ils se refusent à voir dans leur for intérieur.
Certes, c’est ce qu’ils font, mais par ce mécanisme ils ne projettent pour ainsi dire, rien en l’air, ils ne créent rien là où il n’y a rien, bien plutôt se laissent-ils guider par leur connaissance de l’inconscient, en déplaçant sur l’inconscient d’autrui cette attention qu’ils soustraient au leur propre. Que notre jaloux reconnaisse l’inconstance de sa femme, il la substitue à la sienne ; en prenant conscience des sentiments de celle-ci, déformés et monstrueusement amplifiés, il réussit à maintenir inconscients ceux qui lui reviennent. En prenant son exemple pour typique, nous conclurons que l’hostilité, que le persécuté découvre chez les autres, n’est aussi que le reflet de ses propres sentiments hostiles à leur égard. Or, nous savons que, chez le paranoïaque, c’est justement la personne de son sexe qu’il aimait le plus, qui se transforme en persécuteur ; dès lors surgit le point de savoir d’où naît cette interversion affective, et la réponse qui s’offre à nous serait que l’ambivalence toujours présente du sentiment fournit la base de la haine, et que la prétention à être aimé, faute d’être comblée, la renforce. Ainsi, l’ambivalence du sentiment rend au persécuté le même service pour se défendre de son homosexualité que la jalousie à notre patient.
Les rêves de mon jaloux me réservaient une grande surprise. À vrai dire, ils ne se montraient jamais simultanément avec l’explosion de l’accès, mais pourtant encore sous le coup du délire ; ils étaient complètement purs d’élément délirant, et laissaient reconnaître les tendances homosexuelles sous-jacentes sous un déguisement non moins pénétrable qu’il n’était habituel autrement. Dans ma modeste expérience des rêves des paranoïaques, je n’étais dès lors pas loin d’admettre que communément la paranoïa ne pénètre pas dans le rêve.
L’état d’homosexualité se saisissait chez ce patient à première vue. Il n’avait cultivé ni amitié ni aucun intérêt social ;·l’impression s’imposait d’un délire auquel serait incombée la charge de l’évolution de ses rapports avec l’homme, comme pour lui permettre de rattraper une part de ce qu’il avait manqué à réaliser. La mince importance du père dans sa famille et un trauma homosexuel humiliant dans ses primes années de jeune garçon avaient concouru à réduire au refoulement son homosexualité et à lui barrer la route vers la sublimation. Sa jeunesse tout entière fut dominée par un fort attachement à la mère. De plusieurs fils, il était le chéri avoué de sa mère, et il épanouit à son endroit une forte jalousie du type normal. Lorsque plus tard il se décida pour un mariage, décision prise sous le coup de ce motif essentiel d’apporter la richesse à sa mère, son besoin d’une mère virginale s’exprima dans des doutes obsessionnels sur la virginité de sa fiancée. Les premières années de son mariage furent sans traces de jalousie. Il fut alors infidèle à sa femme et s’engagea dans une liaison durable avec une autre. Dès que l’effroi d’un soupçon précis l’eut fait rompre ces relations amoureuses, une jalousie du second type éclata chez lui, jalousie de projection, au moyen de quoi il put imposer silence aux reproches touchant son infidélité. Elle se compliqua bientôt par l’entrée en scène de tendances homosexuelles, dont l’objet était son beau-père, pour former une paranoïa de jalousie, pleine et entière.
Mon second cas n’aurait vraisemblablement pas été classé sans l’analyse comme paranoïa persecutoria, mais je fus contraint de concevoir ce jeune homme comme un candidat à cette issue morbide. Il existait chez lui une ambivalence dans les relations avec son père d’une envergure tout à fait extraordinaire. II était d’une part le rebelle avoué qui s’était développé manifestement et en tous points, en s’écartant des désirs et des idéaux de son père ; d’autre part, dans un plan plus profond, il était toujours le plus soumis des fils, celui qui, après la mort de son père, eut conscience d’une dette de cœur, et s’interdit la jouissance de la femme. Ses rapports avec les hommes dans la réalité se posaient ouvertement sous le signe de la méfiance ; avec sa force d’intelligence il savait rationaliser cette réserve, et s’entendait à tout arranger en sorte que ses connaissances et amis le trompent et l’exploitent. Ce qu’il m’apprit de neuf, c’est que les classiques idées de persécution peuvent subsister, sans trouver chez le sujet foi ni assentiment. Occasionnellement, durant l’analyse, on les voyait passer en éclairs, mais il ne leur accordait aucune importance et, dans la règle, s’en moquait. II se pourrait qu’il en fût de même dans bien des cas de paranoïa. Les idées délirantes qui se manifestent quand une telle affection éclate, peut-être les tenons-nous pour des néoproductions alors qu’elles sont constituées depuis longtemps.
Une vue primordiale me paraît être celle-ci, qu’une instance qualitative, telle que la présence de certaines formations névrotiques, importe moins en pratique que cette instance quantitative, à savoir, quel degré d’attention, ou, avec plus de rigueur, quel ordre d’investissement affectif ces thèmes peuvent concentrer en eux. La discussion de notre premier cas, de la paranoïa de jalousie, nous avait incité à donner cette valeur à l’instance quantitative, en nous montrant que l’anomalie consistait là essentiellement en ce surinveslissement affecté aux interprétations touchant l’inconscient étranger. Par l’analyse de l’hystérie, nous connaissons depuis longtemps un fait analogue. Les fantasmes pathogènes, les rejetons de tendances réprimées, sont tolérés longtemps à côté de la vie psychique normale et n’ont pas d’efficacité morbifique, jusqu’à ce qu’ils reçoivent d’une révolution de la libido une telle surcharge ; d’emblée éclate alors le conflit qui conduit à la formation du symptôme. Ainsi sommes-nous conduits de plus en plus, dans la poursuite de notre connaissance, à ramener au premier plan le point de vue économique. J’aimerais aussi soulever le point de savoir si cette instance quantitative sur quoi j’insiste ici, ne tend pas à recouvrir les phénomènes pour lesquels Bleuler et d’autres récemment veulent introduire le concept d’« action de circuit ». Il suffirait d’admettre que d’un surcroît de résistance dans une direction du cours psychique s’ensuit une surcharge d’une autre voie, et par là sa mise en circuit dans le cycle qui s’écoule.
Un contraste instructif se révélait dans mes deux cas de paranoïa quant au comportement des rêves. Alors que, dans le premier cas, les rêves, nous l’avons noté, étaient purs de tout délire, le second malade produisait en grand nombre des rêves de persécution, où l’on peut voir des prodromes et des équivalents pour les idées délirantes de même contenu. L’agent persécuteur, auquel il ne pouvait se soustraire qu’avec une grande anxiété, était dans la règle un puissant taureau ou quelque autre symbole de la virilité, que bien des fois en outre il reconnut au cours même du rêve comme une forme de substitution du père. Une fois il rapporta, dans la note paranoïaque, un très caractéristique rêve de transfert. Il vit qu’en sa compagnie je me rasais, et remarqua à l’odeur que je me servais du même savon que son père. J’en agissais ainsi pour l’obliger au transfert du père sur ma personne. Dans le choix de la situation rêvée se montre, de façon impossible à méconnaître, le maigre cas que fait le patient de ses fantasmes paranoïaques et le peu de créance qu’il leur accorde ; car une contemplation quotidienne pouvait l’instruire qu’en général je ne me mets pas dans le cas de me servir de savon à raser, et qu’ainsi sur ce point je n’offrais aucun appui au transfert paternel.
Mais la comparaison des rêves chez nos deux patients nous apprend que la question soulevée par nous, à savoir si la paranoïa (ou toute autre psychonévrose) pouvait pénétrer même dans le rêve, ne repose que sur une conception incorrecte du rêve. Le rêve se distingue de la pensée de veille en ce qu’il peut accueillir des contenus (du domaine refoulé) qui n’ont pas le droit de se présenter dans la pensée vigile. Abstraction faite de cela, il n’est qu’une forme de la pensée, une transformation de la matière pensable de la préconscience, par le travail du rêve et ses déterminations. Au refoulé lui-même notre terminologie des névroses ne s’applique pas ; on ne peut le qualifier ni d’hystérique, ni d’obsessionnel, ni de paranoïaque. C’est au contraire l’autre partie de la matière soumise à l’élaboration du rêve, ce sont les pensées préconscientes qui peuvent ou bien être normales, ou porter en soi le caractère d’une quelconque névrose. Les pensées préconscientes ont des chances d’être des résultats de tous ces processus pathogènes où nous reconnaissons l’essence d’une névrose. On ne voit pas pourquoi chacune de ces idées morbides ne devrait pas subir la transformation en un rêve. Sans aller plus loin, un rêve peut ainsi naître d’un fantasme hystérique, d’une représentation obsessionnelle, d’une idée délirante, je veux dire livrer dans son interprétation de tels éléments. Dans notre observation de deux paranoïaques, nous trouvons que le rêve de l’un est normal, alors que l’homme est en accès, et que celui de l’autre a un contenu paranoïaque, quand le sujet se moque encore de ses idées délirantes. Ainsi, dans les deux cas, le rêve accueille ce qui dans le même temps est réprimé lors de la vie de veille. Encore ceci n’est-il pas forcément la règle.
C) L’homosexualité. – La reconnaissance du facteur organique de l’homosexualité ne nous dispense pas d’étudier les processus psychiques qui sont à son origine. Le processus typique, bien établi dans des cas sans nombre, consiste en ce que chez le jeune homme, jusqu’alors intensément lié à sa mère, se produit, quelques années après le cours de la puberté, une crise ; il s’identifie soi-même avec la mère et cherche à son amour des objets où il puisse se retrouver lui-même et qu’il ait le loisir d’aimer, comme sa mère l’a aimé. Comme vestige de ce processus, une condition d’attrait s’impose au sujet, d’habitude pour nombre d’années, c’est que les objets masculins aient l’âge où chez lui le bouleversement eut lieu. Nous avons appris à connaître les divers facteurs qui, avec une force variable, contribuent vraisemblablement à ce résultat. Tout d’abord la fixation à la mère qui enraye le passage à un autre objet féminin. L’identification à la mère permet de sortir des liens qui se rattachent à son endroit, tout en ouvrant la possibilité de rester fidèle en un certain sens à ce premier objet. Ensuite, vient la tendance au choix narcissique de l’objet, qui d’une façon générale est plus immédiate et plus facile à accomplir que la conversion vers l’autre sexe. Derrière cette instance s’en dissimule une autre d’une force toute particulière, ou bien peut-être coïncide-t-elle avec la première : le haut prix attaché à l’organe mâle et l’impossibilité de renoncer à ce qu’il existe dans l’objet aimé. Le mépris de la femme, l’aversion pour elle, voire le dégoût qu’elle provoque, se rattachent dans la règle à la découverte tôt faite que la femme ne possède pas de pénis. Plus tard, nous ayons découvert encore, comme un puissant motif d’un choix homosexuel de l’objet, les égards pour le père ou l’angoisse éprouvée à son endroit, quand le renoncement à la femme signifie que l’on esquive la concurrence avec lui (ou toutes les personnes mâles qui jouent son rôle). Ces deux derniers motifs, l’arrêt à la condition du pénis, ainsi que la dérobade, peuvent être attribués au complexe de castration. Attachement à la mère – narcissisme, – angoisse de castration, ces instances au reste nullement spécifiques, nous les avons repérées jusqu’alors dans l’étiologie psychique de l’homosexualité ; s’y associent encore l’influence d’une séduction, qui peut répondre d’une fixation précoce de la libido, ainsi que celle du facteur organique qui favorise le rôle passif dans la vie
Mais nous n’avons jamais cru que cette analyse de l’origine de l’homosexualité fût complète. Je suis aujourd’hui en état d’indiquer un nouveau mécanisme qui mène au choix homosexuel de l’objet, bien que je ne puisse préciser à quelle ampleur il faut fixer son rôle dans la constitution de l’homosexualité extrême, de celle qui est manifeste et exclusive. L’observation m’a rendu attentif à plusieurs cas, où, dans la première enfance, des tendances jalouses d’une force singulière, issues du complexe maternel, s’étaient élevées contre des rivaux, le plus souvent contre des frères plus âgés. Cette jalousie menait à des attitudes intensément hostiles et agressives envers le groupe des frères, attitudes qui purent aller jusqu’au vœu meurtrier, mais ne résistèrent pas à l’action du développement. Sous l’influence de l’éducation, sûrement aussi par suite de l’échec où les vouait leur impuissance, ces tendances venaient à être refoulées, le sentiment à se retourner, si bien que les précoces rivaux étaient maintenant les premiers objets homosexuels. Une telle issue de l’attachement à la mère nous montre des rapports, intéressants, en plus d’un point, avec d’autres processus de nous connus. Elle est tout d’abord le pendant complet du développement de la paranoïa persecutoria, dans laquelle les personnes primitivement aimées se changent en persécuteurs haïs, tandis qu’ici les rivaux haïs se retrouvent objets d’amour. Par-delà elle figure une exagération du procès qui, selon mes vues, mène à la genèse individuelle des instincts sociaux (3). Ici et là existent tout d’abord des tendances jalouses et hostiles qui ne peuvent trouver satisfaction, et les sentiments d’identification, de nature amoureuse, aussi bien que sociale, naissent comme formes de réaction contre les impulsions agressives refoulées.
Ce nouveau mécanisme du choix homosexuel de l’objet, qui jaillit de la rivalité surmontée et du refoulement des tendances agressives, vient se mêler, dans bien des cas, aux déterminations typiques de nous connues. Il n’est pas rare d’apprendre, par l’histoire de la vie des homosexuels, que le tournant est survenu après que la mère eut fait l’éloge d’un autre enfant et l’eut donné en exemple. C’est là ce qui a réveillé la tendance au choix narcissique de l’objet et, après une courte phase de jalousie aiguë, changé le rival en objet aimé. Par ailleurs, le nouveau mécanisme se distingue en ce que dans ces cas la transformation se produit au cours d’années bien plus précoces et que l’identification à la mère passe au second plan. Aussi bien, dans les cas que j’ai observés, ne conduisait-il qu’à des attitudes homosexuelles, qui n’excluaient pas l’hétérosexualité et n’entraînaient aucun horror feminæ.
Le fait est bien connu qu’un assez grand nombre de personnes homosexuelles se signalent par un développement particulier des instincts à tendance sociale et par leur dévouement à des intérêts d’utilité publique. On serait tenté de lui donner cette explication théorique, qu’un homme qui voit dans les autres hommes de virtuels objets d’amour, doit se comporter différemment envers la communauté des hommes, qu’un autre qui est forcé d’envisager l’homme d’abord comme un rival auprès de la femme. Une seule considération s’y oppose, c’est que dans l’amour homosexuel il y a aussi rivalité et jalousie et que la communauté des hommes comprend aussi ces rivaux possibles. Mais, s’abstiendrait-on de cette motivation spéculative, il ne peut être indifférent, pour les rapports de l’homosexualité et du sens social, qu’en fait il ne soit pas rare de voir naître le choix homosexuel de l’objet d’une maîtrise précoce de la rivalité à l’égard de l’homme.
Dans la conception psychanalytique nous sommes habitués à concevoir les sentiments sociaux comme des sublimations de comportements, homosexuels quant à leur objet. Chez les homosexuels doués de sens social, les sentiments sociaux n’auraient pas opéré leur détachement du choix primitif de l’objet avec un entier bonheur.
(1) Comparez cette strophe du chant de Desdémone : « Je l’appelai trompeur ? Que dit-il à cela ? Si je regarde la fille, tu lorgnes vers le garçon.
(2) Rapprocher le développement du cas Schreber : « Remarque psychanalytiques sur la description autobiographique d’un cas de paranoïa (démence paranoïde) », [recueilli dan, le vol. VIII des Œuvres complètes]. (trad. fr. Marie Bonaparte et R Loewenstein, Revue française de Psychanalyse, tome V, n° 1).
(3) Voyez « Psychologie des foules et analyse du moi 1921 (vol. VI des Œuvres complètes), trad. fr. Jankélévitch, Paris, Payot.

