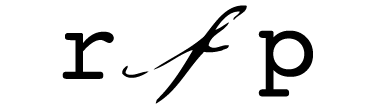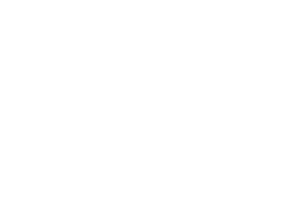Destruction et désaffiliation. Psychopathologie de la violence à l’adolescence
Dunod, Collection Psychismes
EAN 9782100836505 EAN Ebook : Epub 9782100842216
400 pages
Parution juin 2023
Prix : 35,00€
Gérard Pirlot est psychanalyste membre de la Société psychanalytique de Paris, professeur émérite des Universités, ancien Psychiatre des Hôpitaux.
Auteur d’une trentaine de livres, Maurice Corcos nous offre ici un ouvrage important par ses références cliniques, théoriques et littéraires, sur le thème de la violence à l’adolescence. Les 384 pages de cet ouvrage se découpent en treize chapitres, allant de l’« Argument et avant-propos », où est d’emblée posée la question des liens entre la violence et le narcissisme, au chapitre treize « Travail sur les déliaisons dangereuses » (Corcos, p. 361).
Disons-le d’emblée, cet ouvrage est tout à fait original tant dans la forme que dans le fond. Son écriture est serrée, dense, la phrase, parfois longue, d’autres fois courte, est toujours haletante, habitée explicitement ou implicitement de références métapsychologiques, littéraires ou philosophiques. Comme si l’auteur voulait nous faire pénétrer, par le style, dans les mouvements psychiques des « adolescents difficiles » (violents, suicidaires, avec troubles du comportement alimentaire ou toxicomanes) et ainsi nous faire percevoir le « trop-plein » de sensations, face au vide de pensée qui les hante et les déborde, jusqu’à contaminer, dans le contre-transfert, le psychiatre-psychanalyste thérapeute qui les écoute.
Dans la « musique des mots » de sa prose, Corcos nous plonge dans les affects étranglés de ses patients et le travail de penser que cela lui impose. La forme, c’est ici, plus que jamais, le fond ramené à la surface.
Si « un mot n’est pas le même dans un écrivain et dans un autre. L’un se l’arrache du ventre. L’autre le tire de la poche de son pardessus », comme l’écrit Charles Péguy (1934, p, 47), Corcos, les arrache à l’évidence du ventre de son contre-transfert, faisant œuvre d’écrivain, n’hésitant pas à tirer son travail, j’y reviendrai, de ses propres souvenirs d’enfance. Concernant le fond, la compréhension des phénomènes de violences chaudes (passages à l’acte hétéro-agressifs ou auto-agressifs) ou celles « froides » (inégalités sociales, « horreur économique », comme l’écrit Viviane Forrester en 1996), racisme, violence « lisse et tranchante d’hommes sans qualité aux manettes de la gestion néolibérale de la société » (Corcos, p. 64) l’est, certes avec l’outil psychopathologique et métapsychologique, ainsi qu’avec des références littéraires ou philosophiques, mais surtout avec l’expérience du contre-transfert et, plus encore, celle des réminiscences d’une enfance dans la banlieue parisienne.
L’adolescence d’un psychanalyste… d’adolescents.
Les délinquants, de même que les patients qu’il traite depuis une trentaine d’années dans sa clinique et son service, qu’ils soient des adolescents ayant des « troubles limites », des symptômes addictifs ou agirs comportementaux, l’auteur en effet les (re)connaît pour avoir partagé avec eux, de l’école primaire au lycée, la dureté, l’âpreté, l’injustice de la vie et des conditions d’existence dans les cités HLM. La plupart étaient « enfants du vide et du silence » (p. 88), en particulier de parole, d’amour et d’autorité paternels. En ce sens, cet ouvrage se présente également, dans deux de ses chapitres, comme un témoignage des conditions de délinquance et de violence, de rencontres avec la pauvreté comme avec la drogue, qu’un jeune élève issu des classes modestes pouvait trouver dans les années 1960 dans son environnement.
Quelques pages, dans un style quasi romanesque, décrivent ainsi les copains d’infortune, détruits dès l’enfance par des conditions familiales et sociétales. Les origines marquées par la déliaison, la discontinuité, l’abandon et/ou diverses violences, ou encore les conflits culturels, ont aveuglément entraîné ces enfants ou préados dans des bandes et des passages à l’acte plus ou moins délictuels.
Ceux-là n’eurent pas, comme lui, la chance d’avoir une famille aimante, certes nombreuse, mais qui, unie, croyait en lui. « La loterie. Et les Monopoly familiaux dans une petite cité tranquille » (titre du chapitre 4), telle est la situation. « José Luis Borges, le poète aveugle de Buenos Aires, qui aimait les voyous, les couteaux, et les tigres […] affirmait qu’« un être n’existe que s’il est rêvé », écrit l’auteur (p. 50) ; sans doute ne doit-il lui-même sa trajectoire de vie, outre ses qualités intellectuelles, d’avoir eu une famille ayant rêvé pour lui le meilleur avenir possible.
« Ce qui s’avère édifiant avec le temps, c’est, relève Corcos, retournant dans cette cité [de son enfance], de voir et revoir, malgré ces rencontres inespérées avec des adultes concernés et qui font face, l’agrippement de bon nombre d’« adolescents difficiles » à la religion d’un fatal malheur qui installe une continuité dans une communauté de détresse entre générations, avec pour seule défense contre l’adversité le recours au… le secours du… repli incestueux dans sa famille, sa classe économique, sa culture, sa religion, sa bande-tribu-communauté où évidemment mijotaient avant de bouillir les idées victimaires qui allaient « sacrément » rendre fou certains. Contre la religion du fatal malheur, le repli dans la religion de la nouvelle espérance […] » (p. 98).
À l’instar d’Albert Camus (1994) ayant la chance d’avoir rencontré son instituteur Monsieur Louis Germain, Maurice Corcos rend ainsi hommage à son professeur de français de sixième, Monsieur Lardreau (p. 24), qui lui permit une de ses « rencontres identificatoires », celle-là même qu’il offre à chaque patient dans son métier de psychiatre, y compris dans le dispositif ETAPE, dont les équipes de psychiatres, infirmiers et éducateurs ont réinventé le walking-cure, permettant de rencontrer hors les murs de l’institution soignante, de Bastille, Stalingrad jusque vers Saint-Denis des adolescents et jeunes adultes désaffiliés, SDF ou toxicomanes (p. 27-35).
- Concernant la violence, Corcos, gardant la position d’humanisme propre à la médecine et à la psychanalyse, qui ne confondent pas pour autant « compréhension » d’un fait clinique et sa possible répréhension pénale, avance cette réflexion qui suit, profondément psychanalytique, allant à l’encontre du jugement commun, à l’instar de celui qui, basé sur les sens, nous ferait croire que la terre est plate.
- En effet, pour lui, si ces adolescents « réagissent fût-ce par la violence, l’espoir est permis, le jour où ils considéreront leur état présent comme définitif; le rythme des autres n’existant plus, car seul comptera le rythme de leur rage interne ; le jour où ils ne rebondiront plus après deux ou trois mouvements régressifs (l’élasticité de leur jeunesse définitivement perdue) et qu’ils n’attendront plus, définitivement résignés, qu’un changement puisse advenir du fait de la volonté des adultes, tout sera à craindre pour eux et pour nous. Car l’indifférence succédera à la résignation et au désespoir et qu’elle affrontera alors celle des adultes. Indifférence contre indifférence… immobilité contre immobilité. Comme un neurone mais sans miroir » (p. 99), relevant alors avec Winnicott (p. 139) qu’à la racine de la tendance antisociale, il y a toujours une déprivation…
- Suivent alors des pages émouvantes de réalisme sur les trajectoires malheureuses, violentes et définitivement abîmées, de camarades d’enfance de cité près des Buttes Chaumont, du C.E.S Édouard Pailleron, Hervé ou Helno, « figure incarnée de Francis Bacon », devenu chanteur du groupe les Négresses vertes (p. 107), « narrateur » de « son passé recomposé » (p. 112). Devenu interne en médecine, l’auteur fit même à cette époque un massage cardiaque et bouche-à-bouche à l’ami du chanteur pour tenter de le sauver d’une overdose… (p. 107). Au fil de ces évocations, des images de film hantent les souvenirs : Luke la main froide, avec Paul Newman, Affreux, sales et méchants, d’Ettore Scola (p. 101), des musiques – celles du rap ou de Kurt Cobain (p. 119) –, ou des auteurs comme Jean Genet (p. 121), Pier-Paolo Pasolini (p. 120), Auguste Aichorn (p. 365).
On comprend, à entendre la clinique adolescente à laquelle fait face quotidiennement Corcos, comme à ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, que la peur (de la violence, de l’indifférence) est un affect contre-transférentiel qu’il s’oblige à ressentir et avec lequel il travaille : « Et je le sens en moi… à cette obligation interne de ne plus pouvoir leur accorder qu’un coup d’œil craintif. Et pourtant je sais que si je n’avais pas peur, mais vraiment pas… de telle manière que cette peur ne les excite pas, et que si je trouvais un mode de contact, fait de surprise et d’ironie (sur eux et sur moi, pour témoigner que l’on est du même bord) et aussi une grande fermeté dans la nécessaire confrontation – à la limite de l’affrontement, alors je pourrais éroder quelque peu leur impossibilité à accepter une passivation, leur peur-envie panique d’être pénétrés et contaminés par et de l’apport de l’autre : il va m’avoir, me baiser, m’enculer, crie leur insécurité interne, à l’intérieur d’eux-mêmes. » « C’est peut-être pourquoi entre autres j’écris cet essai… pour avoir avec eux absents un lieu au présent, sur la page, au travers duquel je peux surmonter cette peur et tenter de la penser et la dire », ajoute-t-il dans une note de bas de page (p. 124).
Bien sûr la peur, qui traverse le patient autant que le thérapeute, est un affect-limite devant le gouffre d’une passivité confondue à une passivation (Green, 1999) effrayante, léthale, débouchant sur un puits sans fond qu’est un vide sidéral, sans désir, sans entrain, sans objet… « La peur de l’autre est la peur de ‟moi-même” projeté sur l’autre. La violence de l’autre m’est toujours inconnue avant qu’elle ne s’exerce sur moi, et qui plus est quand c’est le cas, elle me fige ‟corps et âme” et bloque ma pensée. Ce n’est donc pas elle qui me terrorise, c’est la violence dont je me sens (dont je suis) capable, étrangement inquiétante dans sa familiarité même, projetée sur l’autre… celle que je connais le mieux, avec qui depuis si longtemps je cohabite et que pourtant je ne cesse de dénier… et que l’autre révèle à moi-même » (p. 145).
Rendons grâce à Corcos, parlant de ces adolescents qu’il soigne depuis plus de trente ans, d’accepter de livrer la chose capitale, celle de parler de son enfance et adolescence, comme d’évoquer ses affects contre-transférentiels. La geste est profondément freudienne. Rappelons en effet ce qu’écrivait Freud le 5 juin 1910, à son ami le pasteur Pfister, dévoilant le travail à la Bernard Palissy qu’est celui de tout analyste : « La discrétion est incompatible avec un bon exposé d’analyse, il faut être sans scrupule, s’exposer, se livrer en pâture, se trahir, se conduire comme un artiste qui achète des couleurs avec l’argent du ménage, et brûle les meubles pour chauffer le modèle. Sans quelques-unes de ces actions criminelles, on ne peut rien accomplir correctement » (Freud, 1966, p. 74).
« Inadaptés parce qu’inadoptés » (p. 153)
Le sujet de la désaffiliation dans ses liens à la délinquance, voire la violence, en particulier chez les enfants et adolescents de la deuxième et troisième génération d’immigrés, trouve chez Corcos un point de vue original, celui selon lequel les agirs de rupture seraient des barrages contre la résurgence de l’archaïque au sein de filiation traumatique. « Les passages à l’acte auto ou hétéro agressifs dans lesquels ces adolescents succombent sont moins liés à une hypothétique pulsion de mort qu’ils ne renvoient à l’expulsion d’une pulsion de vie qui ne leur sourit plus… de ne pas sourire aux autres. Ne leur dit plus rien de bon en tant qu’elle est frelatée par la transmission des blessures parentales, et l’amertume de leur frustration dans un certain exil… fût-il intérieur » (p. 156).
Ces blessures se logent au sein de ce que Jean Guyotat (1980) a appelé « la filiation narcissique » que le sujet cherchera à reconstituer au sein d’un repli communautariste, d’une revendication identitaire, voire une dérive sectaire (p.155 ; p. 162). Corcos souligne que cette quête identitaire n’est pas sans lien avec les défaillances symboliques, affectives, présentielles des pères de la plupart de ces adolescents violents ou délinquantes (p. 166 sq). Cette carence de « loi » paternelle pour se séparer de la mère se paie cher (Abdelslam Dachmi, 1998), d’autant que l’imago maternelle est bien souvent celle d’une « mère morte », déprimée et, elle aussi, déclassée.
Le passage à l’acte délictuel et/ou violent se veut ainsi fuir une « terreur agonique », un « vide interne » (Corcos, p. 235, p. 245), une terreur anomique d’exister et… de s’affilier socialement pour, en particulier chez le garçon, se séparer de la mère. Cette séparation est la loi de l’espèce humaine. Les juifs l’appellent Ligature – l’Aqedah – et la célèbrent de génération en génération. Abraham ligota son fils Isaac (Genèse XXII, 9). Énigme de la fête juive de la Ligature, célébration de l’abolition du meurtre, qui montre le père dans sa fonction d’humanisation liant et déliant le fils au prix d’avoir renoncé à lui-même (Pirlot, 2001, p. 15). Or, comme l’écrit Pierre Legendre (1996, p. 43), « si l’homme ultramoderne prétend, sans risquer la Raison de l’espèce humaine, abolir la ligature des fils, cela veut dire que nous sommes entrés dans l’ère de la banalisation du meurtre[1]. »
De la « biolence » à la violence ?
Car la ligature transmue la pulsion de mort et sa déliaison (à l’objet) en pulsion de vie, synonyme de liaison (à l’objet). Aussi, lorsque Corcos se pose la question de savoir si, dans la violence – ici adolescente – il est question de pulsion de mort ou de pulsion de vie qui déborde (Corcos, p. 290 sq[2]), peut-être faut-il rappeler que, dans son étymologie même, le mot violence recouvre celui de « vie », comme Jean Bergeret l’a remarqué. Au « vis » latin correspond l’« is » homérique (is) qui signifie force, vigueur et se rattache à « Bia », qui veut dire la force vitale, la force du corps, la vigueur et, en conséquence, l’emploi de la force, la violence. Or Bia a la même racine que « Bios », la vie (substantif qui signifie aussi « la tension de l’arc ») mot qui a donné les qualificatifs de nombre de sciences de la vie : bio-logie, bio-physique, etc. Les termes de « bia-via-vita » expriment ainsi un désir, une volonté (les deux confondus) de vie, ce qui amène Bergeret à considérer la violence comme une force de vie, un instinct de survie et d’autoconservation. En ce sens la violence peut être pensée comme racine et destin possible (mais non nécessaire) des pulsions puisque, par définition, la pulsion est une force pouvant se déchaîner avec violence quand précisément elle a perdu son caractère de « constance » que permet le lien à l’objet.
Cela posé, je poserai à Corcos la question de savoir si, dans la défense de la vie et de son narcissisme, une forme de violence n’est pas nécessaire, que j’appellerai « biolence », source jaillissante inhérente à toute affirmation de soi nécessaire lors de la rencontre avec l’autre ? Sculptée dans le respect du narcissisme du sujet et de son lien (la ligature) à l’objet, à Éros, cette « biolence », une fois advenue la puberté, et avec elle la tension de la pulsion sexuelle, ne pourrait-elle pas alors fournir une agressivité de bon aloi (celle de performer, de sublimer… – jusqu’à écrire un livre… sur la violence ?) ? À l’inverse, toute faillite de l’introjection des interdits, toute absence identificatoire ou tout conflit de filiation ne pourraient-ils pas, une fois advenue la pulsion génitale sexuelle, alimenter une violence en accentuant ce dont elle est l’effet : l’absence d’organisation, de loi (anomie), de règle, de limite ? Ne l’accentuerait-elle pas pour mieux les trouver ? En ce sens l’adolescent violent cherche la limite, celle d’une fonction paternelle aimante parce que contenante, incarnant la loi : « Cherche père violemment », pourrait être l’affirmation secrète de tout adolescent délinquant que rencontre, soigne, panse/pense Maurice Corcos. « Nous voulons donc penser (asymptotiquement) que, pour autant, le sujet reste dans sa quête violente d’un désir d’être su…, perçu, reconnu, et interprété, y compris par et dans son engagement corporel et ses passages à l’acte » (Corcos, p. 240).
Dans le style, l’émotion
Cet ouvrage, autant qu’un ouvrage de spécialiste, est celui d’un humaniste n’ayant jamais oublié les « Fleurs du mal » de son enfance et de son adolescence, celles qui devinrent visiblement l’étoffe même de son choix professionnel. Le style d’écriture employé dans ces pages colle aux berges craquelées, chaotiques et rugueuses des blessures d’enfance de ceux qu’il écoute et qui se présentent comme des entailles sur la peau des pensées du psychanalyste, qui est aussi, ici, un auteur. Cela peut parfois rendre la lecture du texte ardue… mais la vie, en particulier de ces adolescents, ne l’est-elle pas elle-même ?
Alors, écoutons les cas « ados difficiles » dans cette prose singulière et ce style particulier rythmant, pour mieux les susciter et les halluciner, leurs émotions ou affects et ceux de l’auteur.
« La tradition veut qu’‟au début était le verbe” : je dis non ! », écrit Louis-Ferdinand Céline (1959, p. 96) qui poursuit : « ‟au début était l’émotion” ! L’amibe qu’on effleure, ne parle pas, elle se rétracte, elle est émue », écrit-il. Pensant à Céline – qu’il cite d’ailleurs dans ses dernières pages – et à André Green – fréquemment évoqué également –, voilà ce que me semble avoir cherché à rendre Maurice Corcos dans cet ouvrage : l’affect sous les concepts.
Références bibliographiques
Bergeret J. (1994), La violence et la vie. Paris, Payot & Rivages.
Camus A. (1994), Le premier homme. Paris, Gallimard.
Céline L.-F. (2013), Lettres à Henri Mondor. Paris, Gallimard
Dachmi A. (1998), L’affaiblissement de l’autorité paternelle ou les méfaits de l’acculturation, Inf Psychiatr 7 : 672-678.
Forrester V. (1996), L’horreur économique. Paris, Fayard.
Freud S. (1966), Freud S.-Pfister. Correspondance 1909-1930. Paris, Gallimard.
Green A. (1999/2012). Passivité, passivation : jouissance et détresse. La clinique psychanalytique contemporaine : 141-155. Paris, Ithaque.
Guyotat J. (1980), Mort/naissance et filiation. Paris, Masson.
Legendre P. (1996). La fabrique de l’homme occidental. Paris, Mille et une Nuits.
- Péguy C. (1934/2019). Pensées. Paris, Gallimard.
Pirlot G. (2001). Violences et souffrances à l’adolescence. Paris, L’Harmattan.
- Winnicott D.W. (1984/1994). Déprivation et délinquance. Paris, Payot.
[1] Legendre P. (1996). La fabrique de l’homme occidental. Paris, Mille et une nuit.
[2] Ou encore « La pulsion de mort n’existe pas « en elle-même ». C’est la pulsion de vie, l’excitation, l’élan vital, le désir qui, lorsqu’il ne trouve pas ou plus) à se ‟satisfaire” que dans la décharge ou une expulsion au-dehors […] » (Corcos, p. 297).