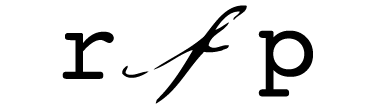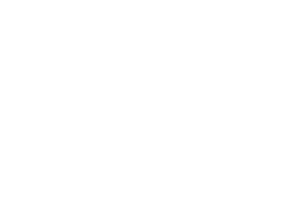PIERRE DUBOR Dissociation de l’économique et du sens chez le psychotique : utilisation du réel dans l’agir
Rfp, 35(5-6), 1971, Extrait p. 1072-1075
[…]Ce temps de l’interprétation dans l’agir devra constituer une partie importante du traitement du psychotique. Il devra en particulier être utilisé sous toutes les formes possibles tant que la relation d’objet n’aura pas permis l’utilisation d’un langage véritable (sens perçu comme non dissocié par rapport à la dimension corporelle éprouvée de la pulsion). Sur le plan pratique, disons que c’est lorsque l’on sentira s’installer chez lui une meilleure congruence des expressions parlées par rapport à ce qu’il nous donne à sentir au niveau des agirs, que l’on pourra progressivement, toujours en suivant son mouvement centrifuge vers l’objet et jamais en le précédant par un sens imposé, l’aider à mettre en place les formes verbales correspondantes aux éprouvés qu’il perçoit.
Cet aspect met en évidence chez le psychotique, du fait même de la prépondérance des agirs, le problème toujours troublant pour l’analyste du passage progressif d’une psychothérapie par les actes, que j’appellerai temps économique, à visée essentiellement structurale (!’éprouvé du réel étant offert comme pôle de structuration pour le Moi), à la phase proprement verbale signifiante du traitement.
Il s’agit en effet à ce stade d’aider à la structuration du Moi bien avant que d’en dégager un sens.
Je m’empresse d’ajouter qu’il est toujours arbitraire de séparer les temps comme je le fais : chez les sujets à Moi constitué (les névroses), la cure peut s’installer d’emblée dans le registre parlé que nous connaissons. Dans ce cas, la valeur économique et la valeur signifiante sont liées dans les fantasmes et dans les mots, comme cela a été précisé précédemment.
Chez le psychotique, la reconstruction progressive d’un commerce objectal valable et la possibilité d’une introjection réussie, économiquement bénéficiaire, structurante pour le Moi, lui permettront d’accéder à travers la bipolarité retrouvée à l’instauration progressive d’une fonction de parole adéquate. Le rôle majeur du thérapeute sera de suivre le déroulement génétique normal dans lequel la mère apporte dans un premier temps l’objet pulsionnel en tant qu’objet fonctionnel (économique) et secondairement seulement révélateur de sens : c’est par l’intégration dans sa réalité corporelle ubiquitaire que l’on pourra, chez le psychotique, atteindre l’introjection, le sens et la parole.
C’est là un temps essentiellement économique dont le côté bénéficiaire entraîne l’intérêt de l’enfant dans la direction normale de l’objet, c’est-àdire qu’il introduira du même coup la perception d’un certain sens. L’enfant tout d’abord attiré par son plaisir s’intéresse alors à l’objet… investi avant d’être perçu (et non pas l’inverse).
C’est le même processus qui a lieu dans l’agir à valeur interprétative non verbal, progressivement signifiant, que nous avons expérimenté (ou que nous avons seulement emprunté à différents auteurs).
Je pense en particulier à trois exemples cités par Racamier : à la présentation réelle de l’enfant dans les psychoses du postpartum, ou bien, à la remarque selon laquelle il ne faut pas s’adresser directement à un psychotique (ce qui le met en situation de langage forcé), mais il est souvent préférable de lui permettre d’adhérer à une conversation qu’ont deux thérapeutes à son sujet : « Il veut ceci… il craint cela… il désire telle chose, etc. » ; il est bien évident que, dans ce cas, le patient n’a pas à se fixer en relation intersubjective, qu’il ne peut assumer.
Il peut par identification à ce que les autres évoquent faire siens les éléments de leur conversation par « imprégnation ». Il n’a donc pas à être lui-même en situation d’écoute et de parole assumée comme telle (c’est-à-dire finalement dans la relation bipolaire que cette attitude de la part du thérapeute entraînerait pour lui).
Dans le même esprit, Racamier avait également remarqué l’intérêt de parler à la troisième personne, un peu comme lorsqu’on dit familièrement à quelqu’un : « Qu’est-ce qu’il devient, ou bien, il n’aime pas cela », l’utilisation de la troisième personne évitant le caractère forcément dialogué lié à l’emploi de la deuxième personne.
Cette « pénétration par l’ambiance » n’est pas sans nous évoquer, comme mode de fonctionnement agi, l’injection par la culture régnante de certaines données sociales qui sont ainsi transmises avec un indice de pénétration maximum plus par voie culturelle que par profération (culture au sens d’imprégnation diffuse non verbalisée dans une phrase).
C’est également dans le désir d’éviter au patient le travail du sens en premier qu’il m’est arrivé souvent d’exprimer avec une certaine énergie de départ les idées ou les sentiments qui sont ainsi beaucoup plus joués qu’à vrai dire parlés. Il est tout à fait notable de constater combien de tels modes d’expression joués passent mieux que si on s’était contenté de parler. N’est-ce pas en grande partie pour cela que le psychodrame permet de recevoir et de faire passer chez le psychotique, cela est bien connu, les éléments significatifs dont il a tant besoin ? Le tout est de donner au patient en premier l’éprouvé corporel qui peut seul l’affecter à ce stade et non pas de faire l’inverse comme chez l’individu normal, c’est-à-dire exprimer les choses sous le mode symbolique en premier.
Il est bien évident (et c’est là je crois l’extrême résumé de ses applications thérapeutiques) que, chez le psychotique et d’une manière générale dans toutes les structures préobjectales ou même dans certains modes de fonctionnement temporairement et accessoirement préobjectaux, l’économique et l’éprouvé qui le connote doivent jouer en premier, ouvrant pour ainsi dire la voie vers le signifiant, constitué au niveau symbolique dans un dernier temps seulement. Il s’agit en fait d’une simple « reprise de l’évolution génétique normale où le sens suit l’éprouvé, mais où peu à peu le développement de la/ onction imaginaire et symbolique et la grande maniabilité de cette dernière amènent finalement l’individu à fonctionner pour une grande part sur ce mode secondairement privilégié de mentalisation, secondaire au sens d’une intégration à un deuxième degré, mais premier sur le plan du fonctionnement intellectuel et de l’aptitude à communiquer (et premier aussi quant aux quantités d’énergie utilisées pour le fonctionnement sur le mode symbolique).
Extrait p. 1078-1081
[…]
Ceci peut encore s’exprimer de manière différente : chez le psychotique, il est classique de dire que les interprétations de contenant faisant appel à la fonction du Moi en tant qu’organisation positivement reconnue sont préférables aux interprétations de contenu. Celles-ci obligent le psychotique à découvrir son manque et mettent l’accent sur une insuffisance qu’il ne peut vivre sans danger réel à ce stade où tout manque est déstructurant (manque d’être et non manque d’avoir). Cette forme de verbalisation au niveau du contenant et non du contenu nous amène à utiliser d’une façon habituelle chez ces patients un langage qui ne soit pas seulement une articulation symbolique, sans y apporter en plus les connotations affectives qu’il implique avec l’accentuation tonique ou gestuelle de départ dont nous avons parlé. Dans ce cas, l’accentuation directement perçue en dehors de la syntaxe verbale représente en fait un potentiel affectif à valeur économique éprouvé comme réel que nous apportons au patient. Il en sera d’ailleurs de même toutes les fois qu’il nous arrivera de communiquer au patient nos affects en clair, contrairement à ce qui se fait généralement dans l’analyse des névroses. Tout se passe comme si le thérapeute mettait alors à la disposition du patient sa propre capacité affective et d’insight. Toujours dans le même ordre d’idée, je voudrais souligner l’importance du maniement réel de l’argent dont un aspect majeur est certainement constitué par le côté porteur d’énergie (l’argent est perçu comme vecteur énergétique réel) qui permet de le situer à l’extrême opposé du mot qui, lui, s’avère d’abord symbole signifiant et secondairement évocateur du signifié (partie économique). À l’inverse du mot, l’argent évocateur d’emblée de puissance est secondairement, je crois, symbole de puissance. Aussi, nous ne serons pas étonnés si le maniement réel de l’argent expose fréquemment le psychotique à des passages à l’acte divers (oubli de payer, erreurs de ses comptes, façon personnelle de payer, etc.), toutes ces manifestations s’avèrent pleines de sens que l’expérience nous a révélé difficile à manier comme contenu d’interprétation. Notre préférence est allée bien souvent comme pour les autres agirs sur l’interprétation des contenus du genre : « Vous avez besoin de me dire cela dans un oubli », ou bien et d’une manière encore plus percutante et agie de notre part vis-à-vis d’un patient qui réglait sa séance en petites coupures depuis plusieurs fois : « Voilà une curieuse façon de le faire… » L’allusion ne touche ici que le contenu dans ce que l’on pourrait considérer comme un appel au Moi (et par conséquent doué d’un effet de structuration).
Je ne passerai pas non plus sous silence deux agirs majeurs de l’institution psychiatrique : I’agir dans le travail et l’agir dans la passivité. Je me contenterai de souligner sur ce plan combien dans certains cas le fait de décider l’hospitalisation d’un malade sur le plan réel et non pas simplement se contenter de lui conseiller le repos par des mots s’avère infiniment plus efficace que la verbalisation de la même idée.
L’exemple nous a encore été apporté récemment d’un patient, névrose de caractère grave, en pleine décompensation, chez qui tous les conseils de repos s’avèrent inefficaces mais chez qui la décision réelle d’hospitalisation (ou jouée en tant que telle) a entraîné la sédation quasi immédiate des manifestations dépressives. Ce court exemple apporte une preuve de plus à l’actif de notre hypothèse selon laquelle l’expression par le réel s’avère dans bien des cas, et tout particulièrement dans les structures préobjectales, d’une utilisation précieuse.
Dans la même lignée serait à traiter le problème de l’ergothérapie sous tous ses aspects. Disons seulement que la même visée théorique peut s’y appliquer parfaitement, mais l’importance du sujet nous amène à réserver, pour un autre travail, l’abord de ce délicat problème (créativité, agirs artistiques, régression agie dans la passivité, etc.).
Je ne ferai encore que citer l’agir que constituent les phénomènes décrits sous le terme de mixité dans le milieu institutionnel, agir qui consiste à faire vivre d’une manière permanente ou fractionnée des patients des deux sexes ensemble, soit dans la cohabitation, soit dans des lieux de rencontre (travail, distractions, etc.). L’intérêt de ces passages à l’acte thérapeutique consiste essentiellement à introduire par le réel la dimension sexuelle et hétéro-sexuelle chez le patient. Là encore, l’important ne sera pas le passage à l’acte en tant que tel, mais bien, dans un deuxième temps, la prise de conscience qu’il pourra introduire et les conflits qu’il pourra révéler dans la verbalisation.
Dans un ordre d’idée voisin, je citerai également l’introduction de certaines substances hormonales introduites, soit dans un but thérapeutique, soit dans un but contraceptif ; dans un cas comme dans l’autre, il nous est apparu que cette intervention injectait certains stimuli par la pharmacodynamie dans le vécu avec naturellement toutes les conséquences (angoisses, rechutes, délires) que cela pouvait impliquer, par la mobilisation de défense que la poussée instinctuelle renforçait. Je voudrais terminer cette revue des traitements institutionnels ou multipolaires du psychotique par les agirs en m’arrêtant quelque peu mais très insuffisamment sur le problème de la contrainte en psychiatrie où les manifestations de l’agressivité sont exprimées comme on le voit très souvent sur le mode agi (tant par les malades que par les équipes soignantes). Il arrive en effet couramment que dans l’impossibilité d’assumer une position quelconque (et à plus forte raison une opposition), le psychotique soit amené à agir, soit sur le mode délirant, soit sur le mode plus classique du passage à l’acte, ses contenus agressifs.
Il nous est apparu comme éminemment souhaitable dans ce cas de ne pas essayer de convaincre ou d’apaiser ce qui est toujours une façon d’interdire l’agressivité, mais d’y répondre en tant que tel, soit par un agi verbal, s’explicitant par une tonalité significative ou par toute autre manifestation verbale à valeur exclamative, soit même dans certains cas d’employer la contrainte exprimée clairement comme telle ayant alors valeur d’agir expressif d’agressivité.
Dans les deux cas, l’agir verbal comme l’agir moteur apportent au patient dans l’immanence d’un éprouvé manifestement réifié (et donc perceptible et introjectable) tout le contenu affectif ainsi dramatisé. Cela nous permet de lui donner acte de son agressivité (reçue et nommée comme telle) et comme telle restituée de notre part sous la forme d’une intervention structurante, mais également porteuse de sens, transmise par notre propre agi.
Je suis pour ma part persuadé que l’utilisation de la parole dans une telle circonstance aurait vis-à-vis de la pulsion agressive une inefficacité structurale et signifiante certaine. Elle présenterait du même coup une valeur coercitive quant à la pulsion infiniment plus grande. Cette constatation nous amène à poser ici, sans prétendre le résoudre, le problème des homes d’antipsychiatrie où l’élément agressif paraît systématiquement délaissé ; il serait intéressant d’en préciser la valeur et les indications en tenant compte de nos remarques…
L’agir agressif en écho représente de la part du thérapeute une véritable interprétation qui est apportée au patient dans son langage, à sa manière et à son niveau.
Le maniement institutionnel de cette variété d’agir s’avère cependant fort délicat, toute agressivité réelle de la part du milieu thérapeutique (voire contre-transfert mal assumé) risque toujours d’apporter au patient une donnée interdictrice et une rupture du dialogue. Par contre l’utilisation du réel comme structure introjectable et comme organisation de sens nous a permis de réaliser par cette technique un niveau de prise de conscience de la pulsion bien meilleur, chez certains Moi psychotiques, dont l’agressivité éternellement projetée et jamais venue au sens empêchait par son intensité destructrice tout contact thérapeutique par trop angoissant.
Nous dirons pour conclure, ce qui n’est en fait qu’un temps de réflexion et de recherche psychanalytique sur une certaine pratique psychothérapique, que la manipulation agie du réel apparaît comme une façon de penser et de parler maturante, adaptée à certaines structures (surtout préobjectales) ou à certains moments de la cure dans d’autres cas (qui sortent du cadre que nous nous sommes fixé ici…), la caractéristique essentiellement mise en actes de nos interprétations (qui sont la plupart du temps des interventions) permet d’envisager une efficacité thérapeutique accrue, perspective qu’il conviendrait certainement de préciser par ailleurs.