
Entretien avec Rachel Rosenblum
RFP : Rachel Rosenblum, vous avez publié, il y a près de 20 ans dans la Revue française de psychanalyse, un article qui a fait date : « Peut-on mourir de dire ? Sarah Kofman, Primo Levi ». Vous publiez aujourd’hui un livre intitulé Mourir d’écrire ? Shoah, traumas extrêmes et psychanalyse des survivants (Paris, Puf, « Le fil rouge »).
Pourriez-vous nous éclairer sur ces titres ?
Contrairement à l’opinion courante – parler soulage – le dire ou l’écrire pourrait-il être mortifère ?
Rachel Rosenblum : Il semble paradoxal de dénoncer le « dire » ou « l’écrire » comme potentiellement mortifères, et ce, non seulement vis-à-vis du sens commun puisque l’on sait que « parler soulage », mais surtout vis-à-vis de la psychanalyse dont les effets sont ceux d’une « talking cure ». Pourtant, mon livre n’est en rien une mise en cause de la psychanalyse. Je le vois plutôt comme une réflexion sur la capacité de la psychanalyse à répondre aux défis que représentent certaines pathologies nouvelles et extrêmes. Les questions que je pose sont alors celles qu’ont abordées très longtemps avant moi Ferenczi, Dori Laub et, en France, Claude Janin, Simone Korff Sausse, et aussi Michèle Bertrand dont l’un des livres recense les défis à la psychanalyse.
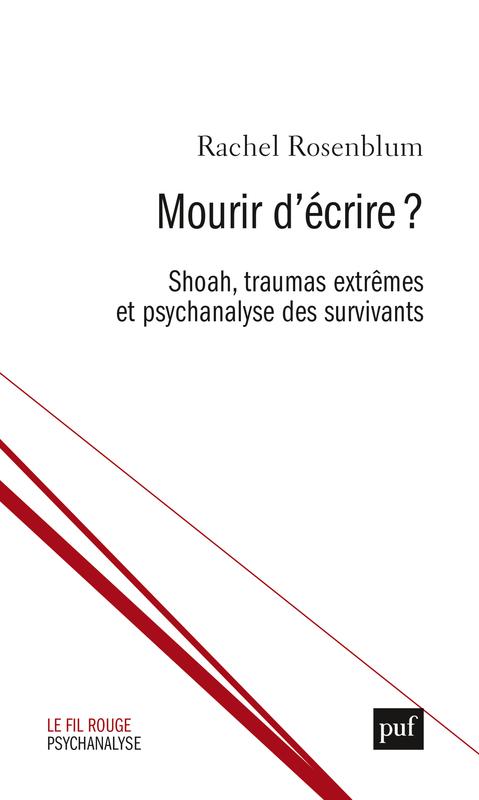
En fait, la possibilité de « Mourir de dire » semble bien moins paradoxale si l’on pense au silence obstiné qu’observent pendant des décennies, voire, parfois, tout le long de leur vie, nombre de survivants de retour des camps. Les exemples d’un tel silence sont innombrables. Je n’en citerai qu’un : celui du grand-père mutique auquel le romancier Santiago Amigorena vient de consacrer son dernier livre (Le ghetto intérieur). Ce silence tenace, prolongé, a souvent été interprété comme une réponse au désintérêt manifesté par leur entourage au récit des survivants, ou encore par le désir qu’ont ceux-ci de protéger leurs enfants de l’évocation insupportable d’événements horribles.
Il existe cependant une troisième explication. Ceux qui observent un tel silence ne tenteraient pas seulement de protéger leurs enfants. Ils se protégeraient aussi eux-mêmes. Dans une perception sourde du danger qu’il y aurait à parler, ils sentent en effet que revenir sur certains événements reviendrait à déclencher des processus incontrôlables.
Que le fait de dire ou le fait d’écrire puissent se révéler mortifères quand ils portent sur des traumatismes extrêmes est une question qui s’est imposée à moi au moment du suicide de Sarah Kofman, un suicide qui avait suivi de près la publication de son livre autobiographique : Rue Ordener, Rue Labat. Pour la première fois, Sarah Kofman exposait en public des hontes de son enfance écartelée entre sa mère biologique qu’elle avait rejetée et la mère adoptive qu’elle avait aimée. Mais en fait, je n’étais pas la première à établir un lien entre la décision de « dire » et le choix de la mort. Pensons ainsi au titre sans nuances que Jorge Semprun a donné à l’un de ses livres : L’écriture ou la vie.
Cela dit, je sais très bien que le fait de dire ou d’écrire ne sont pas mortifères pour tous les survivants. Je sais très bien qu’il existe de nombreux exemples où l’un ou l’autre se révèlent salvateurs. Je me démarque ainsi de tous ceux qu’une lecture superficielle de mes essais a amenés à m’intenter un procès pour généralisation abusive ; mais également de ceux qui ont emprunté ou repris mon titre. En fait, j’ai toujours assorti mes propos d’une interrogation sur la causalité qu’ils semblent impliquer. Mon premier article ne s’intitule pas « Mourir de dire », mais « Peut-on mourir de dire ? ». Et ce livre lui-même ne s’intitule pas « Mourir d’écrire » mais « Mourir d’écrire ? ». Le point d’interrogation est essentiel. Le lien que je suggère entre certaines formes d’expression et le passage à l’acte suicidaire n’a rien d‘automatique ni de mécanique. Il relève non pas d’une affirmation mais d’une question.
De quelle sorte de lien s’agit-il alors quand il a lieu ? Et que faire pour l’éviter ? C’est précisément ce que ce livre tente d’explorer en suivant les nombreux jalons posés par des analystes comme Sidney Stewart, André Green, Claude Janin, Dori Laub, en remontant en fait jusqu’à l’œuvre pionnière de Sandor Ferenczi.
RFP : Quel sens donner à l’écart entre dire et écrire ?
RR : La distinction entre « dire » et « écrire » correspond d’abord aux deux façons dont j’ai pu avoir accès au matériel présenté. Certaines situations m’ont été rendues disponibles par des témoignages écrits. D’autres me sont parvenues sur le divan ou par des récits d’échanges oraux (entretiens ou cures).
Mais, au-delà de ce qui les distingue, le dire comme l’écrire présentent une dimension commune. L’un et l’autre font intervenir une dimension de « mise-en public », et se révèlent ainsi capables de réveiller la honte et la culpabilité. En outre, raconter le traumatisme, c’est prendre conscience soi-même, et parfois pour la première fois, de toute son étendue. Cette première fois, qui n’en est pas une, agit alors comme une bombe à retardement. Parler du traumatisme, c’est mettre en branle un processus de « subjectivation » qui peut amener le traumatisme à se réaliser jusqu’au bout.
Il faut néanmoins distinguer le « dire » de l’« écrire ». Dans un cas – celui de l’« écrire » – le sujet s’adresse à un public général, indifférencié, un public qu’il ne peut connaître que par la façon dont il l’imagine ; par les fantasmes de rejet qu’il peut nourrir à son propos et dont la réponse peut se révéler effectivement négative. (C’était –a-t-on dit – le cas pour Sarah Kofman lorsqu’elle a publié son autobiographie).
Dans l’autre cas, celui du « dire », le sujet s’adresse à un interlocuteur identifié, un interlocuteur dont les réactions et les réponses effectives peuvent orienter et, d’une certaine façon, moduler la parole. La situation analytique présente ainsi une particularité précieuse : elle permet d’agir sur le « dire ; d’en atténuer parfois les dangers.
RFP : Et la psychanalyse, justement ? La cure est-elle prise dans une répétition dangereuse, un « redoublement du trauma » ?
RR : J’ai parlé de « redoublement » ou de « répétition » du trauma en référence à ces situations extrêmes où l’intensité du traumatisme peut rendre son inscription impossible du fait de la défaillance temporaire des mécanismes d’enregistrement. Une telle défaillance peut paradoxalement amener un trauma non enregistré, ou partiellement enregistré, à se produire jusqu’au bout au cours de la thérapie. On a alors l’impression que le trauma se répète. En fait, il ne se répète pas vraiment mais, dans ces cas, il se révèle dans toute son ampleur pour la première fois. En d’autres termes, l’expérience d’un traumatisme massif peut n’avoir véritablement lieu que dans le contexte de la « thérapie » ou de quelqu’autre retour… Plutôt que d’une « répétition » du trauma, on pourrait alors parler d’un « redoublement », redoublement dont la charge est en outre multipliée par la rencontre explosive qui peut se produire entre des réalités traumatiques et des désirs inconscients.
RFP : Près de trois quarts de siècle après la découverte des camps d’extermination et la Shoah, quelles mutations, quels aménagements a opéré – ou doit opérer – la psychanalyse face à ces traumas extrêmes ?
RR : Plusieurs pistes ont été explorées. Voici quelques une de celles que j’avais décrites dans un article publié en 2010, « Shoah et Psychanalyse[1] » :
- Il s’agit parfois de reconnaître la réalité de ce qui s’est produit. Une telle reconnaissance n’est pas toujours indispensable, mais le maintien d’une méconnaissance conforte un déni de réalité néfaste. La reconnaissance ne relève en rien d’une résistance au travail analytique, mais peut se concevoir comme l’une des conditions préalables indispensables à sa mise en œuvre, comme l’ont montré également Dori Laub (1992) et Ilse Grubrich-Simitis (2010).
- Il s’agit ensuite d’être prêt à abandonner la position de neutralité analytique (mais seulement dans des situations où cet abandon semble indispensable), afin d’accompagner activement les survivants. Comme l’écrit Dori Laub (2006), un analyste doit être prêt à éprouver « la stupéfaction, la blessure, la confusion, la terreur et les conflits ressentis par la victime ». Il lui faut accepter de plonger « dans l’œil du cyclone ».
- Il s’agit enfin pour l’analyste (mais aussi de façon tout exceptionnelle) de déjouer certaines réactions thérapeutiques négatives en consentant à faire état de ses propres expériences de honte et de culpabilité, ce qu’a montré Sydney Stewart (1991). Ainsi, l’analyste peut-il se donner le droit d’exprimer son émotion, ce qui lui permet d’agir sous la forme d’un « alter ego » (Ferenczi, 1932), ou de devenir un « agent de désintoxication » (Boulanger, 2007). On peut ici penser à la « fonction Alpha » de Bion.
RFP : Qu’apprend-on de l’analyse des survivants et de leurs descendants ?
RR : J’ai évoqué les défis que tous ceux que l’on a appelés les « survivants » ont représenté pour l’analyse. Ces défis n’étaient pas du même ordre pour les « survivants » qui revenaient des camps et pour ceux qui y avaient perdu leurs parents ou leurs proches, ceux que l’on a appelés « les orphelins de la Shoah ». Les uns avaient survécu à une « Shoah des coups » et des exécutions. Les autres étaient les victimes d’une « Shoah des pertes ».
Les traumatismes des premiers nous sont bien connus, grâce à Primo Levi ou à des analystes comme Laub ou Stewart. Les souffrances des seconds, plus sourdes, plus proches des pathologies du deuil, le sont beaucoup moins. Mais, petit à petit et dès les années soixante-dix, le sort des orphelins de la Shoah est devenu une question centrale, suivie, quelques années plus tard, de la question des « Enfants cachés ». On s’est alors aperçu que reconnaître la réalité de la perte catastrophique est souvent impossible pour l’enfant survivant. « Déclarer en effet que l’objet est mort revient à le tuer » (Kijak, 1986). Il est en outre nécessaire de savoir ce que l’on a perdu pour que le travail du deuil puisse être accompli. Qu’advient-il alors quand la vie d’un individu se construit à partir d’une « absence indéterminée » ? Une telle indétermination ne condamne-telle pas le sujet à vivre ce que J.-B. Pontalis a décrit, à propos de Georges Perec, comme une « réalité pseudo-psychique » ?
Vous posez enfin la question des descendants de survivants. Souvent, ces derniers sont inconsciemment dépossédés de leur propre vie, parfois même transformés en « cierges du souvenir » (Charlotte Wardi, 1992). Ils sont littéralement « hantés ». Ce qui est alors répétitivement mis en acte, façonnant leur existence, n’est pas de l’ordre d’un souvenir refoulé, mais quelque chose qui se trouve à la fois « impossible à oublier et impossible à raconter », selon les termes de Samuel Gerson (2009).
Ainsi ce qui dans une génération demeure non inscrit, non reconnu, non accepté, non symbolisé, semble faire irruption dans la génération suivante, comme le montre le dessinateur new yorkais Art Spiegelman, lui-même enfant de survivants, dans une courte bande-dessinée.
L’histoire est celle d’un père qui invite un jour son petit garçon à admirer le magnifique cadeau qu’il lui a préparé et qui l’attend à l’intérieur d’un coffre. L’enfant ravi court vers le coffre et trépigne d’impatience pendant que son père défait, un à un, les nombreux cadenas qui maintiennent le coffre fermé. Le père soulève alors le couvercle. Un monstre effroyable jaillit du coffre, gueule béante, prêt à dévorer l’enfant. L’enfant se sauve en hurlant. Le père maîtrise le monstre, le remet dans le coffre et rabat le couvercle. « Je viens de te montrer ton cadeau, dit-il au petit garçon. Quand tu seras grand, tu le transmettras à ton tour à tes enfants » (Spiegelman 2013).
Comme ce
père le sait fort bien (et comme j’ai moi-même tenté de le montrer à propos
d’Emmanuel Carrère qui réussit à doter d’une réalité « géographique »
un deuil qu’il était impossible aux membres de sa famille d’appréhender), il
faut plus d’une génération pour élaborer les traumas massifs. Parfois malheureusement,
la tâche est impossible.
[1] Psychanalyse Internationale, revue de l’API, vol. 18, 2010.

