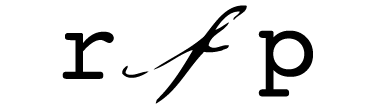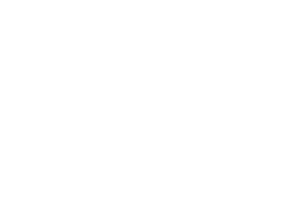Joyce McDougall au regard de la clinique analytique contemporaine
Dunod, Collection Psychismes
EAN 9782100836505 EAN Ebook : Epub 9782100842216
400 pages
Parution juin 2023
Prix : 35,00€
Gérard Pirlot est psychanalyste membre de la Société psychanalytique de Paris, professeur émérite des Universités, ancien Psychiatre des Hôpitaux.
Un an après le décès de l’analyste visionnaire qu’était Joyce McDougall, la SPP a organisé le 5 mai 2012 un colloque dont les actes ont été publiés en son hommage, sous la direction de Bernard Chervet et Paul Denis. Cet ouvrage proposait entre autres qualités une remarquable recension internationale des écrits de Joyce McDougall, complémentée par les ouvrages biographiques de référence concernant sa vie et son œuvre. Avec Joyce McDougall au regard de la clinique analytique contemporaine, paru en 2023, sous la direction de Catherine Bergeret-Amselek et Philippe Porret, les éditions Campagne Première offrent maintenant une occasion exceptionnelle d’approfondir la richesse des thématiques et l’orientation des recherches poursuivies par cette analyste. À l’instar de l’ouvrage précédemment évoqué, il fait suite à des journées d’étude qui eurent lieu les 20 et 21 novembre 2021 dans le cadre de la Société de psychanalyse freudienne, la SPF, avec le partenariat de l’Institut contemporain de l’enfance, fondé par Bernard Golse.
Joyce McDougall n’avait pas froid aux yeux et s’aventurant, avec autant de charme et de rigueur que de ténacité, hors des chemins trop bien balisés, elle s’est toujours opposée à une psychanalyse qui se présente comme doctrinaire. Tout en poursuivant son cursus à l’Institut de formation de la Société psychanalytique de Paris, elle fréquenta le séminaire de Lacan. Elle avait nombre d’amis et d’amies analystes membres de l’API, mais aussi d’autres associations : tout en étant membre titulaire formateur de la SPP, elle était notamment très proche de Piera Aulagnier. Elle soutenait le dialogue, le « dialogue analytique » non seulement avec Sammy, avec ses analysants et analysantes, avec les analystes qu’elle recevait en supervision, mais aussi notamment avec les écoles de psychosomatique, française et anglo-saxonnes, ou encore avec les hétérosexuels comme avec les mouvements gays et lesbiens.
En véritable pionnière, elle n’a cessé, depuis Plaidoyer pour une certaine anormalité (1978) jusqu’à Éros aux mille et un visages (1996), en passant par Théâtre du je (1982) et Théâtre du corps (1989), de remettre en question l’abord classique de la perversion et de dépathologiser les formes de sexualités considérées comme peu communes, voire extrêmes ; d’interroger ce qu’on nomme « normalité » ; de chercher à mettre en lumière et en paroles les angoisses archaïques et psychotiques qui sous-tendent et soutiennent de nombreuses symptomatologies somatiques, les addictions, les conduites déviantes les plus apparemment figées. Toutes ces figures de la pulsion de mort représentent, selon elle, des formes paradoxales et ultimes de survie subjective. Cela l’a conduit à proposer des entités conceptuelles sous les termes d’anti-analysants de psycho-soma, de néo-sexualités, d’hystérie archaïque, etc., et d’orienter techniquement l’acte analytique vers la possibilité de la constitution subjective de l’altérité plus que vers la castration, de l’importance du dialogue analytique que de l’interprétation, en cherchant toujours à repousser dans les cures les limites de l’inanalysable.
Dans le dernier chapitre d’Éros, qu’on peut lire comme un écrit testamentaire, Joyce McDougall s’interroge et nous interroge : les perspectives qu’elle soutient ne traduisent-elles pas l’existence d’un « nouveau paradigme » pour la psychanalyse ? Nouveau paradigme sur lequel nos questionnements très actuels et nos pratiques pourraient s’appuyer et rebondir. Quand elle a abordé ce qu’elle nomma les néo-sexualités, la problématique trans, au-delà de la transsexualité, celle de la non-binarité n’avait pas encore pris l’importance qu’elles ont de nos jours. Qu’en dirait-elle aujourd’hui ? Nous ne pouvons évidemment le savoir, mais il est certain qu’elle s’y serait intéressée et que son travail est une aide précieuse pour que nous puissions avancer analytiquement sur ces questions.
Ce rappel très succinct des thèses majeures de Joyce McDougall n’a d’intérêt que d’ouvrir la présentation de l’ouvrage qui nous retient ici et d’inviter le lecteur de ces lignes à s’y plonger. Les différents thèmes évoqués ci-dessus et d’autres encore y sont repris, interrogés, discutés.
En lien avec la grande ouverture de Joyce McDougall et la richesse des thématiques qu’elle a abordées, il est notable que les vingt-quatre contributeurs (les intervenants des journées d’étude) l’ont rencontrée à des titres parfois très divers. Beaucoup d’entre eux, analystes, ont partagé avec elle des moments analytiques essentiels, comme analysants, comme analystes en supervision ; comme biographes ou comme collègues. Tout ceci n’excluant pas, faut-il le préciser, l’amitié possiblement trouvée à terme. D’autres ont découvert ou redécouvert Joyce McDougall d’une façon plus distanciée, à la lecture attentive de ses différents livres, mais avec un bonheur et une respiration renouvelés. Si les styles des articles portent évidemment la marque de cette diversité, il se dégage sans réserve de l’ensemble la joie de rencontrer ou retrouver sous ses différentes facettes, de vie, de clinicienne, de théoricienne, une psychanalyste vivante, une femme en prise à l’avance avec les questions les plus actuelles de notre temps, engagée dans une démarche généreuse n’oubliant jamais la fragilité de la condition humaine et la nature fondamentalement traumatique du sexuel, de l’altérité et de la mort.
Cette diversité, qui rapproche les textes sans souci d’unification des discours en offrant pour autant une unité ouverte à l’ouvrage, se manifeste à d’autres niveaux. Tout d’abord les orientations psychanalytiques des contributeurs analystes sont multiples, en résonance avec le refus « mcdougallien » du dogmatisme, mais aussi probablement un effet de ce rejet. De plus, il y a présents, dans ce recueil, non seulement des analystes, mais aussi des artistes attestant remarquablement de ce qui les lie, au plus dicible et indicible d’eux-mêmes, à leur création. Si pour Joyce McDougall, passionnée d’art, tout symptôme est une forme de création pouvant avoir dimension de survie, ils nous font entendre que l’art, pour les artistes qu’ils sont, possède cette valeur-là.
Cette diversité paradoxale se fait entendre encore autrement. La pensée de Joyce McDougall est en mouvement et sans fermeture. On retrouve souvent dans un de ses livres des patients déjà rencontrés antérieurement, mais aussi l’analyste dans son propre cheminement interne et dans son maniement du transfert lors des séances. Loin de se répéter à l’identique, ces reprises lui permettent de préciser, voire de corriger, son point de vue premier, d’articuler, je dirais, scientifiquement, sa pensée clinique selon un autre axe, plus en accord avec la question qui est pour elle celle du présent dans ce qu’elle entend. Il y a des strates théorico-cliniques qui se consolident, mais il n’y a pas de mot de la fin dans son œuvre. Cela se retrouve dans les différents articles du livre. Chaque auteur témoigne à sa façon avec reconnaissance, que la parole, les textes de Joyce McDougall ont eu sur son propre questionnement. Quelque chose d’énoncé par McDougall a fait socle pour relancer une question propre à l’auteur là où chacun en est en ce début du xxie siècle. Ce n’est pas un livre hagiographique, mais un livre où les orientations, qui sont multiples, se croisent se répondent, sans toujours souscrire entièrement aux thèses « mcdougalliennes ». Elles débattent avec Elle, et entre elles, tout en laissant aussi entendre au lecteur qu’elles poursuivent chacune leur mouvement propre et qu’elles sont en travail.
La lecture de Joyce McDougall au regard de la clinique analytique contemporaine non seulement introduira à l’œuvre de Joyce McDougall, ses livres et ses articles, mais les lecteurs déjà avertis de son travail découvriront l’acuité de son actualité. Ils apprécieront l’influence de cette analyste lumineuse source d’inspiration pour les vingt-quatre contributeurs et contributrices de cet ouvrage novateur.