
Entretien avec Stephane Braunschweig
Metteur en scène et scénographe, Stéphane Braunschweig est directeur à l’Odéon- Théâtre de l’Europe où nous l’avons rencontré pour un entretien centré, entre autres, sur la place de l’inconscient dans ses mises en scène et scénographies de théâtre et d’opéra.
_____________________
Dès le lycée et en hypokhâgne, Stéphane Braunschweig – fils et petit-fils de psychanalyste – participe aux groupes de théâtre. À l’École normale supérieure, il fonde une compagnie, le Théâtre-Machine, et met en scène deux spectacles. En 1986, il rentre au premier recrutement des metteurs en scène de l’Ecole de Chaillot fondée par Antoine Vitez. À la fois directeur, metteur en scène et scénographe, il dirige successivement le Centre Dramatique National d’Orléans-Loiret-Centre, le Théâtre National de Strasbourg et son école, le Théâtre National De la Colline et maintenant l’Odéon, sans parler des « escapades » dans d’autres théâtres prestigieux pour des mises en scène théâtrales et opératiques en France et à l’étranger. Stéphane Braunschweig a mis en scène de nombreuses pièces de Kleist, Büchner, Ibsen, Tchékhov, Pirandello, mais aussi de Sophocle, Shakespeare, Racine, Molière, ainsi que des opéras (Bellini, Beethoven, Mozart, Wagner, Bartók, Janáček, Berg).
Un entretien, accessible aux archives de l’INA[1], et un portrait, tout juste paru dans la revue Théâtre(s) de l’été 2016, relatent le souvenir d’enfance devenu mythe familial selon lequel, à l’âge de 7-8 ans, Stéphane Braunschweig a dit à la sortie d’une représentation du Malade Imaginaire à la Comédie Française : « Plus tard je voudrais avoir un théâtre comme Molière ». Il dit se souvenir comme si c’était hier du tulle en avant-scène, à la place du rideau opaque, séparant la scène du spectateur. Écart avec ce qui était la règle à cette époque, le tulle entre la scène et les spectateurs, qui permettait de voir travailler la servante avant le spectacle et entre les actes, est peut-être aussi une figuration de son intérêt ultérieur pour le non-dit, les éléments non explicites d’une œuvre, à distance d’une transparence totale réductrice du sens.
Propos receuillis par : Françoise Coblence et Marcela Montes de Oca
Rfp : Vous avez baigné dans la psychanalyse, pourtant, en lisant le recueil de vos textes de programmes dans Petites portes, grands paysages[2], ainsi qu’un certain nombre de vos entretiens avec votre dramaturge Anne-Françoise Benhamou, il nous a semblé que vous prononciez rarement le mot « inconscient ». Est-ce justement parce qu’il s’agit d’une donnée fondamentale, d’une évidence pour vous ?
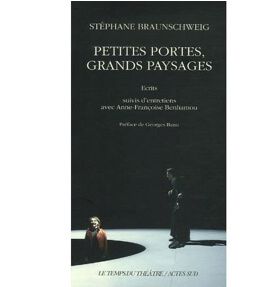
Stéphane Braunschweig : Peut-être suis-je attentif à ne pas trop utiliser de vocabulaire connoté, mais je ne m’empêche pas de parler de l’inconscient si je dois parler de l’inconscient.
Mais de quel inconscient parle-t-on ? Celui des personnages, celui de l’auteur, l’inconscient en général ? Avec les acteurs, il n’est pas toujours facile de trouver le langage commun. Au théâtre, l’usage de cette notion est compliqué parce qu’elle travaille tout le temps. Quand j’étais plus jeune, je pensais que le metteur en scène devait faire apparaitre l’inconscient sur scène. Aujourd’hui, je dirais plutôt qu’il doit surtout montrer comment le langage « recouvre », c’est-à-dire donner à voir les stratégies de défense et de refoulement. Laisser deviner, en creux, comment l’inconscient agit souterrainement sur les jeux de langage, entre ce que le texte dit et ce qu’il ne dit pas. Au fond, il s’agit d’amener les acteurs à comprendre que le langage est fait de stratégies de recouvrement – même quand il vise, comme chez Ibsen, à révéler une vérité. Mis à part Kleist, les auteurs de théâtre ne font pas tellement de lapsus. Ainsi, soit l’auteur est conscient de ce qu’il produit comme logique de l’inconscient, soit il ne l’est pas, et on cherchera tout ce que le langage ne dit pas, ce qu’il cache, ce qu’il recouvre, ce qu’il refoule.
En fait, j’ai eu une sorte de révélation, il y a longtemps déjà, quand je montais le Conte d’hiver de Shakespeare [Centre Dramatique d’Orléans, 1993]. Je n’arrivais pas du tout à faire jouer le premier acte. Dans la pièce, il y a un trio : un roi, sa femme, et son ami d’enfance qui est un autre roi, en visite chez lui. Le roi se persuade que sa femme tombe amoureuse de son ami. Celui-ci est comme un frère de lait et la dimension homosexuelle de leur relation est assez évidente. Il devient fou de jalousie parce qu’il a surpris une tendresse entre sa femme et son ami, tendresse qu’il a lui-même encouragée, de façon assez perverse. Le fait intéressant est que la reine se sent complètement innocente de cette faute mais, si on analyse ce qui se passe dans le trio, les choses ne naissent tout de même pas de rien. Quand j’essayais de mettre en scène ce qui se jouait dans le trio en montrant les ambiguïtés des uns et des autres, les ambivalences, les jeux de séduction, les jeux de perversion, ce n’était plus de théâtre, c’était une sorte d’explication et les acteurs n’avaient aucun moyen de jouer les scènes.
Je me suis dit que l’inconscient n’est pas là pour être montré mais pour sous-tendre les choses.
Rfp : Cela devenait une explication psychologique ?
SB : Oui. Et j’ai compris qu’il fallait jouer comme s’il ne se passait rien. Il fallait que les acteurs jouent « en toute innocence ». Parce qu’en fait la relation entre les deux hommes est décrite comme un paradis enfantin et cette histoire est vraiment une chute, une sortie de l’innocence. C’était donc à moi de prolonger cette sensation d’être dans l’innocence. On a alors réussi à raconter l’histoire et à la jouer. Je me suis dit que l’inconscient n’est pas là pour être montré mais pour sous-tendre les choses.
Rfp : Vous diriez que c’est là le rôle de la scénographie ?
SB : Oui, ce peut être le rôle de la scénographie. Par exemple, dans le Conte d’hiver, quand le plateau commençait à s’incliner insensiblement, à mettre les acteurs dans des positions instables sans qu’ils s’en rendent tout à fait compte. Mais on peut aussi créer une sensation de l’inconscient par d’autres moyens. Toujours dans le Conte d’hiver, il y a ce fameux monologue du roi Léontès qui commence à douter, à fantasmer sur la paternité de son fils. Je cherchais à donner de petits signes que quelque chose n’allait pas en déviant sur l’enfant l’agressivité qu’il pouvait ressentir pour sa femme. C’est comme lorsqu’on fait des crises d’angoisse et qu’on reporte, qu’on déplace l’objet
OMBRE ET LUMIERE
Rfp : Dans le texte qui ouvre Petites portes, grands paysages, vous décrivez ainsi votre travail : « Parfois j’ai l’impression de construire dans le noir d’étranges escaliers lumineux, des escaliers auxquels manquent des marches. J’indique aux spectateurs la direction à prendre, je les accompagne le plus souvent sur ce chemin, j’éclaire précisément tout ce qui peut l’être, et puis soudain je plonge leurs pieds dans l’obscurité, pour qu’ils se sentent brusquement seuls, assaillis par la part d’ombre des textes, celle qui en appelle à l’intimité et au regard singulier de chacun. » (Braunschweig, 2007, p. 23). On a l’impression qu’un analyste pourrait parler comme cela de son travail, qu’il n’est pas très éloigné de cette démarche, sans forcément bien savoir où il va. Au fond, vous maintenez toujours une sorte de dialectique entre l’ombre et la lumière. Vous voulez à la fois éclairer et laisser des zones d’ombre…
SB : Oui, éclairer les zones d’ombre, c’est-à-dire, non pas fa ire la lumière, non pas les rendre claires, mais montrer clairement où elles se trouvent. Sans forcément les résoudre.
ire la lumière, non pas les rendre claires, mais montrer clairement où elles se trouvent. Sans forcément les résoudre.
Mettre en scène, pour moi, c’est comprendre, c’est-à-dire comprendre le texte profondément, comprendre à la fois ce qui se raconte, ce qui se joue entre les personnages, ce qui se joue au niveau de l’inconscient des personnages, et ce qui se joue pour l’auteur : que signifie pour un auteur écrire ce qu’il écrit. Cette compréhension profonde est le moteur de la mise en scène, mais cela ne veut pas dire que la mise en scène doive en être l’explication. La compréhension est à la fois la condition de possibilité et le moteur de la mise en scène mais, aujourd’hui, je dirais que je ne cherche plus à faire comprendre, et surtout pas à montrer ce que je comprends. En revanche, conduire les spectateurs vers la même zone de sensations, d’interrogations et de compréhension, ça oui. Je ne suis pas du tout un lecteur de romans policiers comme l’était ma grand-mère [Denise Braunschweig] – elle adorait ça -, mais la mise en scène s’apparente souvent à une enquête policière.
Rfp : Mais sans dénouement clair à la fin.
SB : C’est bien quand il reste des zones inéclaircies. Comme metteur en scène, les pièces qui m’intéressent sont celles que je ne comprends pas complètement au départ, celles où je vais pourvoir m’enfoncer avec les acteurs et mener avec eux une sorte d’enquête. C’est pour cela que j’aime tant le théâtre d’Ibsen. Mais je n’aime pas non plus la sensation d’avoir tout résolu, la sensation après-coup qu’on pouvait tout comprendre. Parce qu’alors cela veut dire qu’on est dans un théâtre schématique, loin de la vie réelle. Je précise que ce que j’aime c’est l’opacité des situations, des motivations, l’opacité psychologique, les conflits psychiques, mais pas du tout les textes obscurs ou hermétiques du fait de leur langue.
Rfp : C’était frappant dans Le Canard Sauvage [Théâtre National de la Colline, 2014], cette sensation de zones d’ombre qui s’éclairent sans se résoudre…
SB : Oui, les dramaturgies rétrospectives d’Ibsen, en nous invitant à aller chercher une vérité enfouie dans le passé, nous donnent l’impression que nous allons comprendre le présent à l’aune de ce passé, mais ce n’est pas tout à fait vrai et elles nous laissent souvent dans l’irrésolu. Dans Le Canard Sauvage, on comprend tout de suite que Hedvig n’est pas la véritable fille de Hjalmar. Il suffit d’être un peu attentif au texte. Au quatrième acte cette vérité cachée est enfin révélée à Hjalmar, qui n’a jamais voulu la voir, et cela va précipiter le suicide de Hedvig. Pour autant ce n’est pas cette vérité (ou même sa révélation) qui explique l’acte suicidaire de l’enfant. D’ailleurs, comme pour tout acte suicidaire, il est difficile de lui assigner une explication simple. Je trouve que la pièce est forte parce qu’elle montre un réseau qui fait qu’à un moment donné cette enfant est emprisonnée, mais on ne peut pas dire que c’est la faute de Gregers qui vient ouvrir les yeux, ou la faute de sa mère qui a toujours fermé les yeux, ou celle de Hjalmar qui n’a rien voulu voir… tout le monde a sa part de responsabilité.

© Elizabeth Carrecchio
Rfp : Une enquête policière sans coupable…
Pour vous, d’ailleurs, il n’y a pas de vérité mais il y a une justesse. Vous écrivez dans Petites Portes, grands paysages : « Je ne suis pas en quête d’une vérité absolue, mais plutôt d’une vérité relative, d’une justesse. J’ai toujours en tête cette phrase de Kafka : ”Notre art, c’est d’être aveuglé par la vérité. La lumière sur le visage grimaçant qui recule, cela seul est vrai rien d’autre”. La vérité est relative, car elle n’est que dans l’impact de la lumière sur le visage, de la réalité sur l’individu. C’est cela la justesse, décrire cette collusion de la lumière et du visage. Mais au théâtre, la lumière ne rend pas nécessairement tout clair et transparent, parfois elle ne fait que désigner l’opacité. Le visage de l’acteur grimaçant dans la lumière se déforme aussi de ce qu’il ne parvient pas à voir en lui. Car tout être garde une part d’opacité à lui-même. Dans la clarté, je vois que je ne vois pas tout, je comprends que je ne comprends pas tout » (Braunschweig, 2007, p. 43).
Rfp : Le régime de la justesse donne une ouverture plus grande que celui de la vérité.
SB : La justesse est plus relative que la vérité et elle peut mettre en jeu plusieurs réalités.
Rfp : Revenons au processus de création. Vous avec dit que vous meniez l’enquête avec les acteurs. Est-ce que cela signifie qu’elle ne commence qu’avec le début des répétitions ?
SB: Oui, l’enquête, c’est vraiment le travail des répétitions. Auparavant, on ne fait que l’amorcer, on essaye surtout d’éclaircir ce qu’on ne comprend pas littéralement : pourquoi l’auteur dit cela, ce que telle ou telle réplique signifie… Comme je monte beaucoup de textes étrangers, cela me conduit à passer beaucoup de temps sur les traductions…
Rfp : Et vous traduisez souvent vous-même.
SB : Oui, quelquefois, et que ce soit sur mes traductions ou sur celles des autres, je fais des relectures très méticuleuses, je veux comprendre mot à mot comment le dialogue avance. Parfois il suffit d’une petite conjonction inappropriée, un « et » à la place d’un « mais », et on ne comprend plus l’enchainement des répliques. Et ce travail de traduction se prolonge en général sur le début des répétitions parce que souvent c’est en jouant les choses qu’on les comprend vraiment, et que l’on débusque ce genre d’erreurs.
La conception de la scénographie, quant à elle, appartient à la phase préalable aux répétitions. Quand je choisis une pièce, même avant de décider définitivement de la monter, j’ai des conversations avec ma dramaturge, Anne-Françoise Benhamou, et nous ouvrons un ensemble de questions auxquelles nous mettrons très longtemps à apporter des réponses. Nous ouvrons des champs, éventuellement nous faisons quelques choix de distribution.
L’interprétation d’un texte se nourrit donc autant de la réflexion dramaturgique préalable que de désirs d’acteurs et d’intuitions scénographiques qui sont fortement liés à… l’inconscient.
Mais les choix d’interprétation ne dépendent pas seulement d’une façon abstraite de réfléchir à la pièce en amont. Au théâtre, il s’agit toujours d’un panorama, d’un paysage de raisons, de circonstances, de motivations. L’envie de travailler avec tel ou tel acteur peut pousser vers une interprétation ou une autre. De même, la scénographie provoque l’interprétation : elle n’en est pas le résultat, ou elle ne l’est qu’en partie. La scénographie peut m’amener vers quelque chose dans le texte que je n’avais pas vu tout de suite, pas vu d’emblée. Ici, je laisse parler mes intuitions, c’est-à-dire le ressenti visuel. La traduction plastique d’un ressenti par rapport à la pièce est aussi pour moi une manière de provoquer un déroulé, un schéma d’interprétation. L’interprétation d’un texte se nourrit donc autant de la réflexion dramaturgique préalable que de désirs d’acteurs et d’intuitions scénographiques qui sont fortement liés à… l’inconscient.
LES PERSONNAGES
Rfp : Il y a donc l’inconscient des personnages, celui qui est véhiculé par la scénographie, celui du texte…
SB : En fait, il y a beaucoup d’inconscients, il y en a partout, il y a même celui des spectateurs…Mais il faut que je me souvienne de temps en temps que ce n’est pas une donnée évidente pour tout le monde. Et notamment pour toute une frange de gens du théâtre qui considèrent, par exemple, que le « personnage » n’existe pas. Ce qui est une manière d’évacuer la question de l’inconscient. La conception d’un théâtre sans personnages – très à la mode dans un théâtre qui refuse la psychologie en général – ne me convient pas. Pour moi, le théâtre est fait d’histoires, de situations, de personnages.
En fait, il y a beaucoup d’inconscients, il y en a partout, il y a même celui des spectateurs…
Mais aussi de l’imaginaire de l’auteur. Cette idée que « il n’y a pas de personnage » est sans doute une tendance post-structuraliste, elle va de pair avec le refus de s’intéresser à la biographie de l’auteur. On ne s’intéresse qu’au texte comme réseau, c’est du post-Barthes, pourtant Barthes lui-même était assez en phase avec la psychanalyse…
Pour ma part, je trouve que le soi est très ennuyeux au bout d’un moment ; que chacun de nous, y compris le metteur en scène, est relativement limité dans ses configurations, dans son imaginaire. La seule chose qui peut faire que l’imaginaire se nourrisse, se développe, refleurisse, c’est qu’il se nourrisse des autres, de nouveaux auteurs, de nouveaux textes, de nouveaux acteurs, des nouvelles rencontres de toutes sortes.
Rfp : Dans le programme de votre mise en scène récente [2016] de Britannicus de Racine à la Comédie Française, vous dites, à propos de la relation de Néron à Agrippine, que vous n’avez pas souhaité montrer un amour fusionnel, mais plutôt l’impossibilité pour Néron d’obtenir l’amour de sa mère. D’où vous vient cette lecture, cette intuition ? Du texte même de Racine ?
SB : La prophétie faite à la naissance de Néron selon laquelle il tuerait sa mère revient plusieurs fois dans le texte. Donc sa mère ne peut pas l’aimer comme n’importe quel enfant ! Les lectures qui ont accentué la vision d’un couple mère-fils fusionnel, d’un couple qui n’arrive pas à s’arracher à la fusion, sont sans doute des lectures qui se veulent psychanalytiques, mais elles me paraissent plaquées. Je les trouve aussi un peu misogynes, car elles font d’Agrippine une sorte de cliché du monstre maternel. Si on lit bien la pièce de Racine, c’est bien plus compliqué que cela. Il m’a paru plus intéressant, plus psychanalytique finalement, de s’interroger sur ce que sont ces enfants qui n’ont pas été aimés par leurs parents. Je veux dire, qu’est-ce que ne pas être crédité d’amour, ne pas être légitime ? Je suis parti de l’idée que Néron a un problème fondamental de légitimité, puisqu’il n’est pas l’empereur légitime, même si un certain nombre de rituels et de cérémonies en ont fait symboliquement l’empereur légitime. Au fond, il ne peut pas résoudre ce problème de légitimité et je me suis dit que ce problème venait aussi de la relation avec cette mère. Je ne dis pas qu’Agrippine n’est pas, quand même, responsable de l’état psychique de Néron, mais elle n’est pas une mère fusionnelle, dévoratrice. C’est juste une mère qui ne veut pas être une mère et cela, c’est un problème.
LA MUSIQUE
Rfp : Nous ne voulions surtout pas laisser de côté la musique. Vous avez monté à la fois le Woyzeck de Büchner et le Wozzeck de Berg[3]. De l’opéra de Berg, vous dites notamment que sa musique habite tous les silences, que Berg « fait exister toute une dimension psychique et inconsciente, demeurée à l’état de silence au théâtre. C’est une lecture forte et orientée du drame de Büchner » (Braunschweig, 2008). Y a-t-il pour vous une spécificité de la mise en scène à l’opéra par rapport au théâtre ?
SB : Quand on met en scène le Wozzeck de Berg, on met en scène Berg avant Büchner. Ou, en tout cas, on met en scène l’interprétation de Büchner par Berg. La musique a déjà réinterprété la pièce de théâtre, la musique est une réécriture. En tant que metteur en scène, je me sens interprète ; je suis interprète d’un texte et, quand je mets en scène un opéra, je suis interprète d’un texte qui est composé de mots et de notes, c’est inséparable. Et lorsque le livret est faible et la musique sublime, dans le cas de Fidelio, par exemple, c’est bien à la musique qu’il faut donner la priorité. Dans le Wozzeck de Berg, les mots et la musique forment un tout. J’avais déjà monté la pièce de Büchner trois fois avant de monter l’opéra, et quand on met en scène du théâtre, la mise en scène est une sorte de musique. J’ai un rapport un peu musical aux textes et, des années après, j’ai la mémoire des intonations, du rythme, j’ai la mémoire des silences, des phrasés. Quand j’ai monté Berg, j’ai dû oublier ma « musique » du texte de Büchner.
J’ai un rapport un peu musical aux textes et, des années après, j’ai la mémoire des intonations, du rythme, j’ai la mémoire des silences, des phrasés.
Un bon livret, en fait, ce n’est pas forcément un texte qu’on pourrait monter en pièce de théâtre. D’ailleurs, une pièce de théâtre fait en général un mauvais livret d’opéra si on la prend telle quelle. Pelléas et Mélisande est une exception. On attend d’une bonne pièce de la complexité et de l’opacité, et d’un bon livret une simplicité qui permette à la musique de toucher des émotions fondamentales, plus archaïques ou primaires peut-être.
Mais, au fond, je ne trouve pas que mon travail scénographique soit très différent dans l’un et l’autre. Quand j’étais plus jeune, ce l’était sans doute plus. J’avais la sensation qu’au théâtre, il ne fallait pas que les décors soient plus grands que l’acteur, alors qu’à l’opéra, il fallait que les décors soient assez grands pour que la musique puisse prendre toute sa place. Maintenant, je pense que je fais converger les deux vers un même endroit, un entre-deux en quelque sorte. L’endroit où l’œuvre peut prendre place et se donner au public, le point de rencontre des imaginaires.
Rfp : Il n’y a pas, pour vous, de théâtre sans personnages, vous l’avez rappelé, pas de théâtre sans présentation du « chaos intime des êtres réels derrière les belles images auxquelles chacun voudrait ressembler » que scrute notamment Pirandello comme vous l’écrivez à propos de Vêtir ceux qui sont nus (Braunschweig, 2007, p. 163). Vous êtes particulièrement attentif aux conflits internes, aux scissions des personnages, à leur « double vie », dans vos mises en scène de théâtre et d’opéra. Dernièrement, vous avez souligné dans le personnage de Norma cette dualité entre la sphère publique et la sphère privée (Norma, Théâtre des Champs Elysées, novembre 2015). Si la scénographie et la mise en espace traduisent cette tension, dans l’opéra de Bellini – et peut-être dans la plupart des opéras – les duos n’ont-ils pas cette fonction particulière de traduire ce dédoublement ? De nous faire éprouver la contradiction des sentiments en un seul temps, à la fois par le texte et par la musique ?
SB : Quand on m’a proposé de mettre en scène Norma, quand je l’ai vraiment écouté, ce qui m’a complètement convaincu de le faire, ce sont les duos des deux femmes, Norma et Adalgisa, que je trouvais très beaux car ils produisaient un effet de gémellité. Dans ces duos, on dirait que la musique passe d’un corps à l’autre, d’une voix à l’autre. Ce n’est pas du tout comme le duo d’amour entre Pollione et Adalgisa, où les deux voix s’opposent. Ces deux voix de femmes, elles, se traversent, sont traversées l’une par l’autre, il y a un flux continu d’émotion, une fluidité entre elles qui naît de la musique. Et ça a quelque chose d’érotique, évidemment. En les écoutant, on ressent parfois très fort l’empathie de l’une pour l’autre alors qu’elles sont opposées par l’amour du même homme, et ces sensations-là, seule la musique peut les donner. C’est très difficile au théâtre parce que le théâtre a besoin de l’opposition, du conflit entre les personnages. Au théâtre, quand deux personnes sont d’accord, c’est en général assez ennuyeux. Quand on est « dans » la musique, on n’est pas seulement des êtres isolés, il y a une fluidité, et cela traverse les limites des corps. Je pense à ce que Merleau-Ponty disait à propos de la peinture de Cézanne : qu’elle nous donne la sensation qu’on fait partie de la « même chair ». Comment dire ? Je ne l’ai jamais pensé avant de le dire aujourd’hui : cela bouleverse les limites du corps. Et c’est vrai que, pour moi, les grandes émotions en musique sont liées à ce genre de sensation. Et cela passe beaucoup par les voix.
Quand on est « dans » la musique, on n’est pas seulement des êtres isolés, il y a une fluidité, et cela traverse les limites des corps. Je pense à ce que Merleau-Ponty disait à propos de la peinture de Cézanne : qu’elle nous donne la sensation qu’on fait partie de la « même chair ».
Mais il y a aussi des moments de pure musique extraordinaires. Dans Wozzeck de Berg, après le meurtre de Marie et la noyade de Wozzeck dans l’étang, il y a un interlude symphonique d’une douzaine de minutes qui reprend tous les thèmes de l’opéra. On retraverse toutes les émotions du spectacle mais de manière très inconsciente, parce que c’est construit comme un rêve avec des éclats – on entend la trompette du tambour majeur, etc. – et c’est comme un rêve.
Rfp : Avec des leitmotive, des sensations, des condensations, avec toutes les opérations du rêve que la langue fait difficilement quand même. Finalement, c’est toute la spécificité de la musique.
SB : Oui, on est très proche de l’inconscient dans la musique.
Rfp : D’une façon souvent difficile à traduire, mais la mise en scène travaille à cela ?
SB : En même temps, ça ne peut pas se traduire ou s’illustrer. Pendant le long interlude en question… scéniquement, je n’ai rien fait. Rien. Juste une image arrêtée. Une énorme lune qui éclairait le plateau où gisait le corps de Marie. Et à la toute fin de l’interlude, il y avait l’enfant orphelin qui entrait. Une profonde sensation de vide et de solitude.
On est très proche de l’inconscient dans la musique
Rfp : Vous dites que vous êtes un peu sous la direction du chef d’orchestre à l’opéra. On peut le penser dans ces termes-là ?
SB : Je considère que je dois aussi m’adapter à lui, à la façon dont il voit l’œuvre. En général je parle assez peu de l’œuvre avec lui, je comprends mieux quand j’écoute son interprétation, quand je sens un tempo, une sensibilité à tel ou tel moment ou quand je le vois diriger un chanteur. Le moment où on se parle le plus est celui où on dirige les chanteurs ensemble. Un chef va dire : « attention à cette respiration », ça va être plus technique. Un autre donnera plus de sens, plus de contenu. J’essaye de comprendre ce qu’il veut faire et j’essaye de m’adapter.
Rfp : Vous travaillez les partitions comme un texte ?
SB : Je ne suis pas musicologue, mais je travaille sur la partition, je l’étudie, à ma manière, qui est assez empirique. Je prends l’œuvre et je pense à ce qu’elle me raconte, comme avec n’importe quelle pièce de théâtre. Si c’est une œuvre du répertoire, dont il existe déjà des enregistrements, je l’écoute beaucoup. Je suis attentif aux motifs, je note les événements musicaux parce que c’est cela qui donne le sens. À l’opéra, le sens vient souvent de ce que la musique dit dans la fosse, comme si elle était l’inconscient de ce qui se chante sur la scène.
LE TRAGIQUE ET LA TRAGEDIE
Rfp : Une dernière question à propos de notre époque. Vous dites qu’il y a toujours du tragique mais qu’on n’écrit plus de tragédie. Cela fait écho avec ce qu’a écrit Imre Kertész sur la fin du tragique et la tragédie. Lui dit il n’y a plus de tragédie, comme Goethe a pu faire des tragédies, il n’y a même plus d’homme tragique, l’homme actuel ne fait plus que s’adapter. Il n’y a plus de dimension tragique dans l’être humain. Ce n’est pas tellement ce que vous montrez. Dans vos mises en scènes, il y a toujours la dimension tragique des personnages.
SB : Le but de la « tragédie », c’est la purgation des passions. La tragédie, c’est une manière de traiter le tragique, au sens médical pratiquement. On a affaire à la violence, à l’horreur, à l’hybris et au fait qu’il y a un héros qui s’oppose à la marche du monde ou à la marche des dieux. Mais avec la tragédie, en racontant cette histoire-là, on la met en forme, on la traite. Je pense qu’il a une difficulté aujourd’hui à traiter le « tragique ».
La tragédie, c’est une manière de traiter le tragique, au sens médical pratiquement.
Sur les plateaux, ce n’est pas qu’on n’a pas de tragique, on a d’ailleurs un avatar du tragique, qui est le « trash ». Mais les tragédies grecques, Shakespeare, c’était déjà bien trash… Quand on regarde le monde contemporain, le tragique est partout. En revanche la question est de savoir comment on fait pour le purger, accomplir la catharsis. Même par l’écriture des pièces, c’est difficile. C’est un état du monde actuel.
Notes
[1] INA, http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes06007/stephane-braunschweig.html
[2] S. Braunschweig, Petites portes, grands paysages, Ecrits, suivis d’entretiens avec Anne-Françoise Benhamou, Actes sud, 2007, page 163.
[3] Stéphane Braunschweig a mis en scène Woyzeck (1837) de Georg Büchner à trois reprises: en français en 1988 (Festival du jeune théâtre d’Alès) et 1991 (Théâtre de Gennevilliers), en allemand en 1999 (Residenztheater de Munich) et le Wozzeck de Berg (créé en 1925) en 2003 au Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence.
Crédit image
Portrait de Stéphane Braunschweig © Carole Bellaïche

